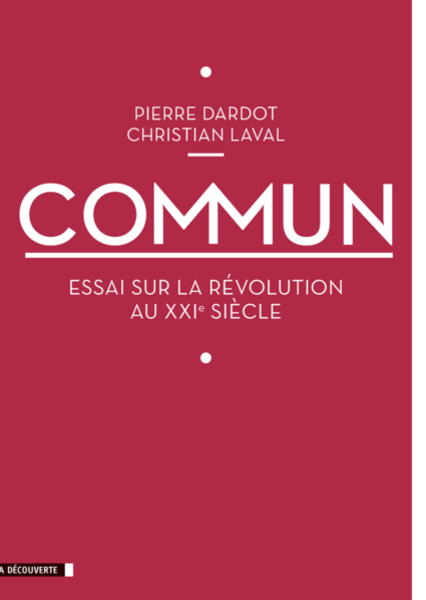La collaboration entre le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval a donné lieu en 2009 à la publication d’un premier ouvrage analysant l’expansion de la logique concurrentielle à l’ensemble des sphères de la vie sociale (La nouvelle raison du monde, La Découverte). Erigé en norme universelle des conduites, le marché colonise tous les aspects de l’existence humaine, jusqu’à façonner ses sujets à son image. En ce sens, l’Etat néolibéral est en rupture avec ses prédécesseurs : il n’a pas vocation à protéger certains biens publics de leur appropriation marchande mais, au contraire, il se fait l’agent principal de la privatisation de l’ensemble des ressources.
Partant du principe que seule l’intelligence de cette rationalité néolibérale permettra de lui opposer une véritable résistance, Dardot et Laval se sont tournés en 2012 vers les outils conceptuels offerts par l’auteur du Capital (Marx, Prénom : Karl, Gallimard). Marx ne nous permet pas d’envisager une réelle rupture avec le capitalisme dans la mesure où sa pensée reste prisonnière de deux perspectives résolument contradictoires. Si la première, tournée vers la lutte des classes et la logique stratégique de l’affrontement, trace une voie indéniable vers l’émancipation, la seconde, en revanche, reste prisonnière de la logique du capital comme système achevé et totalité qui se subordonne tous les éléments de la société. D’après Dardot et Laval, le concept marxien de « communisme » ne parvient pas à résoudre la contradiction entre le jeu de l’action révolutionnaire et la force implacable de l’automate qui brise toutes les résistances. D’où la nécessité de penser le capital avec et au-delà de Marx.
Une proposition articulée autour de la raison du commun
Au diagnostic des maux du capitalisme, le dernier opus de la trilogie de Dardot et Laval se donne pour ambition d’apporter un remède. La critique du néolibéralisme se prolonge à travers la formulation d’une proposition positive, articulée autour de la raison du commun.
Le premier des mérites de cette approche est d’échapper à la posture du philosophe-roi ou du savant éclairé dictant aux acteurs sociaux la conduite à adopter pour se libérer de leurs chaînes. Si l’ouvrage se fonde sur une connaissance encyclopédique des sciences sociales contemporaines (droit, philosophie, sociologie, économie, histoire), la notion de commun ne descend pas du ciel des idées mais émerge du sein des luttes les plus actuelles, contre la privatisation de l’eau, la marchandisation de l’université, l’emprise des oligopoles et des Etats sur Internet, le démantèlement des droits sociaux et l’appropriation privée des espaces publics. Dardot et Laval élaborent le concept de commun à travers un travail de réflexivité cherchant à expliciter le principe partagé qui anime ces mouvements d’émancipation en apparence disparates. Si ce livre constitue bien une tentative de théorisation du commun, cette théorie ne revendique aucune prééminence sur la pratique effective qui lui correspond.
La question cruciale ne concerne pas la « nature » de certains biens supposément communs en raison de leurs caractéristiques intrinsèques. Le problème n’est donc pas que l’air et l’eau soient communs du fait qu’ils sont inépuisables, ni que les nuages et la lumière soient communs du fait qu’ils sont insaisissables. Considérer le commun comme l’attribut naturel de certains biens conduit à occulter la façon dont ces biens sont institués en tant que commun. Car le commun procède précisément du domaine de la praxis. Il n’est pas une forme d’avoir mais une forme d’action collective orientée vers l’émancipation humaine.
A cet égard, il importe peu d’opposer les biens publics aux biens privés. La distinction pertinente politiquement ne sépare pas la marchandisation des biens de leur accaparement étatico-bureaucratique. Ces deux modes de gestion font violence à l’agir démocratique des sujets politiques. En dépit de leurs oppositions, la mondialisation néolibérale et le communisme d’Etat partagent un refus assumé d’une politique du commun, que Dardot et Laval rapprochent davantage de la tradition du conseillisme et du communisme libertaire.
Si le commun procède d’une praxis, échappant ainsi à la logique de l’avoir, il échappe tout autant à celle de l’être. De même qu’il ne définit pas un ensemble de biens, le commun ne se réfère à aucune nature humaine universellement partagée. La question n’est pas d’identifier une essence propre au genre humain (le logos, la conscience, la liberté ou encore la raison) et dotant ses représentants d’un ensemble de droits dérivés de leur appartenance à la commune humanité. Ce type d’essentialisation aboutit bien souvent à rabattre l’universalité humaine sur une communauté nationale ou ethnique dont sont exclus tous les autres. Aussi Dardot et Laval dénoncent-ils vigoureusement les entreprises du réification du commun en rappelant que seule l’activité des hommes est en mesure de rendre des choses communes. Le commun résulte d’une auto-institution collective, lucide et réfléchie, et non d’une quelconque nature (des hommes ou de leurs objets) qui préexisterait à l’action politique.
Droit d’usage contre droit de propriété
De ce point de vue, le danger des politiques néolibérales de brevetage du vivant et d’appropriation des ressources naturelles réside moins dans le passage d’une forme de propriété à une autre que dans l’élimination du droit d’usage au profit du droit de propriété, qu’elle soit publique ou privée. L’enjeu n’est pas tant et pas seulement de sauvegarder les « biens publics » et de renationaliser ceux qui ont été privatisés que de liquider la logique de l’appropriation. Une politique d’émancipation cherchera davantage à investir une logique de l’inappropriable, quels que soient les propriétaires (multinationales ou Etat). Le commun ne peut émerger qu’à travers un droit d’usage des objets garanti à toutes et tous. Ce droit d’usage procède du droit de coproduire les règles d’usage. De telles règles sont démocratiques dans leur contenu et dans leur mode d’élaboration. Ainsi conçu, le droit ne vient pas sanctionner a posteriori un état de fait préétabli – la nature inappropriable de tel bien. Le droit procède au contraire de l’activité des sujets politiques qui, en raison de leur collaboration, se trouvent mutuellement obligés par les règles qu’ils ont posées.
Si Pierre Dardot et Christian Laval retombent parfois, malgré leur dénégation initiale, dans le travers consistant à réduire les luttes sociales à des illustrations d’un propos théorique désincarné, il faut mettre à leur crédit l’effort de tirer du principe du commun un ensemble d’implications politiques très concrètes. Ne craignant pas de descendre dans l’arène, la dernière partie de l’ouvrage, la plus stimulante, dévoile au lecteur une série de neuf « propositions politiques ». Fondées sur le refus d’employer des moyens tyranniques pour atteindre des fins émancipatrices et sur la recherche d’institutions nouvelles à même de remplacer celles de l’Etat et du marché, ces propositions concrétisent la signification du commun sur le plan du droit, du pouvoir, de l’économie, de la culture et de l’éducation. Elles sont modélisées en prenant appui sur des expérimentations actuelles, telles l’autogouvernement zapatiste et le gouvernement communal de l’eau à Naples.
Après avoir posé la nécessité d’une politique faisant du commun le principe autour duquel puissent converger les stratégies de transformation sociale, ces propositions réaffirment l’opposition du droit d’usage au droit de propriété. Elles établissent ensuite que le commun est le principe de la libération du travail, puis que l’entreprise commune et l’association doivent prévaloir dans la sphère économique. Elles appellent à refonder une citoyenneté sociale et à transformer les services publics en véritables institutions du commun. Enfin, elles établissent la nécessité d’inventer des communs mondiaux et, à cette fin, d’instaurer une fédération des communs.
Sous-titré « Essai sur la révolution au XXIe siècle », l’ouvrage se conclut sur un post-scriptum invitant à « retrouver la grandeur de l’idée de révolution ». Les auteurs constatent qu’avec l’écroulement du vieux monde s’ouvre devant nous une longue période de bouleversements et d’affrontements. Les nostalgiques de Keynes et Roosevelt qui rêvent d’une transition paisible ou d’une harmonieuse conciliation des contraires se fourvoient. L’appel aux « réformes » est dépassé, au point qu’elles ont fini par signifier le contraire d’une avancée sociale. L’heure est à une lutte agonistique entre le règne tyrannique du capital et une révolution démocratique et anticapitaliste planétaire, constatent Dardot et Laval. Face aux accusations de dangerosité et de totalitarisme, les auteurs du texte rappellent, citant Cornelius Castoriadis, que « révolution ne signifie ni guerre civile ni effusion de sang. La révolution est un changement de certaines institutions centrales de la société par l’activité de la société elle-même : l’auto-transformation de la société dans un temps bref ». A un interlocuteur sceptique qui lui demandait : « que voulez-vous donc ? Changer l’humanité ? », Castoriadis répondait : « non, quelque chose d’infiniment plus modeste : que l’humanité se change elle-même, comme elle l’a déjà fait deux ou trois fois. »
Au regard de la perte des repères stratégiques qui affecte l’ensemble de la gauche radicale, l’exhumation du projet révolutionnaire peut paraître évidente aux militants anticapitalistes, mais ils et elles trouveront dans cet ouvrage de précieux et nombreux arguments à l’appui de leur conviction.
Manuel Cervera-Marzal
Pierre Dardot, Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014, 600 pages, 25 euros. Acheter sur le site de la Librairie La Brèche.