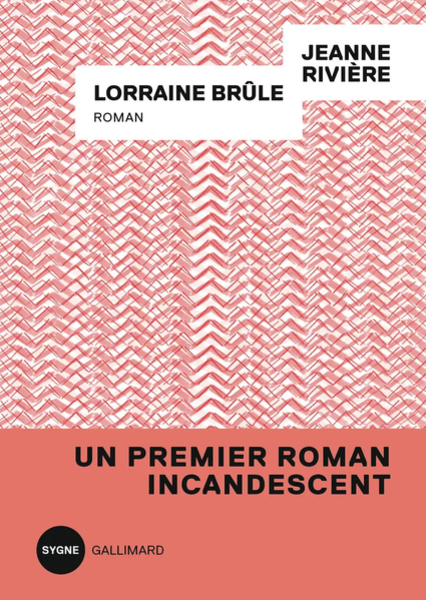Éditions Gallimard, 2025, 192 pages, 19 euros.
Rédigé dans un style percutant, parfois trash, un peu à la Virginie Despentes, ce roman repose sur la voix singulière de la narratrice : une femme de 42 ans à l’existence a priori banale, commune à des milliers de femmes qui vont travailler en TER, élèvent leur enfant (et soignent leur cochon d’inde), écoutent les copines parler d’histoires d’amour plus ou moins bancales.
Mais les copines ici détonnent un peu, avec des pratiques BDSM quasi-burlesques, dans les bois aux alentours. La narratrice prévient qu’elle a rencontré, dès son arrivée à Metz, « tous les tordus de la ville », « une clique de weirdos qui faisaient de la musique » auprès de qui sa vie va s’organiser, entre concerts sauvages sous le pont de l’autoroute et régularité du train qu’elle prend chaque jour pour aller travailler.
Tout l’intérêt du roman, c’est le regard que la narratrice porte sur ce petit monde, sa propre vie, son (ex)-couple et son enfant. Un regard attentif, curieux, sur un univers parfois glauque, mais éclairé de tendresse et d’amour.
Un roman d’amours
De belles lignes, drôles et tendres, sont consacrées à son enfant, tout en envoyant : « Formidable cataclysme que cet enfant sur terre même si personne m’avait prévenue de l’arnaque qu’est la maternité pour la vie intellectuelle, sociale, créative et sexuelle ». Quant au père de cet enfant, si elle s’en est séparée, leur relation se poursuit, d’une autre forme : de quoi réfléchir aux différentes façons de faire famille. À une copine qui lui souhaite de retrouver quelqu’un : « Je lui réponds que je mérite qu’on me foute la paix. La vie est plus simple sans séduction ni injonction à la sexualité ». Ce qui n’empêche pas le désir et les rencontres, en aspirant à briser les codes : « C’est pas en désirant seulement les parangons de beauté narcissiques qu’on va faire un monde meilleur ».
Le cœur de la narratrice bat aussi auprès de ses amies, qui ont la part belle dans ce récit avec une galerie de portraits baroques et sensibles. Des mini-récits de vies bancales, tristes ou joyeuses, entrecoupés d’une voix blanche qui raconte la maladie inexorable de son amie Baya.
Un roman social et politique
Par ce récit intime, l’autrice donne à entendre la voix d’une femme, qui fera écho à beaucoup d’entre nous. Elle écrit : « Je suis la gentille fille. Celle sur qui on peut compter » et semble envier parfois la liberté de ses copines déjantées. Mais si, à les entendre, le BDSM permet une forme émancipée car plus clairement négociée, de sexualité, on y constate finalement les mêmes violences masculines imposées « par surprise ». Sans glamour ni misérabilisme, le récit évoque également la défonce, l’alcool, le désespoir, et au final « beaucoup, beaucoup trop d’enterrements ».
Heureusement il y a aussi beaucoup d’humour et d’autodérision. Et le regard se fait parfois piquant, quand elle décrit le milieu anarcho-queer dans lequel elle évolue, observant « les vestes de jogging élimées des années 90 même si leurs parents appartiennent à des CSP ++ ».
Comme le titre l’indique, le roman s’inscrit dans une région sinistrée, la Lorraine. Ses grands-parents, depuis leur cité ouvrière de Jœuf, ayant vécu l’emprise de la famille De Wendel, lui ont appris à se méfier des riches. Plus tard, en écho à Edouard Louis, elle constatera : « jamais on m’a appris le goût du luxe », le moelleux des draps Linvosges ou l’élégance d’une « bonne table ». Rageuse, elle revendique préférer toujours les buffalo-grill.
Sont vaguement évoquées des manifs, un festival féministe, mais on n’en saura pas plus. C’est plutôt par le biais d’anecdotes que se lit cette colère sourde et politique qui traverse le livre, par exemple quand elle s’assoit chez elle, sur un fauteuil piqué au boulot : « S’ils ne m’avaient pas gonflée avec ces histoires de retraite à 64 ans, le fauteuil serait encore certainement à mon travail à l’heure qu’il est. » Un premier roman drôle, poignant et politique, qui se lit d’une traite.
Catherine S.