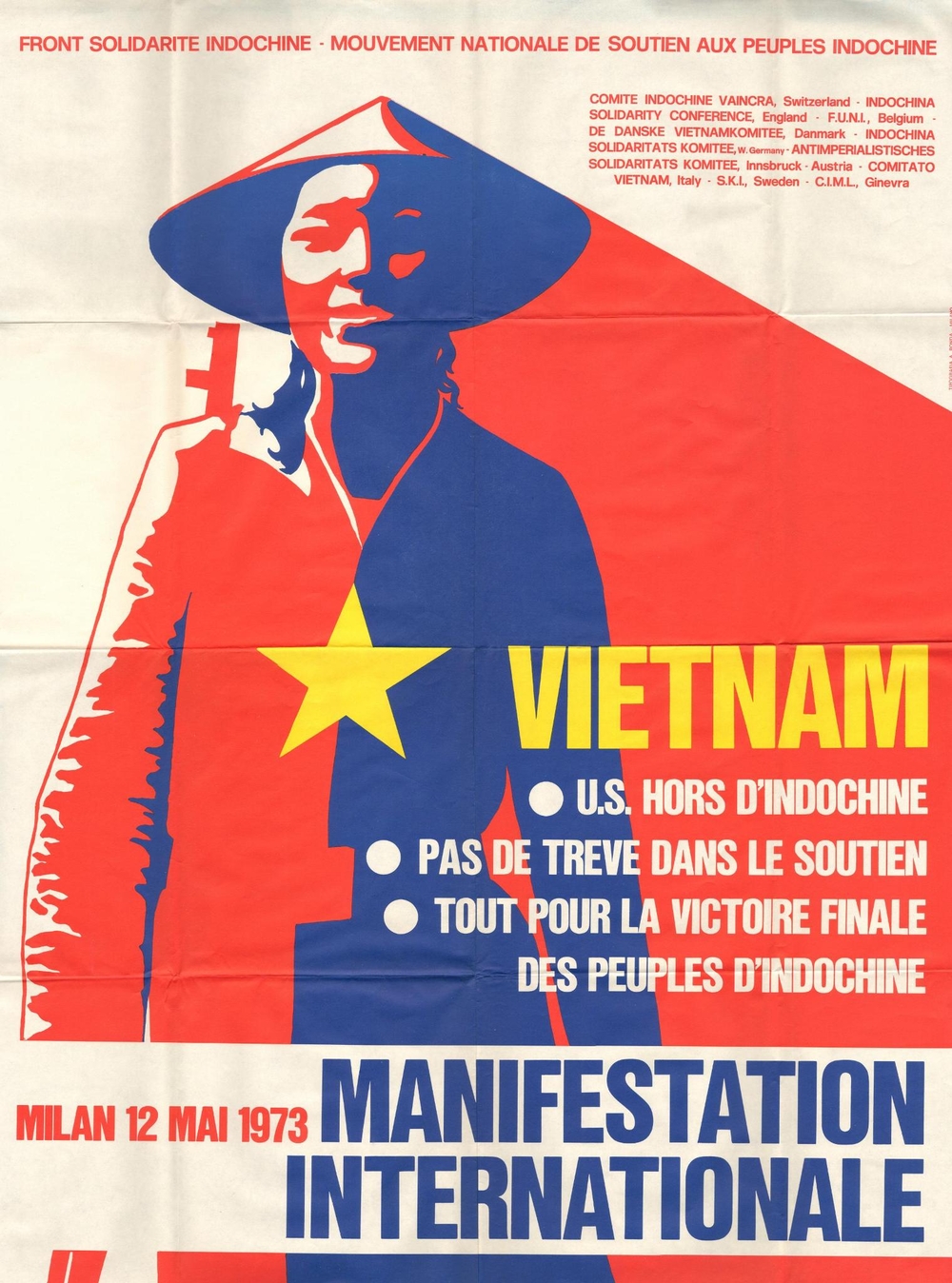Une fois la France défaite après la victoire vietnamienne de Dien Bien Phu (1954), les grandes puissances ont imposé au Vietminh les accords de Genève qui lui étaient très défavorables, divisant temporairement le pays en deux zones de regroupement militaire.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Vietminh profite, pour déclarer l’indépendance, d’une fenêtre d’opportunité. L’occupant japonais a détruit l’administration française, avant d’être lui-même défait sur le théâtre des opérations du Pacifique. Il a l’initiative politique, mais dans une situation fragile. Ses capacités militaires sont faibles et son autorité contestée, surtout de la part de sectes religieuses et de mouvements nationalistes anticommunistes.
Révolution sociale et réforme agraire
Avec l’accord de la Chine de Tchang Kaï-chek, le corps expéditionnaire français bombarde le port d’Haïphong au nord du Vietnam en 1946. La première guerre du Vietnam a commencé. Les offres de négociations d’Hô Chi Minh ont été rejetées. Vu le rapport des forces militaires, cette guerre prend la forme d’une guerre révolutionnaire prolongée et mobilise la paysannerie. Le patriotisme ne suffit pas. L’appel à la réforme agraire s’avère indispensable. Dorénavant, libération nationale et révolution sociale sont imbriquées. Ce sera le socle permettant d’inscrire la résistance dans la longue durée.
Il a aussi fallu penser les spécificités vietnamiennes, par rapport à la Chine (Pékin envoie aide et conseillers) qui a pu jouer sur l’immensité du pays et de sa population. Ainsi que prendre en compte, à chaque étape, les réactions des forces ennemies, adapter la stratégie. Il y a une pensée vietnamienne de la guerre.
La perspective de l’émancipation sociale et démocratique
Décider de la reprise de la lutte armée dans la seconde moitié des années 1950 n’a pas dû être une décision facile. Telle était l’alternative : s’affronter aux États-Unis ou accepter a minima la division du pays ad vitam æternam, comme en Corée. Laisser aussi sans soutien les réseaux militants et les bases sociales du mouvement de libération au Sud, face à une dictature sans scrupule aucun.
La guerre populaire ouvre (potentiellement) une dynamique d’émancipation sociale, qui risque cependant de s’épuiser quand elle dure longtemps. En Asie, la question posée n’est pas seulement historique. Les conflits armés n’ont, par exemple, jamais cessé à Mindanao (au sud de l’archipel philippin). Des réponses concrètes doivent sans cesse être apportées à une double question : comment éviter que des groupes armés ne dégénèrent (ce qui arrive…), comment défendre concrètement, dans les conditions concrètes, la liberté démocratique de décision et les droits des communautés populaires ou montagnardes.
En Birmanie, quand la junte militaire s’est emparée il y a quatre ans de l’entièreté du pouvoir, on peut dire que le pays (quasi) entier est entré en désobéissance civique, non violente. La junte aurait pu être renversée, pour peu que la « communauté internationale » lui apporte son soutien. Ce ne fut pas le cas, une fois encore. Et la répression a fini par forcer la résistance à rejoindre la lutte armée portée, notamment, par des minorités ethniques.