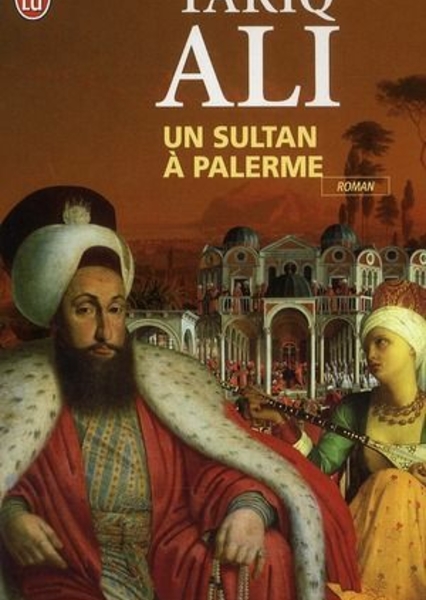Les vacances d’été approchent, période propice tout à la fois à la détente, à la flânerie et à la lecture. Alors fleurissent, dans les grandes chaînes promotrices d’une culture mercantile comme dans les petites librairies assumant tous leurs partis pris, les sélections qui doivent permettre aux lecteurs et lectrices estivalEs de s’y retrouver dans le labyrinthe de la production éditoriale. En quête de découvertes ou d’escapades, c’est l’occasion de rattraper les titres manqués au cours de l’année, ou tout simplement un nouveau regard ou un nouveau style. Une sélection, élaborée conjointement entre la presse et la librairie du NPA, manque aujourd’hui cruellement. Nous accordons beaucoup d’intérêt aux ouvrages d’économie, de philosophie politique, de sociologie, d’histoire, mais bien peu aux productions de l’imagination : les romans, mais aussi la poésie ou le théâtre, se retrouvent trop souvent ravalés au rang d’aimables divertissements. Au mieux, ils sont censés être pédagogiques, nous introduire au cœur d’un pays, d’une période historique, d’une société. Sans que nous parvenions à assumer la dimension ludique, la découverte, l’étonnement, l’oisiveté de la lecture.
Si rien d’humain ne saurait nous être étranger, alors la littérature est un outil formidable, essentiel même, qui nous entraîne dans des jeux de nuances et d’ambiguïtés, sans pour autant épuiser les richesses de l’expérience humaine. C’est le sens de la devise qui ornait la Librairie du travail, dans les années 1920 : « la vie invente, le livre précise ». Un point que je m’efforcerai de développer ultérieurement.
Je me bornerai ici à vous proposer une première sélection, prenant sa source dans les dynamiques révolutionnaires qui agitent le bassin méditerranéen, et les images qu’elles évoquent et/ou qu’elles viennent bousculer1. Mon parti pris : des livres que j’ai appréciés, pour leur style, pour leur thème, parfois les deux. Le choix n’est pas exhaustif, et il comporte des lacunes. Il ne s’agit ni des prochains prix Nobel ou Goncourt ni de pépites cachées au plus grand nombre : simplement de passer un moment agréable, en compagnie d’une voix, d’un style, qui nous apprend quelque chose, parfois, pas obligatoirement… Le propos sera donc délibérément subjectif, comme les liens que je mets en avant entre tel et tel livre.
N’hésitez pas à me faire parvenir vos remarques, vos critiques : hen.clement@gmail.comDernière chose : commandez vos livres, ceux-là et d’autres, à la librairie La Brèche (ils peuvent même vous les envoyer !), pas seulement parce qu’il s’agit de la librairie du NPA, mais parce que c’est une librairie dont l’activité s’ancre profondément dans le mouvement ouvrier, et qui reste un espace de rencontre et de confrontation essentiel aujourd’hui, un espace à faire vivre, plutôt que les Amazon, Fnac, et autres Virgin ! Bonne(s) lecture(s) !
Henri Clément1. Mediapart a eu la même idée, voir leur Voyage en littératures arabes en huit volets
Partir, Tahar Ben Jelloun, Folio Gallimard, 6,80 €
Au cœur de ce roman se retrouve la question de la jeunesse diplômée et au chômage, qui fut l’élément moteur de la révolution tunisienne. L’ensemble de l’intrigue se déroule à cheval entre le Maroc et l’Espagne, mais elle montre bien comment cette question traverse l’ensemble des sociétés arabes. Avec une grande maîtrise, l’écrivain brosse le tableau d’une société étouffante, entièrement pourrie par la corruption, où les possibilités d’avenir ont complètement sombré. C’est la chronique du régime agonisant de Hassan II, où tout se monnaye : la durée de la file d’attente, l’attention d’un infirmier, l’indulgence du flic ou du douanier, même la religion – quelques billets bien placés vous transforment un mécréant en bon musulman. Ne reste qu’un seul espoir auquel se raccrocher : partir ! Franchir la Méditerranée et rejoindre le sol européen et sa prospérité fantasmée. Parce qu’ici l’on étouffe, l’on meurt. L’auteur joue avec l’histoire et ce que l’on nomme, avec inexactitude, son ironie. Elle lui permet de jouer avec les perspectives, comme lorsqu’il utilise cet entrefilet qui serait paru dans la presse en 1951 : « Dix immigrés espagnols ont failli mourir noyés au large de Salé ; ils ont été recueillis et soignés et ont disparu ensuite dans la nature ; la police et leurs familles sont à leur recherche ». La direction des rêves et des espoirs s’est inversée, tournée vers les « lumières de l’Espagne », et qui conduisent tant de jeunes à tenter leur chance à bord de rafiots pourris : certains réussissent, d’autres, nombreux, ne sont plus le lendemain que des cadavres que la mer rejette. Mais ce livre est aussi un roman sur la mémoire et l’identité, hommage de l’auteur à la littérature française (Flaubert, Apollinaire, Zola…) et interrogation sur le rôle des racines, tout comme sur la situation d’allégeance imposée aujourd’hui par les sociétés européennes : « nos origines nous poursuivent partout où l’on va, on ne se débarrasse pas de ses racines aussi facilement que ça » (p. 243), racines culturelles comme racines sociales ! Azel l’apprend à ses dépens. Un très bon roman.
L’immeuble Yacoubian, Alaa El Aswany, Collection Babel, Actes Sud, 8,50 €
Avec la Tunisie, l’Égypte est le second membre du duo dynamique des bouleversements en cours dans le monde arabe. De ce pays, nous avons en tête les images qui s’étalent sur les murs des villes du monde, comme des promesses de vacances idéales : les pyramides et le Sphinx, le Nil et Louksor, Alexandrie, Cléopâtre et les plongées en mer Rouge. Et Le Caire, bien entendu. Le roman d’El Aswany nous plonge dans cette métropole aux multiples facettes. Prenant le prétexte de la chronique d’un immeuble – qui donne son titre à l’ouvrage –, il met en scène l’ensemble des contradictions qui travaillent la société égyptienne. Contradictions historiques entre la capitale façonnée à l’image des villes européennes et l’ascension populaire qui inscrit dans l’urbanisme lui-même le mûrissement des contradictions sociales, à l’image du petit peuple cairote qui envahit la terrasse de l’immeuble Yacoubian, s’y installe, s’y marie et y travaille. L’Égypte d’El Aswany est rongée par la corruption et la violence gouvernementale. On y est à la merci du bon vouloir des forces étatiques, à moins de disposer d’une richesse personnelle et d’excellentes relations. Ce qui conduit à l’incompréhension profonde entre la jeunesse et une grande partie de l’élite. À Zaki Bey, qui s’étonne que Boussaïna puisse détester son pays natal, cette dernière rétorque : « Vous ne comprenez pas parce que vos conditions de vie sont bonnes ». Et le poids de l’origine sociale, écrasant, empêche toute espérance, loin de la rhétorique sur l’égalité des chances ou sur les valeurs de l’islam. Ainsi, le hadj Azzam, musulman richissime, est prêt à toutes les ruses pour convaincre sa jeune épouse d’avorter. Face à son refus, il emploie la violence, qui est symétrique à la torture employée par la sécurité d’État à l’encontre de Taha et jette définitivement ce dernier dans les bras des combattants islamistes. Il est frappant de constater combien les romans d’El Aswany et Ben Jelloun sont proches : même désespoir, même corruption, même instants fragiles de bonheur, même dévoiement de la religion au service du pouvoir en place et de la réaction, même volonté d’affronter la question de l’islam politique dans tous ces aspects. C’est ce cercle d’airain de la reproduction sociale que la révolution arabe est venue briser, comme contrepoint et comme confirmation de cette scène de mariage en conclusion du roman, où résonnent la voix de Piaf et les youyous des femmes cairotes !
Warda, Sonallah Ibrahim, Coll Babel, Actes Sud, 10,50 €
Dubaï, Oman, les Émirats arabes unis : ces noms, dans notre imaginaire contemporain, évoquent bien des choses – pétrole, gigantisme immobilier, monarchies de droit divin rétrogrades… – mais certainement pas les images de guérilla paysanne ni de slogans maoïstes. Pourtant, dans les années 1960, ces régions – Yémen, Oman, Palestine – s’embrasèrent. Avec Warda, nous quittons donc les côtes méditerranéennes pour le détroit d’Ormuz et les rives de l’océan Indien, sur les traces des combattants de la guérilla communiste du Dhofar qui se soulevèrent à la fois contre le colonisateur britannique et le sultanat réactionnaire à sa botte. Et ce n’est pas le moindre des mérites de ce roman que de nous rappeler que les peuple arabes se sont déjà soulevés, il y a plus de 40 ans. Au fil des pages de ce roman de facture très classique, nous croisons les grandes figures de l’époque : Nasser, Guevara, Mao, qui dominent les débats des révolutionnaires arabes. En se lançant sur les traces de Warda, militante omanaise et combattante de cette guérilla dhofarie, le narrateur exhume les cahiers dans lesquels elle tint son journal. Elle y commente ses relations, ses attentes, ses espoirs, les théories du Che en matière de guérilla, comme les événements qui bouleversent les pays de la région : Yémen, Égypte, Irak, Palestine, Libye… La lecture de ce roman entre profondément en résonance avec l’époque que nous traversons : à travers les yeux de la jeune femme, nous assistons par exemple aux prises de pouvoir de Kadhafi, Saleh, Assad et Saddam Hussein ! C’est dans les convulsions de ces grands mouvements arabes que ces futurs dictateurs puisèrent leur légitimité, achetant les soutiens et étouffant petit à petit toutes les aspirations populaires. Mais surtout, le parti pris de l’auteur nous conduit à appréhender les tensions et débats autour de la place des femmes à la fois dans la lutte et dans la société, illustrés à travers les mesures prises au Dhofar : réduction de la dot à une dimension symbolique, mariage « civil », scolarisation… Ce choix assumé par l’écrivain d’un point de vue « féministe » sur les événements rend la narration particulièrement captivante.
La Coquille - Prisonnier politique en Syrie, Moustafa Khalifé, Sindbad/Actes Sud, 21,80 €
Ce texte, comme l’indique le sous-titre, est le récit des treize années d’emprisonnement de l’auteur dans les geôles syriennes. Arrêté une première fois en 1979, il est à nouveau appréhendé en 1982 et reste détenu jusqu’en 1994. D’après les informations fournies par la quatrième de couverture, l’auteur militait à cette époque dans un mouvement d’extrême gauche, sans autre précision. Ce récit n’est pas une chronique recueillie sur le vif, ni un journal tenu en prison, pour la simple et bonne raison qu’il n’y avait ni feuille ni stylo dans la vaste prison située en plein désert dans laquelle Khalifé passa toutes ces années avec des milliers d’autres prisonniers politiques, en majorité des hommes soupçonnés d’appartenir au mouvement des Frères musulmans. Pour « tenir son journal », l’auteur utilisa la technique de l’écriture mentale, développée par les militants islamistes : « j’avais réussi à force d’exercice à faire de ma pensée une bande enregistreuse sur laquelle je consignais tout ce que je voyais, et une partie de ce que j’entendais. À présent, je dévide ˝ une partie ˝ du contenu de cette bande ». Il raconte son arrestation, les premiers interrogatoires, l’arrivée dans la prison, la torture et les mauvais traitements, l’hostilité des détenus appartenant aux Frères, l’aide et le soutien que certains Frères lui ont apportés, tout ce qui le conduit à s’enfermer « dans la coquille » : « Avec le temps, une carapace a commencé à se former autour de moi. Une carapace à deux parois : l’une forgée par la haine qu’ils me vouaient (je nageais dans une mer d’aversion, d’exécration et de répugnance, et je luttais pour ne pas m’y noyer) ; une autre par la peur que j’avais d’eux ! » Il structure sa narration comme on rédige un compte rendu, exposant les faits, sans pathos, et composant un formidable document sur le régime syrien et sa répression féroce. Mais il est également un document à charge contre tous ces régimes arabes en voie d’écroulement qui ont pratiqué à grande échelle la torture, l’emprisonnement arbitraire et l’assassinat, avec la bénédiction de tous les régimes démocratiques, l’argument de la lutte contre l’islamisme permettant de cautionner les pires saloperies !
Un Sultan à Palerme, Tariq Ali, J’ai Lu, 6, 70 €Le Myrte et la rose, Annie Messina, Viviane Hamy, collection Bis, 7,50 €
Qu’y a-t-il de commun entre la nièce d’une écrivaine italienne reconnue et un romancier anglais toujours lié à la gauche radicale ? La Sicile. Si la réponse semble incongrue, elle trace néanmoins un lien subtil entre deux romans historiques d’excellente facture. D’un côté, une histoire d’amour masculin tout droit sortie des Mille et une nuits, dont l’argument tient en quelques mots : « un prince va chez un marchand d’esclaves et y découvre un adolescent ravissant qu’il sauve de la castration ». De l’autre, le premier tome de Quintette de l’islam, une série historique conçue par Tariq Ali comme la chronique de sociétés où se produit une rupture d’équilibre. Ce Sultan à Palerme est tout entier consacré à l’implosion de la société sicilienne au mitan du xxe siècle. En s’attachant aux pas du géographe Idrisi1, l’auteur ressuscite cette synthèse fragile entre cultures musulmane et normande. L’attrait principal de ce roman réside dans l’étonnement que suscite l’évocation d’une Sicile musulmane, une image qui a disparu de notre imaginaire, ensevelie sous le poids de la mafia, de ses règles d’honneur sanglantes, de ses allégeances familiales et tentaculaires… Le militant n’est jamais loin du romancier, qui met en scène les dynamiques sociales dans les campagnes, l’affrontement entre propriétaires et travailleurs de la terre, que les valeurs religieuses viennent à la fois combattre et soutenir. Ce premier volume est une réussite, et vient opportunément rappeler combien « les racines chrétiennes de l’Europe » sont une vaste fumisterie ! Il s’agit d’une opération politique d’effacement de tout un pan de l’histoire. Mais ces représentations continuent cependant de travailler notre imaginaire collectif, ce que rappelle pertinemment René de Ceccaty, dans son texte publié en préface du roman le Myrte et la rose : « La civilisation italienne est hantée par les fantômes des Mille et une nuits ». Ce récit est construit comme un conte arabe classique, tout en jouant avec ses thèmes et sa structure formelle. On en retrouve l’ensemble des éléments : histoire d’amour, inimitiés, batailles, longues chevauchées… Cette lecture a le goût de l’évasion, nous projetant loin de notre quotidien, dans une atmosphère de légende. 1. http://classes.bnf.fr/idrisi/pres/idrisi.htm
Aux États-Unis d’Afrique, Abdourahman Waberi, Actes Sud, collestion Babel, 7,50 €
Imaginer un autre monde est un exercice difficile, beaucoup s’y sont déjà cassé les dents. Avec Aux États-Unis d’Afrique, Waberi réussit son pari et nous offre un livre bigarré : un mélange de récit de voyage, d’enquête et de roman d’apprentissage. Comme point de départ, une question toute simple : et si les États-Unis, cette superpuissance dominant le monde, n’étaient pas américains, mais africains ? Et voilà notre monde contemporain cul par-dessus tête. Le narrateur nous invite d’abord à nous intéresser à la situation des immigrés. À l’image de ces grands articles d’investigation qui occupent parfois les pages centrales des journaux, nous nous attachons aux pas d’un certain Yacouba, « caucasien d’ethnie suisse […], né dans une insalubre favela des environs de Zurich », charpentier de son état. L’homme a fui la misère et les guerres ethniques qui ravagent le continent européen. Et comme les autres « traîne-misère caucasiens » qui s’entassent dans les banlieues de Dakar, de Lagos ou du Caire, il espérait une toute autre vie. Ça démarre très fort. Dans les pages suivantes, vous entendrez parler de « l’opération “Un bol de riz à la sauce gombo” » organisée chaque année par les écoliers afin de venir en aide aux civils européens déplacés. Vous verrez également les journaux mettre en accusation le laxisme des autorités en ce qui concerne les flux migratoires et se déchaîner contre le « péril blanc » qui menace de submerger les côtes africaines. Puis vous ferez la connaissance de Maya, jeune artiste pleine d’avenir, qui porte en elle une blessure profonde : enfant, elle a été arrachée à sa terre, quelque part en Europe, et recueillie par un fonctionnaire d’une ONG africaine. Elle voudra retrouver ses racines, panser ses plaies. Elle décidera alors de revoir sa Normandie… La quête de cette jeune femme et la chute de Yacouba sont l’occasion pour Waberi d’entremêler des pans réels de l’histoire de l’Afrique avec les fils imaginaires d’une autre histoire, qui elle n’a jamais existé. Et puis il est porté à chaque page par une ironie corrosive qui ronge tous les clichés racistes. Difficile de résumer ce livre foisonnant tant il échappe aux structures habituelles. Le jeu de l’auteur avec la réalité touche juste et ce texte, publié il y a plus de cinq ans, résonne avec une nouvelle vigueur dans cette France xénophobe livrée aux élucubrations des Sarkozy, Guéant, Hortefeux et autres soutiers du FN regroupés dans la droite populaire. À lire, à relire et à faire lire sans modération.
Au pays des hommes, Hisham Mata, Denoël, 20 €
Que connaissons-nous de la Libye ? Le pétrole, les frappes aériennes, le cirque médiatique de l’opération de sauvetage des infirmières bulgares menée par Cécilia, la mise en scène diplomatique qui tourne à la farce, dans laquelle le colonel aux amazones avait joué le rôle de Monsieur Loyal, humiliant publiquement le régime sarkozyste, en faisant ressortir toute sa nullité. La dimension médiatique conduit cependant à méconnaître les réalités humaines et quotidiennes d’un pays, masquées derrière la figure d’un dirigeant. C’est cette dimension qu’aborde le roman de Matar, dont l’histoire prend place à la fin des années 1970, alors que la vague révolutionnaire – au cœur de Warda – qui a balayé la région au cours des décennies précédentes est en train de s’épuiser. Nous découvrons la Libye de 1979 à travers les yeux d’un enfant au seuil de l’adolescence, Suleiman. Ses journées se passent dans l’ignorance des activités de son père et dans l’observation des fêlures qui apparaissent dans le paisible quotidien familial, alors que le poids du régime se fait de plus en plus sentir. De menus événements – visite d’hommes en armes, arrestation du père d’un ami – viennent perturber l’ordonnancement des jours et des jeux. Le fait de raconter l’histoire du point de vue d’un enfant n’est pas seulement un jeu technique, facilitant la structure narrative – beaucoup de choses restent cachées à un enfant – mais c’est aussi la métaphore d’une « sortie de l’enfance » par la découverte de la réalité d’un régime, de sa violence et de la fin de toutes les promesses d’avenir et de transformation sociale qu’il avait pu susciter à ses débuts.
L’arabe comme un chant secret, Leïla Sebbar, Bleu Autour, 10 €Le Dîwân de la poésie arabe classique, Poésie/Gallimard, 6,70 €
Souvenez-vous : il y a quelques mois à peine, Florent Pagny défrayait la chronique en regrettant que son fils rentre de l’école et se mette à parler « rebeu ». Cette sortie n’était pas seulement l’expression de la bêtise de son auteur, elle était également significative de l’évolution de notre société, où la xénophobie progresse à grand pas. L’arabe, langue poétique par excellence et langue de la transmission de l’héritage philosophique grec, se retrouve vilipendé comme instrument du travail de sape d’une cinquième colonne islamiste fantasmée. Ces deux petits ouvrages sont comme une réponse à cette très nette élévation du niveau moyen de la connerie !
Celui de Leïla Sebbar est composé de textes dispersés, écrits pour des publications diverses, et regroupés par l’éditeur. Elle y revient sur la langue de son père, langue entendue, évocatrice de son enfance en Algérie, mais langue qu’elle n’apprendra pas, et qui crée en elle comme une fracture : « Peut-être divisée, fille du colonisé, mon père, fille du colonisateur, ma mère, depuis le premier jour ». Il s’agit tout à la fois de récits de son enfance, mais aussi d’une réflexion fine et intelligente sur cette matière qui joue un rôle primordial dans la structuration de notre imaginaire. Voici ce qu’elle écrit par exemple sur le mot « nique » : « je l’ai retrouvé de l’autre côté de la mer, déferlant des banlieues où vivent aujourd’hui les fils et petit-fils de ceux qui le criaient vers nous, ils ont quitté le village fertile devenu infertile, ils ont vécu dans les "cités nègres" de la périphérie, après les bidonvilles leurs enfants ont colonisé la langue de la France, quel est le Français jeune ou vieux qui n’a pas entendu ce mot-là, dont la violence sexuelle s’est atténuée en passant de l’Algérie à la France, de la banlieue à la ville ? » Au-delà de cette réflexion pertinente, l’auteure illustre d’une certaine manière combien les évènements en cours influent et influeront sur nos représentations, comment les courants souterrains charrient un grand nombre d’images qui se frayent un chemin dans notre imaginaire, en positif comme en négatif. C’est sur cette dimension que joue le personnel politique, alimentant les peurs et les ressentiments, afin de nier toute familiarité avec celles et ceux que l’on nous désigne comme des ennemis. Leïla Sebbar, quant à elle, fidèle à ses engagements, travaille obstinément ces images, ces mots qui doivent relier les peuples au lieu de les opposer.
Et la lecture des œuvres de langue arabe traduit une étonnante proximité de thèmes et d’image. C’est particulièrement sensible avec la poésie, qui occupe une place quotidienne dans la société arabe sans commune mesure avec ce que nous connaissons en Europe par exemple. Elle dessine bien un territoire humain qui excède toutes les frontières matérielles et administratives. Dans ce volume de la collection Poésie/Gallimard, la préface d’Adonis – poète contemporain syro-libanais – constitue une bonne introduction à la poésie classique. Il en expose de façon concise toutes les richesses et les subtilités : l’érotisme, la rébellion, l’étonnement… Et marqués par les discours réducteurs qui ont envahi l’espace public, nous nous étonnons à notre tour de lire sous la plume du poète Thûma al-Kilâbî : « Que soit bénie l’œuvre de Satan / Si mon amour procède de cette œuvre » – vers qui font immanquablement songer aux Litanies de Satan de Baudelaire. Ou encore, dans la bouche d’Al-Ma’arrî : « La jeunesse est une flamme, hâte-toi de satisfaire / Tes désirs car le temps l’éteint » – et cette fois, c’est Ronsard qui nous vient à l’esprit. La poésie se révèle une arme pertinente contre l’abrutissement généralisé auquel conduisent immanquablement les théories du « choc des civilisations ». En conclusion, je vous livre mes vers préférés, à méditer dans cette période troublée où il est difficile de maintenir le cap et où l’exégèse de nos illustres prédécesseurs ne peut nous donner de réponse toute faite : « À la lumière de nos aïeux nous marchons. / Elle nous éclaire comme les étoiles de la nuit guidant le marcheur ». Ces mots d’Al-Hutay’a auraient pu figurer en exergue des ouvrages de notre camarade Bensaïd !
Une touche de science-fiction : Sukran, Jean-Pierre Andrevon, Folio SF, Gallimard, 7,30 €
Roland Cacciari, le héros de ce roman, est un « démobilisé », un type qui s’est engagé dans l’armée et a participé à une croisade militaire au Moyen-Orient. Il est rentré avec les débris du corps expéditionnaire français, après la dérouillée prise par les troupes occidentales. Alors, avec la crise et le chômage, comme beaucoup de gars comme lui, Roland gagne sa croûte en jouant de la musique à la terrasse des bistrots de Marseille. Tout en essayant d’éviter les mauvais coups. Et puis, à la suite d’une bagarre, c’est l’aubaine : on lui propose un poste de veilleur de nuit dans une grosse boîte spécialisée dans les nouvelles technologies. Un salaire, par les temps qui courent, ça ne se refuse pas, même si le type qui vous le propose n’a pas l’air très réglo… Magouilles, drogues et bastons, dans un Marseille futuriste peu à peu englouti par la montée des eaux et la pollution : voilà les ingrédients d’un bon roman, à cheval entre le polar et la science-fiction. Écrit il y a vingt ans, il n’a pas pris une ride !
Pour finir, une bande dessinée : Les Mohamed, Jérôme Ruillier, Sarbacane, 25 €
Cette bande dessinée arrive à point nommé : publiée au mois d’avril dernier, elle vient opportunément rappeler la place de l’immigration dans le quotidien français (« étroitement imbriquée avec l’histoire et l’économie de la France »), cela à un moment où le gouvernement agite en tous sens l’épouvantail de la déferlante migratoire qui ferait suite aux révolutions arabes. L’auteur fait d’ailleurs explicitement référence aux discours xénophobes dès les premières pages : « Il y avait quelque chose dans l’air… ça revenait par vagues, inlassablement… il faut toujours des boucs émissaires… pour réveiller en nous ce qu’il y a de pire… à cause de notre ignorance ». Pour comprendre, pour résister, il se replonge dans le livre de Yamina Benguigui, qui avait fait suite à son documentaire Mémoires d’immigrés. La réalisatrice signe d’ailleurs la préface de l’ouvrage. Celles et ceux qui connaissent ce documentaire retrouveront sa structure formelle, en particulier le découpage en trois parties (les Pères, les Mères, les Enfants) et l’effacement du narrateur devant les témoignages. Ce n’est donc pas tant sur le fond que réside l’originalité de cette bande dessinée que sur le ton et le style adoptés par Ruillier. Entre la mise en dessin des témoignages, l’auteur intercale ses réflexions et certaines scènes de son quotidien : la scolarisation de sa fille Sara, trisomique, ses rencontres avec les parents d’élèves à la sortie de l’école, dont bon nombre sont « issus de l’immigration », son rapport à son père, qui était dans l’armée en Algérie au moment de la guerre… Tous ces éléments servent de contrepoint au travail documentaire, et viennent l’enrichir, tout en en démontrant l’importance et la portée – comme quand l’auteur raconte une soirée de témoignages en Isère à laquelle il a assisté, et où un vieil homme confie : « Si un jour on m’avait dit que des Français se déplaceraient pour m’écouter parler… je ne l’aurais jamais cru ! ». Et plane dès les premières planches l’ombre d’un grand bonhomme noir et menaçant, incarnation de ces peurs redoutables tapies dans les recoins de la société, ces monstres qui profitent du sommeil de la raison. L’ensemble est porté par un choix graphique audacieux, qui peut déconcerter dans les premières pages ; loin de tout réalisme, l’auteur adopte un trait « naïf », qui peut faire penser aux dessins d’enfants au crayon à papier : des bonshommes et des bonnes femmes dans une structure graphique très épurée. Et tout d’un coup, il devient possible d’aborder l’ensemble de ces questions avec des enfants, de suivre avec eux les histoires de ces hommes et de ces femmes qui d’ailleurs sont d’ici ! Livres à commander à la librairie La Brèche, 27 rue Taine 75012 Paris - www.la-breche.comTél. : 01 49 28 52 44 - Fax : 01 49 28 52 43Port offert avec cet article. Préciser nom et adresse, merci. En complément de cette sélection de romans, des dossiers sur les révolutions arabes ont été publiés dans Tout est à nous ! la revue n° 18, janvier 2011 (4 euros) et Tout est à nous ! la revue n° 20, avril 2011 (4 euros). Vous pouvez vous les procurer en envoyant un chèque à l’ordre de NSPAC à : Tout est à nous !, 2, rue Richard-Lenoir, 93108 Montreuil Cedex.Par ailleurs, le dernier numéro du mois de juillet de Tout est à nous ! hebdo sera tout entier consacré aux révolutions arabes. Il sortira le 28 juillet 2011. À ne pas manquer !