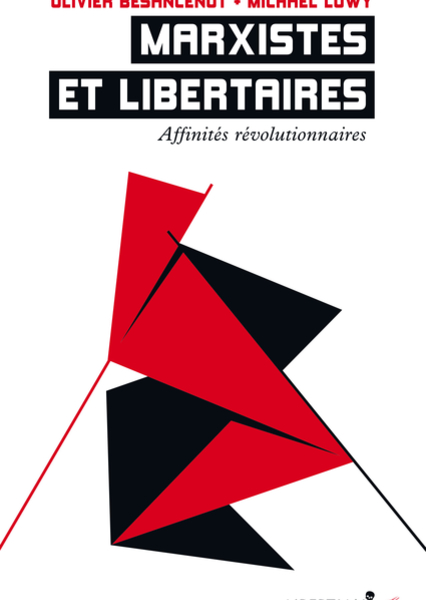Éditions Libertalia, 2025, 224 pages, 10 euros.
Les affinités révolutionnaires (le sous-titre) sont au cœur de ce que cherche à documenter et à réfléchir le livre d’Olivier Besancenot et Michael Löwy. Disons-le d’emblée, c’est un livre important. Il l’était déjà à sa première publication, il y a une dizaine d’années, aux éditions Mille et Une Nuits.
Sortir le livre du catalogue de cette maison, propriété du groupe Fayard tombée depuis dans l’escarcelle de Bolloré, était en soi un geste politique. Cette seconde édition enrichie et publiée aux éditions Libertalia en est un autre.
Ce qui rassemble
Parce que chercher à voir et à trouver ce qui rassemble est sans doute bien plus exigeant et prometteur que de cultiver sa distinction, pire encore, son sectarisme. Puisque marxistes et libertaires, en plus d’une origine commune forgée au cœur du mouvement ouvrier, ont bel et bien des affinités.
Elles sont regardées au feu des événements dans deux chapitres/mouvements : « convergences solidaires » et « convergences et conflits ». Le premier va de la Première Internationale et la Commune de Paris à nos jours ; le second — on s’en doutera — s’attarde sur la Russie de 1917-1921. Ici, les auteurs ne se dérobent pas : la répression de Cronstadt n’est pas une « tragique nécessité », c’est « une erreur et une faute ». Il fallait que ce soit dit, non pour l’histoire mais pour le présent : car c’est de la défense acharnée de la démocratie dont il est question.
Libertaires, marxistes, un peu des deux
Deux autres chapitres croisent ces deux-là. Ils sont dédiés à des portraits d’hommes et de femmes, de figures libertaires, marxistes… et même un peu des deux à la fois. Après tout, les frontières sont-elles si étanches que cela ? Il y a certes des filiations. Elles s’incarnent dans des expériences transmises, dans des formulations théoriques et stratégiques, dans des organisations évidemment — dont on se revendique et qui sont une histoire vivante, celle de courants révolutionnaires tels qu’ils se sont cristallisés au siècle passé. Des éthos militants aussi, le livre ne l’évoque pas mais il y aurait à dire.
Mais — et c’est l’objet du dernier chapitre — il est aussi de grandes questions politiques partagées. Celles auxquelles on se heurte, on se confronte : le pouvoir, la démocratie et l’État ; la planification et l’autogestion ; le rapport du politique au social. Humbles devant l’histoire, personne ne peut se targuer aujourd’hui de réponses toutes faites et déjà là. Daniel Guérin voyait dans son marxisme libertaire un « point de ralliement vers l’avenir ». C’est cette démarche, ouverte et sincère, à laquelle aspirent et nous invitent les auteurs dans ce livre-jalon.
Théo Roumier