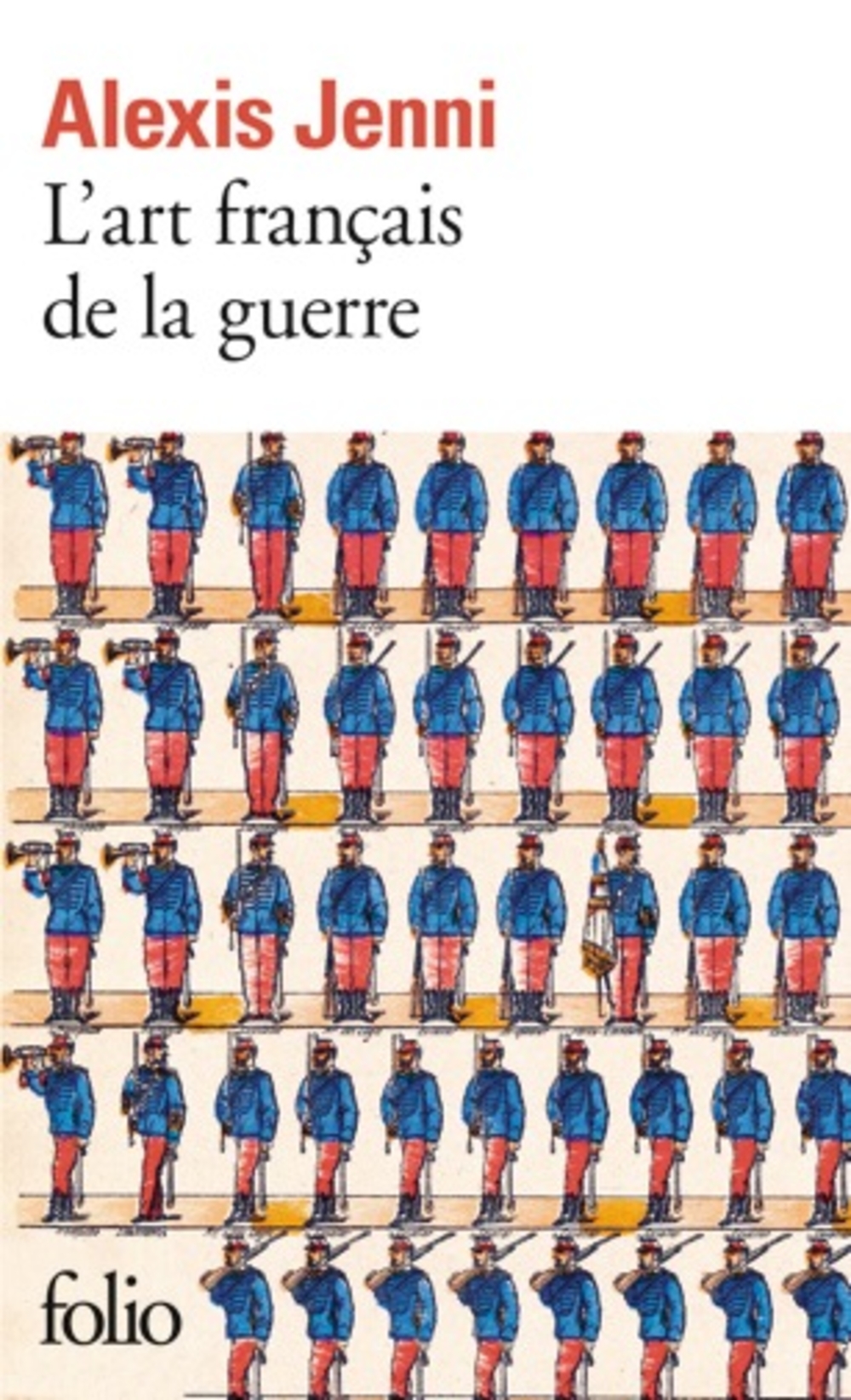L’art français de la guerre, prix Goncourt 2011, est un ouvrage volumineux qui peut rebuter au premier abord. L’auteur a fait le pari de faire tenir dans ses quelques centaines de pages une vaste chronique des principales guerres françaises – de la Résistance à la première guerre d’Irak, en passant par l’Algérie et l’Indochine – et de leurs répercussions sur notre imaginaire.
Pinceaux et fusils
L’ensemble de l’ouvrage s’articule autour de deux points de vue : celui du narrateur, qui se révèle tout d’abord rébarbatif, tout occupé à maquiller des arrêts maladie pour se complaire dans son désœuvrement. Oisif, l’homme traîne dans les cafés, espérant parvenir à écrire et souhaitant par-dessus tout peindre. C’est dans un bistrot qu’il fait la connaissance de Victorien Salagnon, le second personnage, jeune résistant devenu parachutiste qui a traîné son barda dans les enfers indochinois et algérien. Le premier mettra en forme les mémoires du second, qui lui apprendra en retour à maîtriser l’art du pinceau.
L’une des véritables réussites de l’auteur tient dans la continuité qu’il met en scène, grâce au parcours de Salagnon, entre les combats de la Résistance et de la Libération, et les deux guerres qui vont suivre. Les longues parties qui constituent la biographie du parachutiste sont véritablement captivantes. Il y a de très belles pages sur les opérations dans la jungle d’Indochine, ou sur les logiques implacables de la collecte de renseignements à Alger – pages reliées les unes aux autres par le fil rouge, discret, de l’Odyssée, qui est devenuela passion de l’oncle de Salagnon. Celui-ci s’est mis en tête de l’apprendre par cœur et traîne son volume partout avec lui. Ainsi, à travers un subtil jeu d’échos et de références, entre écriture et peinture, entre Homère et Sun-Tzu – deux monuments de la littérature mondiale dont les œuvres sont remplies du fracas des batailles –, l’auteur parvient à donner une véritable densité à son récit.
Au-delà de la chronique des guerres coloniales, Alexis Jenni s’efforce d’appréhender la situation contemporaine. Ses tentatives, lors des intermèdes consacrés au narrateur, de tracer des parallèles entre ces guerres coloniales et la montée de l’extrême droite sont, quoique pour certaines malhabiles, plutôt bien senties. Le compagnon d’armes de Salagnon, à la retraite comme lui, campe un militant d’extrême droite fort convaincant. A la tête de son groupe local, les GAFFES, il a fortifié un appartement et s’occupe, dans l’ombre d’une municipalité, des aspects techniques de la reprise en main des fameuses « zones de non-droit ».
Fiction et politique
Ce gros roman est donc un très beau travail littéraire. Le lecteur, a fortiori disposant de références politiques, en ressortira toutefois avec une impression étrange. En effet, certains développements du narrateur sont consacrés à la question de la gauche, prise dans son sens général. Par moment, on sent poindre une critique des idées de gauche, quelque chose qui ressemblerait à une forme de « vallsisme » avant l’heure. Le narrateur insiste pourtant fortement sur l’illusion et l’absence de matérialité des concepts liés à la race. Il ajoute même qu’au fond, ce sont bien des questions sociales qui sont en jeu. Pour autant, il tente de nous englober dans certains développements très hasardeux – au cours desquels, par exemple, il résume la politique de gauche comme un refus de participer. Ce faisant, l’auteur fait disparaître tout un pan de la gauche qui ne s’est pas abstenu face aux aventures coloniales mais a pris position, s’est engagé, dans certains cas a combattu. Les militantEs révolutionnaires y ont pris leur part, avec d’autres, avec l’espoir de faire changer la société. Quelques ouvrages récents sont d’ailleurs l’occasion de faire le point sur ces aspects, tels que Le mur, le Kabyle et le marin, de Varenne, ou encore, Dans la nuit, la liberté nous écoute, de Le Roy1.
Mais une fois qu’il a décrit ces questions, qu’il y a réfléchi, le narrateur retourne à son oisiveté, certes mieux mise à profit au terme de ces 700 pages : Salagnon lui a appris à peindre et il a enfin trouvé l’amour. On ne peut s’empêcher d’être surpris, en conclusion, par la désinvolture de cet homme qui, après de brillants raisonnements et des parallèles appuyés entre guerres coloniales d’hier et maintien de l’ordre d’aujourd’hui, se retire auprès de son amante en laissant la totalité du champ libre à l’extrême-droite !
Henri Clément
1 Voir Tout est à nous ! La Revue, n° 27, décembre 2011