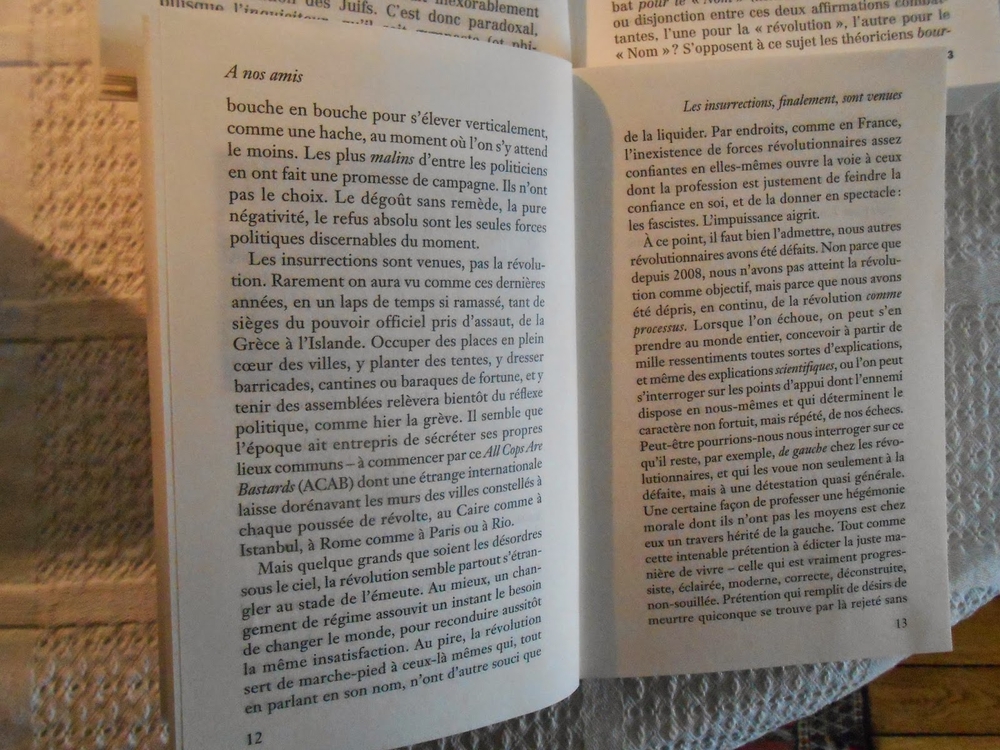Quelques remarques à partir d’A nos amis du Comité invisible (La Fabrique, 2014)
En voie d’être traduit dans plusieurs langues, A nos amis s’annonce comme un prolongement de L’insurrection qui vient, paru en 2007. Comme ce dernier, il a d’ailleurs immédiatement rencontré un succès, en termes de ventes mais aussi d’influence dans les milieux radicalisés, succès qu’on ne saurait réduire à la publicité qui lui a été faite dans les grands médias.
De même, se contenter de regretter l’arrogance, le sectarisme ou le pédantisme de ce livre, c’est oublier son grand mérite : prendre au sérieux la question du basculement révolutionnaire. D’autant plus qu’A nos amis a d’indéniables qualités, non seulement stylistiques, mais surtout théoriques et politiques, qui le situent bien au-dessus, de ce point de vue, de L’insurrection qui vient ou encore de Premières mesures révolutionnaires (2013), dont nous avions fait la critique dans ces colonnes1. C’est pourquoi on préférera ici se contenter de quelques remarques à partir du livre plutôt que de s’engager dans un compte-rendu critique qui aurait supposé un texte beaucoup plus long2.
Des questions pertinentes
Nous ne comptons certainement pas parmi les amis auxquels le Comité invisible souhaite s’adresser, non seulement parce nous demeurons résolument attachés à une critique et à une perspective politique marxistes, rudement attaquées dans ce livre3, mais aussi parce que nous nous sommes régulièrement opposés, dans les mouvements sociaux depuis le début des années 2000, à des groupes se réclamant d’idées proches de celles formulées dans L’insurrection qui vient. Et pourtant À nos amis nous parle, à nous aussi, parce qu’il développe une critique aiguë du monde capitaliste, s’interroge sur notre impuissance à peser sur le cours des choses – ce « nous » ne renvoyant évidemment pas au seul NPA – et ouvre des débats stratégiques qu’on aurait tort de balayer d’un revers de main. Comment caractériser ce monde et les structures de pouvoir qui nous condamnent, du moins jusqu’à maintenant, à l’impuissance ? Comment nous organiser pour en finir avec cette impuissance face aux pouvoirs économique, politique, médiatique, etc. ?
Ces questions nous concernent et il nous faut les reprendre. A nos amis s’ouvre d’ailleurs sur une prémisse – ou plutôt une énigme – qui pourrait être la nôtre : « Les insurrections sont venues, pas la révolution. Rarement on aura vu comme ces dernières années, en un laps de temps si ramassé, tant de sièges du pouvoir officiel pris d’assaut […]. Mais quelque grands que soient les désordres sous le ciel, la révolution semble partout s’étrangler au stade de l’émeute. Au mieux, un changement de régime assouvit un instant le besoin de changer le monde, pour reconduire aussitôt la même insatisfaction. Au pire, la révolution sert de marchepied à ceux-là mêmes qui, tout en parlant en son nom, n’ont d’autre souci que de la liquider. […] A ce point, il faut bien l’admettre, nous autres révolutionnaires avons été défaits. Non parce que depuis 2008, nous n’avons pas atteint la révolution comme objectif, mais parce que nous avons été dépris, en continu, de la révolution comme processus » (p. 12-13).
En d’autres termes, l’histoire récente a rouvert le chapitre des soulèvements populaires – que les prophètes de la « fin de l’histoire » s’étaient empressés de clore alors que s’effondraient les dictatures bureaucratiques composant le bloc dit « communiste » – mais aucun des processus amorcés depuis 2008, de l’Egypte à la Tunisie en passant par la Grèce ou la Syrie, n’est pour l’instant parvenu à arracher les racines de l’oppression, à démanteler les appareils répressifs d’Etat et à briser les dispositifs de pouvoir qui assurent la soumission du plus grand nombre. Comment expliquer ces défaites à répétition ? S’il est vrai qu’une crise pré-révolutionnaire ne peut se muer en processus révolutionnaire sans qu’émerge une force – un parti – capable de rendre irréversible le nouveau cours, de prendre des initiatives hardies et d’accélérer ainsi la transformation, le problème se trouve déplacé : pourquoi de telles forces révolutionnaires n’ont-elles pas jailli des processus en question (du moins pour l’instant) ?
Ni table rase, ni simple répétition
Il est vrai que, vu de la France de décembre 2014, la situation paraît passablement différente et la question d’une moindre actualité, tant la démoralisation vient tempérer la colère populaire pour n’en faire qu’une défiance généralisée mais passive, bien faite pour favoriser l’extrême-droite. Mais reportons-nous au contexte du mouvement social de 2010 contre la réforme des retraites qui a mobilisé des millions de travailleurs et de jeunes : alors que ne manquaient pas les militants ou les groupes révolutionnaires intervenant dans ce mouvement, et alors que se manifestait du côté des travailleurs une forte disponibilité pour la lutte, aucun saut qualitatif n’a pu être accompli dans la mobilisation : nous n’avons pas obtenu le retrait du projet, ni a fortiori la chute d’un gouvernement et d’un président pourtant honnis, sans même parler d’une situation de double pouvoir... Pire, le NPA – qui n’a pas ménagé sa peine durant ce mouvement, défendant le juste mot d’ordre d’une grève générale et reconductible – n’y a rien gagné, bien au contraire, subissant plus que d’autres les effets de la défaite sous les formes de l’abattement, de la désorientation ou de la division.
C’est pourquoi il faut recommencer, en renonçant aux tentations croisées de la table rase et de la répétition monotone de positions ou de débats usés jusqu’à la corde : renouveler une boussole ajustée au monde tel qu’il s’impose à nous, et non fixer une fois pour toutes un itinéraire. Or A nos amis, malgré d’importantes limites sur les questions de l’Etat, de l’organisation ou de la démocratie, peut nous aider à secouer le joug de certaines évidences. Prenons la crise : nous avons tant insisté sur le fait qu’elle est le produit des contradictions insolubles du système capitaliste que nous avons parfois décrété trop vite une crise d’hégémonie du néolibéralisme et postulé l’automaticité de révoltes contre les politiques d’austérité. A nos amis rappelle opportunément que « la crise » fonctionne depuis 2008 comme « une technique politique de gouvernement », avançant l’hypothèse suivante : « la crise présente, permanente et omnilatérale, n’est plus la crise classique, le moment décisif. Elle est au contraire fin sans fin, apocalypse durable, suspension indéfinie, diffèrement efficace de l’effondrement effectif, et pour cela état d’exception permanent » (p. 25).
Economisme et oubli de l’économie
Tordant le bâton dans l’autre sens par rapport à l’économisme, les auteurs rendent visible l’usage politique que les classes dominantes font de la crise de leur propre système pour tenter de rétablir le taux de profit en approfondissant la marchandisation du monde, en accroissant l’intensité de l’exploitation et en remettant en question les conquêtes du mouvement ouvrier (services publics, sécurité sociale, retraites, conventions collectives, etc.). Si c’est bien en dernière instance la crise du capitalisme qui crée les conditions de possibilité, nécessaires mais non suffisantes, de révoltes sociales et de bouleversements politiques4, ce qu’oublient les auteurs d’A nos amis, les cycles de mobilisation et de politisation sont souvent loin de coïncider avec les cycles économiques. Pour que s’engage un processus révolutionnaire, il importe non seulement qu’une étincelle mette le feu à la plaine mais également que cette plaine ait été rendue inflammable par des luttes de classe d’ampleur et que se mettent en action des forces collectives ayant la volonté consciente d’en finir avec l’ordre existant, capables de donner une consistance politique et une portée de masse à une idée simple : la vie qui nous est faite ne mérite pas d’être vécue.
Autre point fort du livre : l’insistance sur la nécessité, pour les révolutionnaires, de mettre en avant et en pratique(s) une certaine idée de la vie et du bonheur fondée sur le fait d’agir en commun, de produire du collectif et de prendre nos affaires en main, au-delà de (nécessaires) revendications matérielles et d’une opposition aux mesures qui aggravent les conditions d’existence des classes populaires. Dans la mesure où le capitalisme engendre la concurrence et généralise la séparation, fondant sa survie moins sur la répression permanente que sur la séparation généralisée, le simple fait d’être et de faire ensemble, même dans le cadre d’une lutte défensive contre la fermeture d’une usine, la création d’un aéroport, la destruction d’un parc en centre-ville ou la hausse des prix des transports, porte une potentialité anticapitaliste, sinon révolutionnaire. Si le renforcement de la conscience de classe ne procède pas d’une simple diffusion d’idées mais de la lutte des classes elle-même, c’est-à-dire des combats menés en commun, c’est d’abord à construire des cadres collectifs, indépendants des classes dominantes et de l’Etat, qu’il faut consacrer notre énergie.
L’auto-organisation ne saurait donc constituer un outil parmi d’autres dans l’arsenal des révolutionnaires : il ne s’agit pas seulement d’un moyen opportun d’accélérer la mise en crise du système, par le blocage concerté des échanges et des flux5, ou d’un instrument fonctionnel de prise en charge des besoins élémentaires lorsque cette dernière n’est plus assumée par l’Etat (comme en Syrie dans les zones libérées). Favoriser partout l’auto-organisation, entretenir avec soin la puissance commune qu’elle fait naître et acquérir la confiance collective qu’elle suppose, voilà ce qui – ici et maintenant – devrait constituer un objectif pour les révolutionnaires et leurs amis…
Ugo Palheta
Notes
1 « Vers un retour de la question révolutionnaire ? », L’Anticapitaliste n° 49, décembre 2013.
2 Voir J. Confavreux, « Comité invisible : la révolution au XXIe siècle », Mediapart, 30 octobre 2014.
3 Les marxistes auraient découvert tout récemment l’ancrage territorial des grèves et luttes sociales (p. 188-189), ils ne comprendraient pas que « le processus de valorisation de la marchandise […] coïncide avec le processus de circulation » (sic, p. 92), etc. On ne peut d’ailleurs manquer de s’étonner que de telles attaques cohabitent avec la critique de « la texture mauvaise des milieux radicaux : chaque petite entreprise groupusculaire croit bêtement, engagée qu’elle est dans une lutte pathétique pour de minuscules parts de marché politique, qu’elle sortira renforcée d’avoir affaibli ses rivaux en les calomniant. C’est une erreur : on gagne en puissance en combattant un ennemi, non en l’abaissant » (p. 237). On ne saurait mieux dire !
4 Cela est vrai en Grèce ou en Espagne mais aussi en Egypte, en Tunisie ou en Syrie, même si, dans ces derniers pays, c’est moins le capitalisme en soi qui est entré en crise qu’une modalité du capitalisme. Sur ce point, voir G. Achcar, « Le Peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe », Paris, Actes Sud, 2013.
5 Voir le chapitre intitulé « Le pouvoir est logistique. Bloquons tout ! » (p. 81-99).