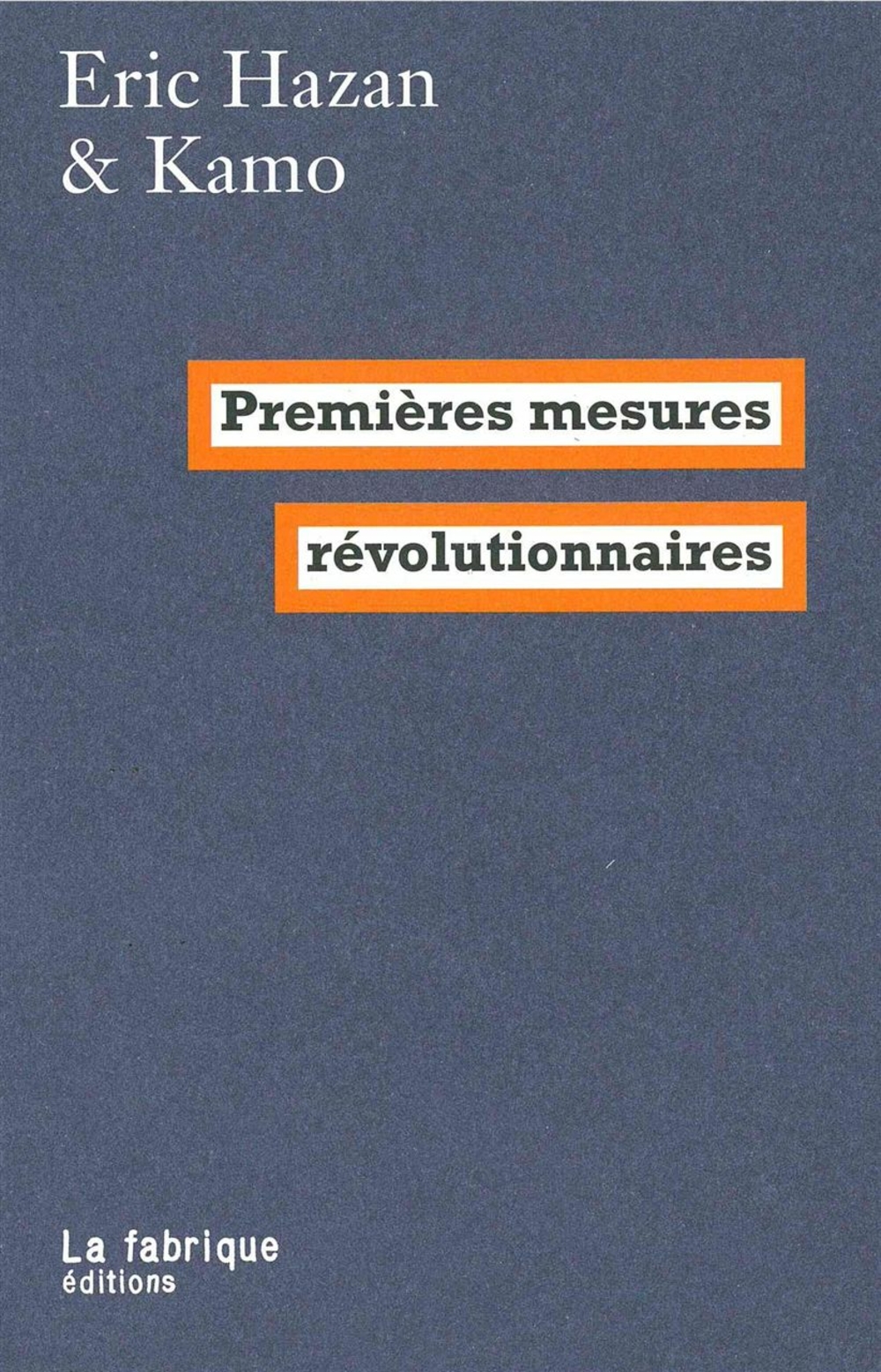Eric Hazan et Kamo, Premières mesures révolutionnaires, Paris, La Fabrique, 2013, 116 pages, 8 €.
Il est au moins deux manières de juger le livre Premières mesures révolutionnaires que viennent de faire paraître Eric Hazan (propriétaire des excellentes éditions La Fabrique) et Kamo1.
On peut insister sur la vigueur salutaire de l’appel à s’organiser pour rompre avec l’ordre existant et à reposer la question révolutionnaire, en un moment où la triple crise du capitalisme – économique, politique et écologique – remet à l’ordre du jour l’alternative entre communisme et barbarie. Mais on ne saurait passer sous silence les limites de cet ouvrage, qui ne fait qu’effleurer les problèmes stratégiques auxquels sont confrontés celles et ceux qui – ici et maintenant – prennent parti et luttent pour changer le monde.
S’il en est ainsi, c’est que la volonté de ne pas se satisfaire de réponses prémâchées à la question révolutionnaire est aussi à l’origine de la principale faiblesse de l’ouvrage. En effet, à ne pas prendre au sérieux les débats stratégiques du 20e siècle, ouverts notamment par la Révolution russe, on risque de reconduire sans le savoir les erreurs commises lors des situations révolutionnaires du passé, ne serait-ce que la sous-estimation des dangers divers qui guettent toute révolution : dégénérescence bureaucratique, contre-révolution, montée de courants fascistes, etc.
Si la volonté de « trouver de nouveaux points d’appui » (p. 8) est non seulement louable mais nécessaire, encore faudrait-il préciser ce qui, dans les doctrines et mouvements révolutionnaires passés, doit être abandonné et ce qui, à l’inverse, conserve pour nous une actualité. A défaut, le spectre des échecs passés a toutes les chances de ressurgir sous la forme d’une incapacité à nous orienter dans les situations révolutionnaires à venir.
Plusieurs points centraux de cet ouvrage doivent donc être critiqués, qui concernent aussi bien l’analyse de la situation sociale et politique dans laquelle nous nous trouvons que l’orientation nécessaire à ceux et celles qui aspirent à rompre avec le capitalisme et à construire une société tout autre, « où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous » (Marx et Engels).
Rôle et poids de l’idéologie dominante
Tout d’abord, si l’on suit les auteurs de l’ouvrage, l’ordre existant est si affaibli et son existence si précaire qu’il ne tient pour ainsi dire sur rien d’autre que la violence et la coercition (« il a renoncé à tout argument, hormis celui de la force » est-il écrit en quatrième de couverture). Les peuples n’auraient en effet plus guère d’illusions à l’égard du système qui les opprime et des justifications qu’en donnent économistes, experts et autres éditocrates : « leurs boniments (…) ne suscitent que moqueries » (p. 20).
Que les idées des classes dominantes ne soient pas accueillies passivement par des individus aveugles, c’est l’évidence. L’idéologie dominante n’est jamais toute-puissante, mais elle est dominante en ce sens qu’elle parvient à entraver l’expression politique autonome des classes dominées et à faire passer pour évidentes les catégories de l’économie bourgeoise (pensons aux mystifications relatives au « coût du travail », au « trou de la Sécu » ou à la prétendue nécessité de rembourser la « dette publique »).
En effet, dans les consciences de chacun cohabitent presque toujours l’adhésion à des pans entiers de l’idéologie dominante, et la mise à distance – par l’ironie ou la critique – du discours patronal. C’est pour l’essentiel le niveau et l’issue des luttes sociales qui, en définissant le rapport de forces politique et idéologique entre les classes, va déterminer les flux et les reflux de la conscience, soit dans le sens d’une pénétration des idéologies dominantes, soit au contraire vers une prise de conscience par les classes dominées de leur capacité à secouer le joug qui les opprime.
En lien avec le diagnostic pour le moins « optimiste » qu’ils formulent, les auteurs succombent à un catastrophisme prophétique bien fait pour disposer à l’inaction. Nous serions ainsi à deux doigts d’une « évaporation du pouvoir » (p. 31), d’un « écroulement de l’appareil de domination » (p. 36), ou encore d’un « évanouissement de l’appareil d’Etat » (p. 56). A quoi bon, en ce cas, s’organiser, se coordonner et se mobiliser si le système a toutes les chances de s’effondrer de lui-même, par la conjonction et l’amplification de ses propres contradictions ?
Appareils d’Etat et coordination inter-capitaliste
En outre, il suffit d’avoir en tête les luttes massives menées par les opprimés dans plusieurs pays d’Europe ravagés par les politiques d’austérité depuis l’éclatement de la crise financière (Grèce en tête), pour s’apercevoir que d’« évaporation », d’« écroulement » ou d’« évanouissement », il n’est nullement question. L’ordre du jour est bien davantage à la construction de mouvements capables d’opposer un pouvoir populaire aux classes dominantes, organisées dans le cadre des Etats nationaux, de l’Union européenne et des organisations internationales.
Si les appareils d’Etat ne se sont nullement effondrés et que les économies ne s’écroulent pas totalement, c’est que les classes dominantes ont appris des crises précédentes, et notamment de la crise de 1929. Non seulement les effets de la crise sont atténués par ce qui reste des systèmes de protection sociale conquis par les mouvements ouvriers, mais le niveau de coordination des politiques économiques s’est considérablement renforcé entre les puissances capitalistes par rapport aux années 1930, comme se sont perfectionnés les moyens de persuasion douce et de surveillance étroite dont disposent les Etats.
Les effets politiques de la récession ont donc pu être atténués et ne se sont nullement accompagnés, du moins pour l’instant, d’un effondrement des Etats, ni même des partis dominants qui ont pourtant tout fait pour que cette crise de leur système soit surmontée sur le dos des travailleurs. Comment peut-on d’ailleurs imaginer que les classes dominantes laisseraient se décomposer les Etats, instruments décisifs dans les situations où leur pouvoir est mis en cause à une échelle de masse ? Plus que jamais, on ne saurait compter sur une « évaporation du pouvoir » qui nous exonèrerait d’un combat politique pour faire une autre société.
Autant dire que l’analyse des situations révolutionnaires et du pouvoir n’est qu’ébauchée par les auteurs. C’est notamment qu’ils tendent à réduire la révolution comme processus, dont on sait combien il s’avère chaotique2, passant par des phases d’euphorie (illusions lyriques des débuts), des coups d’arrêt puis de brusques remontées, à la révolution comme moment, c’est-à-dire comme insurrection. L’insurrection elle-même, pourtant invoquée sans cesse par les auteurs, n’est jamais pensée en tant que telle, c’est-à-dire comme assaut armé du pouvoir d’Etat, avec les problèmes d’ordre quasi militaire que poserait une telle prise d’initiative ; si bien que la référence à l’insurrection fait davantage figure d’évocation littéraire que de perspective stratégique.
« Supprimer » la transition ?
Les auteurs insistent ainsi sur la nécessité de se défaire de l’idée d’une « période de transition […] entre l’ancien régime et l’émancipation en actes » (p. 35). Comme si cela dépendait de la seule volonté des révolutionnaires, et non des rapports de forces, parfois défavorables, qui s’imposent à eux en divers moment du processus révolutionnaire ! Nulle raison de penser une situation potentielle de transition, voire même de double pouvoir (où coexistent et s’affrontent pouvoir populaire et pouvoir d’Etat), dès lors qu’on postule une « évaporation » du pouvoir des classes dominantes. De même, ni la menace d’une contre-révolution ni celle d’une dégénérescence bureaucratique de la révolution ne sont évoquées (et encore moins analysées).
Toute l’histoire des révolutions passées démontre pourtant, et de manière dramatique, ce qu’il en coûte de succomber à l’illusion d’une résolution automatique, au lendemain de l’insurrection, de ces deux problèmes fondamentaux. Si l’on ne saurait se prémunir, préventivement et une fois pour toutes, des dérives bureaucratiques comme des périls contre-révolutionnaires, s’y préparer collectivement est la moindre des précautions que peuvent prendre, dès maintenant, ceux et celles qui aspirent à transformer radicalement la société.
Si les auteurs peuvent s’épargner le problème de la transition, c’est qu’ils se sont débarrassés par avance de la question du pouvoir, en postulant l’« évanouissement » spontané des structures de pouvoir propres à la société capitaliste. Mais c’est aussi qu’ils s’en tiennent à des réponses beaucoup trop vagues quant aux formes d’organisation et aux modes de décision qui pourraient émerger d’un processus révolutionnaire. Invoquant des « groupes de travail » formés sur la base du volontariat, qui auraient notamment pour tâche la résolution des problèmes hérités de la société passée (le démantèlement des centrales nucléaires par exemple), ils n’envisagent à aucun moment que ces groupes puissent être investis, et détournés de leur vocation première, par des adversaires de la révolution.
Plus généralement, les auteurs ne pensent à aucun moment la manière dont les organes démocratiques de lutte que se donnent les classes dominées au cours même du processus révolutionnaire pourraient constituer l’embryon d’un nouveau pouvoir public, capable à la fois de briser les tentatives de contre-révolution et de jeter les bases d’une société nouvelle. Enfin, pour quiconque s’interroge sur ce qu’il importe de faire dans l’immédiat, la réponse proposée par Hazan et Kamo – « faire évoluer ces groupes [en révolte] en constellations subversives par le jeu des amitiés, des espoirs partagés, des luttes menées en commun, de proche en proche » – ne pourra paraître qu’insatisfaisante.
Ugo Palheta
Notes :
1 A noter que ce pseudo est emprunté à un militant proche dans sa jeunesse de Staline et responsable de braquages visant à renflouer les caisses du parti bolchevique.
2 Voir : G. Achcar, Le peuple veut, Paris, Actes sud, 2013.