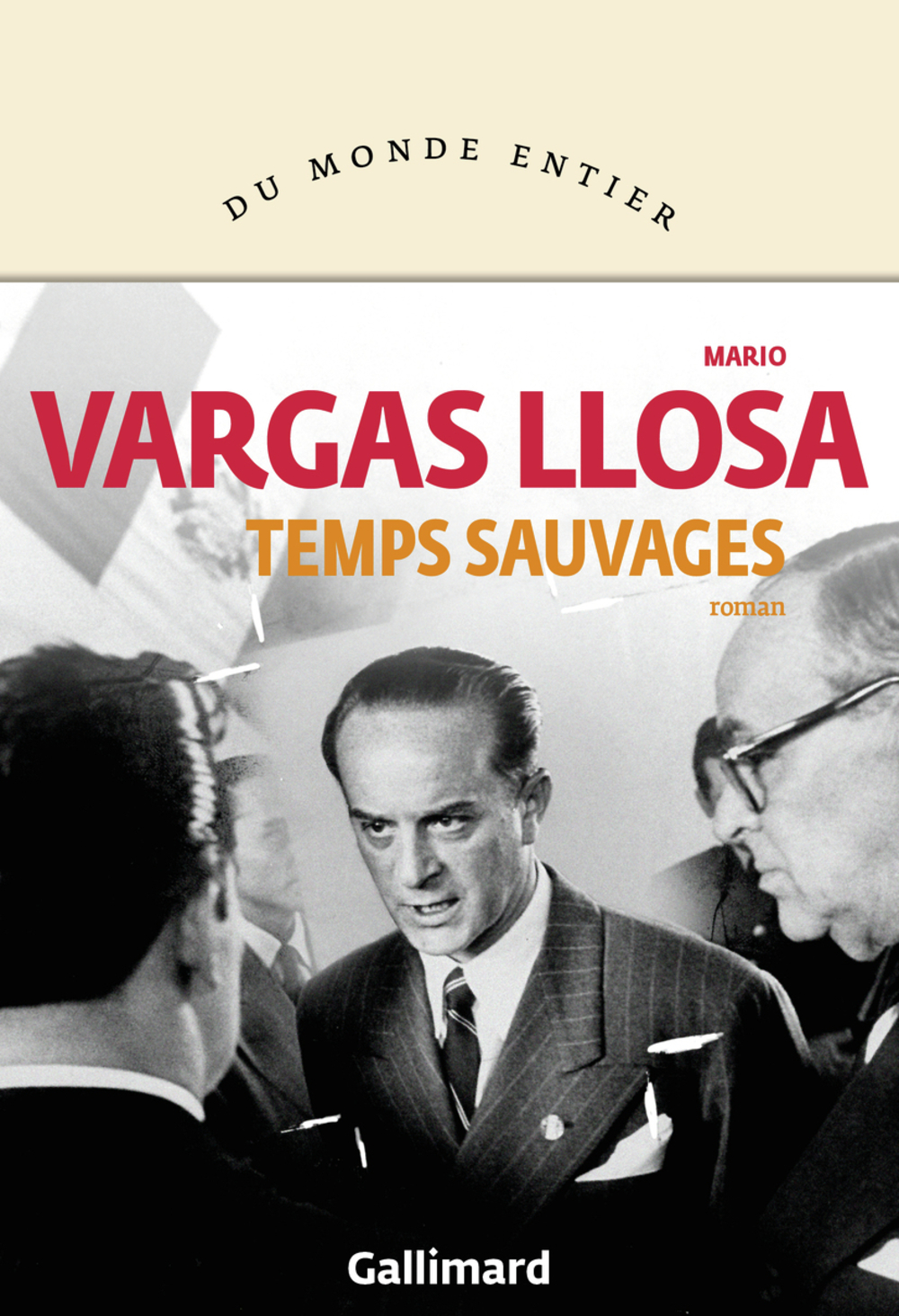Gallimard, 400 pages, 23 euros.
À la fin de sa jeunesse péruvienne proche de la gauche communiste, le romancier Mario Vargas Llosa est devenu un néolibéral et conservateur patenté, lié aux cercles réactionnaires nord-américains et européens. Mais, en plus d’être un écrivain de talent, il est loin d’être un imbécile dépourvu de capacités d’analyse.
Le spectre du communisme
C’est ce que montre son dernier roman dont l’un des éléments centraux est le coup d’État militaire organisé en 1954 par les États-Unis pour chasser du pouvoir le président démocratiquement élu du Guatemala Jacobo Arbenz qui a eu le grand tort de prendre des mesures qui remettent en cause les privilèges du géant étatsunien de la banane, la United Fruit Company, à laquelle le dictateur Jorgé Ubico avait concédé des avantages considérables (cession de centaines de milliers d’hectares de terres publiques, exemptions fiscales, pleins pouvoirs sur les salariéEs agricoles). Ubico a été renversé par un mouvement populaire démocratique en 1944 et c’est Juan Arévalo qui a été élu en 1945, prenant quelques mesures sociales en faveur de la paysannerie et autorisant (avec des limites) le syndicalisme. La United Fruit commence à s’alarmer et lance en sous-main une campagne de presse pour discréditer Arévalo comme ouvrant la voie à une communisation du Guatemala. Les dirigeants de la société savent que c’est faux (Arévalo n’a rien contre les États-Unis et ne veut que démocratiser un pays dominé par une aristocratie de grands propriétaires racistes en lien avec des militaires réactionnaires), mais agiter le spectre communiste est le moyen d’obtenir le soutien du gouvernement étatsunien (dont par ailleurs des officiels importants, secrétaire d’État et directeur de la CIA, ont eu des relations d’affaires avec la United Fruit).
En 1951, Jacobo Arbenz succède à Arévalo et gauchit sa politique en faisant adopter en 1952 une loi de réforme agraire. C’en est trop pour les États-Unis. Pour renverser Arbenz, la CIA embauche des mercenaires et place à leur tête un militaire médiocre, Castillo Armas, tandis que John Peurifoy est nommé ambassadeur au Guatemala (il a l’expérience des contre-révolutions puisqu’il a été en poste en Grèce pendant la guerre civile). Arbenz qui, comme son prédécesseur, ne veut que démocratiser le pays, est dépassé par les évènements et finira par démissionner sous la pression des militaires guatémaltèques et, bien sûr, des États-Unis. Castillo Armas lui succèdera, suivi par une série de gouvernements réactionnaires et racistes anti-indigènes.
Un roman qui mêle évènements historiques et fiction
C’est cet enchainement que décrit Vargas Llosa. Son livre est un roman qui mêle évènements historiques et fiction. Le style est parfois déroutant, notamment le fait d’entrelacer, parfois dans un même chapitre, des évènements qui se sont déroulés à des moments différents. Il y a également quelques longueurs, et certains détails sur les mœurs des personnages (réels ou fictifs) n’apportent pas grand-chose.
En conclusion, Vargas Llosa explique pourquoi à son sens, le renversement d’Arbenz a été une « grande maladresse » des États-Unis. Il a poussé vers des positions révolutionnaires de nombreux jeunes latino-américains abasourdis : si un modéré comme Arbenz se faisait renverser, autant prendre d’emblée des mesures radicales. Vargas Llosa rappelle d’ailleurs qu’un certain Ernesto Guevara survivait difficilement au Guatemala en 1954 et attribue au coup d’État la radicalisation ultérieure du Che. Vargas Liosa ne se cache pas de mépriser et haïr « marxistes, trotskistes et fidélistes », mais son roman a le mérite de rappeler avec talent un épisode majeur de l’histoire de l’Amérique centrale du 20e siècle et d’évoquer les hommes de main médiocres et assassins de l’impérialisme US, et notamment le sanglant dictateur dominicain Trujillo dont le président Roosevelt aurait dit : « C’est un vrai salopard [son of a bitch], mais c’est notre salopard ».