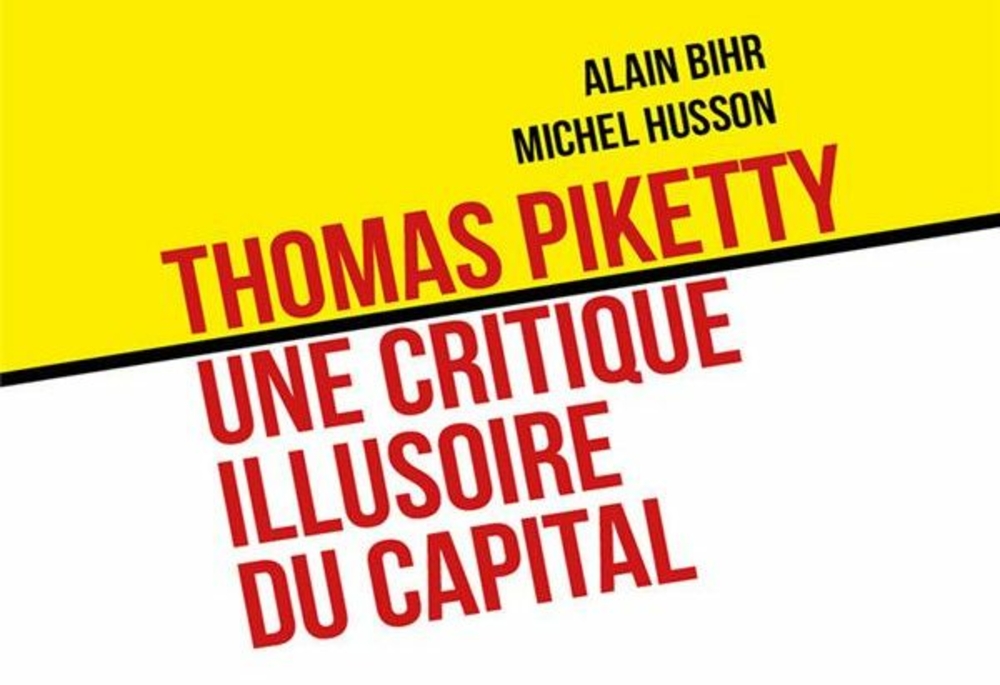Alain Bihr et Michel Husson nous ont accordé une interview à l’occasion de la sortie de leur ouvrage « Thomas, Piketty, une critique illusoire du capital ».
L’Anticapitaliste : Pourquoi ce livre ?
Avec Le Capital au XXIe siècle, publié en 2013, Piketty a conquis une audience mondiale (une quarantaine de traductions, 2,5 millions d’exemplaires vendus), notamment auprès d’un public de gauche, sur la base d’un malentendu confinant à l’escroquerie intellectuelle : faire croire qu’il accomplissait pour notre temps ce que Marx n’aurait fait que pour le seul XIXe siècle. Son nouvel ouvrage, Capital et idéologie, poursuit la même entreprise avec la prétention de fournir une grille d’analyse valable pour l’ensemble des sociétés humaines. Il nous a paru salutaire de dénoncer pareille entreprise en mettant clairement en évidence ses limites pourtant manifestes.
Pouvez-vous résumer vos principales critiques à l’égard des thèses de Thomas Piketty ?
Ses défauts sont multiples. Mais ils se réduisent tous en définitive au fait que, comme il l’a lui-même reconnu, Piketty ne s’est jamais frotté à Marx et n’en a par conséquent pas retenu la moindre leçon. C’est bien pourquoi les titres de ses ouvrages et une grande partie des commentaires dont ils ont fait l’objet confinent à cette escroquerie intellectuelle consistant à faire croire qu’il a dépassé Marx sans même être passé par lui, qu’il se situe au-delà de Marx alors qu’il est très en deçà de lui. Il en résulte notamment la méconnaissance complète du concept de rapports sociaux de production en général et des rapports capitalistes de production (de leurs spécificités) en particulier. D’où des amalgames et des raccourcis historiques indignes d’un universitaire, tel celui consistant à enjamber huit siècles de transition entre le féodalisme et le capitalisme en Europe occidentale en vingt lignes ! D’où aussi une conception fétichiste du capital qui conduit à l’assimiler à toute espèce d’actif (de propriété, lucrative ou non) et qui rend impossible toute théorie de la valeur.
Dès lors, Piketty ne peut que s’illusionner sur la portée de ses propositions politiques, qu’il croit anticapitalistes tout simplement parce qu’il ignore ce qu’est le capital comme rapport social de production, et qui sont au mieux réformistes : elles opèrent au niveau des rapports de répartition (en redistribuant revenus et patrimoines par l’intermédiaire de la fiscalité) pour en corriger les inégalités, sans toucher aux rapports capitalistes de production qui génèrent pourtant en permanence ces mêmes inégalités, en se condamnant ainsi à un travail de Sisyphe à l’intérieur même des limites du capitalisme.
Enfin, qu’il analyse les structures des sociétés humaines ou qu’il formule des propositions politiques, sa démarche comprend une forte charge idéaliste (au sens philosophique) qui le conduit à surestimer l’importance des facteurs idéologiques dans la transformation des sociétés humaines et à sous-estimer celle des luttes sociales et politiques : à le suivre, les changements historiques majeurs seraient essentiellement dus à l’émergence et la diffusion d’idées nouvelles (concernant la légitimité des rapports d’exploitation et de domination, partant la propriété, la justice, etc.) sans qu’on sache ce qui produit ces dernières elles-mêmes.
Que peut-on retirer d’utile de ses deux derniers livres ? Quels sont les limites de ses analyses théoriques ?
Dans notre livre, nous saluons la vertu disruptive des travaux de Piketty qui a fait de la question des inégalités une question centrale. Mais notre critique porte aussi sur la théorie sur laquelle il s’appuie, notamment dans Le capital au XXIe siècle. Piketty ne fait pas qu’oublier que le capital est un rapport social, mais il amalgame indûment deux définitions du capital. Dans ses données, le capital est un patrimoine, autrement dit la valeur totale de tout ce qui procure un rendement : logements, terrains, actifs financiers, brevets, capital productif. Mais ailleurs il restreint sa définition au seul capital engagé dans la production et passe allègrement d’un concept à l’autre. Il a besoin de ce va-et-vient pour faire du taux de profit une donnée de la fonction de production – la productivité marginale du capital – conformément à la théorie néo-classique. Ce taux de profit est alors une donnée qu’il suffit d’appliquer à « son » capital.
Tout cela est technique, mais ce flou sur la définition du capital a des implications importantes, notamment pour l’analyse du capitalisme contemporain. Chez Piketty, la baisse de la part des salaires dans le revenu national est ainsi expliquée par les conditions techniques de la production, et non par la lutte de classes entre capital et travail pour le partage de la valeur ajoutée. Piketty néglige sur ce point un phénomène essentiel, l’épuisement des gains de productivité – et donc du dynamisme du capitalisme. Le seul moyen de garantir le taux de profit est alors d’augmenter le taux d’exploitation. Chez Piketty, au contraire, la montée des inégalités est expliquée de manière mécanique par le gonflement du capital, tel qu’il le mesure, gonflement qui est principalement dû à l’augmentation des prix des actifs financiers ou de l’immobilier. De cette manière, Piketty déplace le lieu où se forment les inégalités alors même que c’est la baisse de la part des salaires qui permet d’alimenter le gonflement de la sphère financière. En privilégiant des mesures essentiellement fiscales, le projet de Piketty est de réparer les inégalités après coup, parce qu’il n’en identifie pas la source.
Certains trouveront sans doute que notre critique est trop sévère. Nous ne sommes pas hostiles, évidemment, à une taxation du capital, à une plus grande intervention des travailleurs sur leurs lieux de travail. En popularisant ces idées, Piketty joue un rôle positif. Mais il reste largement au milieu du gué. Un programme de rupture avec le capitalisme doit s’appuyer sur une analyse théorique de celui-ci. Or, si celle-ci est superficielle, elle conduit à manquer les cibles qu’il faudrait viser et à fixer des objectifs qui ne vont pas à la racine des choses. Il y a toujours un lien entre les analyses théoriques et le programme qu’on en déduit.
Prenons un exemple : avec la définition qu’il donne du capital, Piketty oublie qu’une bonne partie des actifs financiers sont du capital fictif en ce sens que leur valorisation a perdu tout contact avec ce qu’il est convenu d’appeler l’économie réelle. Dès lors, il ne voit pas que sa proposition de le redistribuer (120 000 euros pour chaque adulte) s’évanouirait en même temps que s’évaporerait la valeur de ce capital fictif à la suite d’une telle expropriation fiscale. Parce que, encore une fois, le capital est un rapport social.
Pourriez-vous revenir sur le regain et l’écho des réformismes « verts » et « roses » que vous pointez dans la conclusion de votre livre ? Ainsi que sur leurs limites et les illusions qui leur sont liées.
Ce regain s’explique par au moins deux raisons. D’une part, le discrédit du néolibéralisme qui a servi de justification aux transformations de tous ordres opérées au sein du capitalisme contemporain depuis une quarantaine d’années, à l’initiative des gouvernements des principaux États centraux et des institutions supranationales qui ont en charge la (dé)régulation du capitalisme au niveau mondial (FMI, Banque mondiale, BRI, OMC, etc.), les uns et les autres opérant pour le compte du capital transnational. Aucune des promesses de l’idéologie néolibérale, à commencer par celle d’une « mondialisation heureuse » qui profiterait à l’immense majorité de l’humanité, n’a été tenue. Au contraire, le capitalisme d’aujourd’hui est bien plus oppressif, inégalitaire, destructeur des écosystèmes et des sociétés humaines, qu’il ne l’a jamais été, précisément parce qu’il a étendu et approfondi son emprise sur elles. Du coup, il s’ouvre à nouveau un espace pour le réformisme tout comme d’ailleurs pour la critique anticapitaliste. Se saisir de cette opportunité est d’autant plus nécessaire pour les forces réformistes qu’elles ont-elles-mêmes perdu une bonne partie de leur crédit (partant de leur audience politique) en se ralliant au néolibéralisme, ouvertement ou honteusement, en cherchant ou non à l’infléchir (le modérer) dans un sens social.
Ce néoréformisme diffère cependant de l’ancien en ce qu’il ne peut plus se contenter d’être « rose » (d’entreprendre de soulager le sort des plus démuniEs, de réduire les inégalités sociales, de parfaire la justice distributive, de renforcer le salariat, etc.) mais qu’il peut lui aussi désormais devenir « vert » tant la crise écologique planétaire (réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, etc.) plombe le capitalisme actuel et menace l’avenir de l’humanité elle-même. Ce que, soit dit en passant, Piketty méconnaît en bonne part : la problématique écologique se réduit chez lui à une variante de proposition de taxe carbone, ce qui est très insuffisant.
Les projets de Green New Deal, tels qu’ils ont été élaborés par Alain Lipietz, Jeremy Rifkin, Naomi Klein, etc., témoignent de la nécessité de cette convergence. Toute la question est de savoir s’ils sont à la hauteur des défis multiples (écologiques, sociaux, politiques) que le devenir du capitalisme lance aujourd’hui à l’humanité et, plus fondamentalement encore, si le capitalisme reste réformable. Nous ne le pensons pas. Le réformisme n’a été possible dans le fil du développement historique du capitalisme que parce que, tout en corrigeant certains de ses défauts et des excès et précisément par ces corrections, il lui a permis de se parachever, de se parfaire. Or, aujourd’hui, le capitalisme est en cours de parachèvement et ne laisse plus subsister de possibilité de le réformer, aussi monstrueux soit-il devenu. Dès lors, la seule alternative qu’il nous laisse est bien celle résumée par la célèbre formule d’Engels reprise par Rosa Luxemburg : socialisme ou barbarie.
Propos recueillis par Henri Wilno