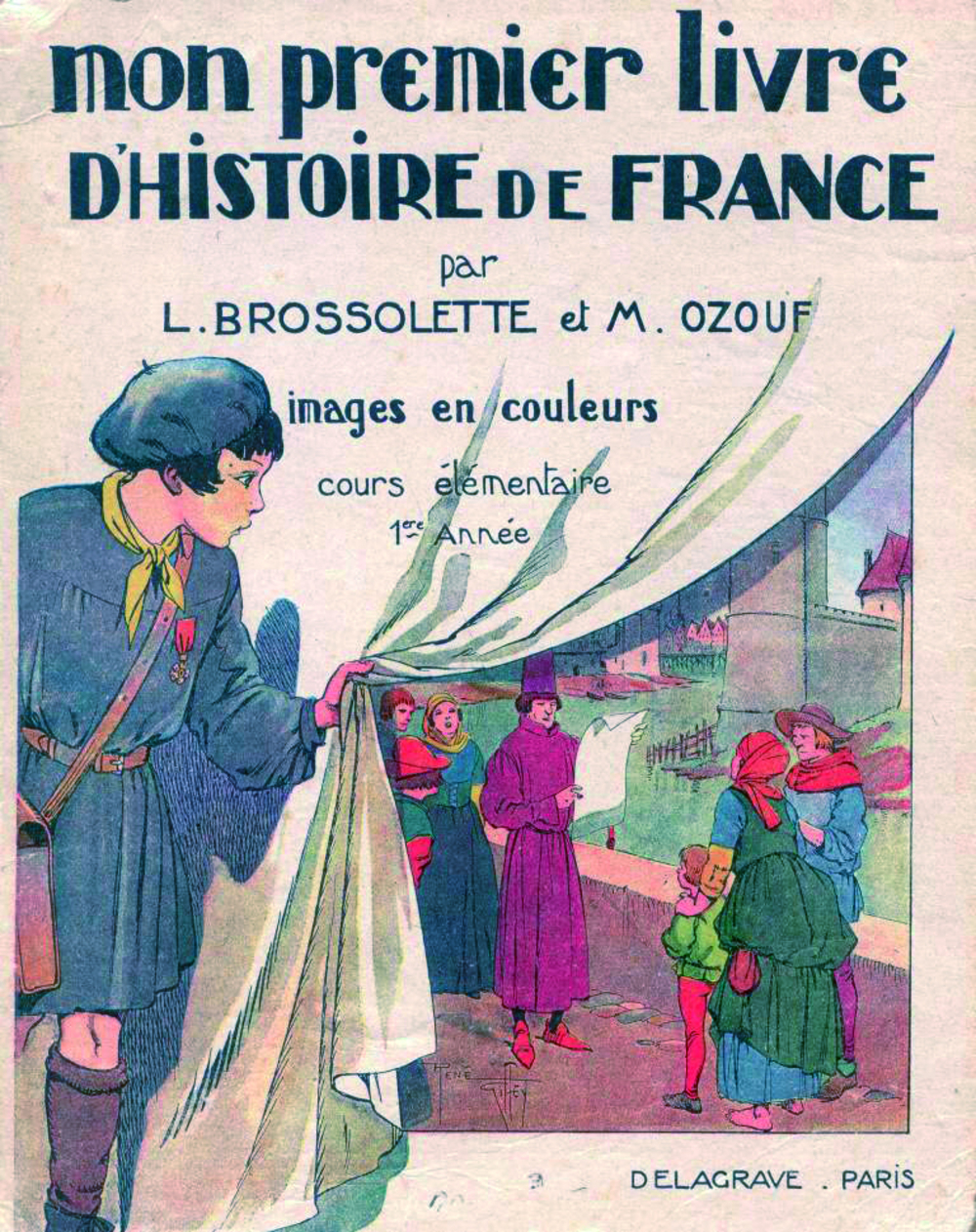François Fillon ayant voulu se présenter comme le champion d’une droite qui veut « réécrire les programmes d’Histoire avec l’idée de les concevoir comme un récit national », Nicolas Sarkozy a aussitôt fait un pas de plus, en assurant que « dès que vous devenez Français, vos ancêtres sont Gaulois ». L’identité nationale a ainsi fait son grand retour dans le débat politique, non sans recevoir les encouragements de Jean-Luc Mélenchon qui a cru nécessaire d’en rajouter une couche, en affirmant qu’« à partir du moment où l’on est Français, on adopte le récit national »…
Si le retour à cette vieille conception nationale de l’histoire est scientifiquement incongru, il constitue surtout le fondement d’un nouvel ordre réactionnaire que l’ensemble du mouvement ouvrier doit combattre sans hésitation.
Le concept charnel de nation
L’histoire entretient des relations aussi anciennes qu’étroites avec le concept de nation. De l’Afrique des griots à la Grèce d’Homère, il n’est en effet pas de nation en construction qui ne se soit cristallisée autour du souvenir épique des grands ancêtres. Les vieux récits oraux qui, à l’exemple des chansons de geste ou des sagas, transmettaient la mémoire des ancêtres fondateurs, ont progressivement fait place aux chroniqueurs royaux, puis aux historiographes modernes, sans qu’aucune solution de continuité ne puisse être identifiée dans la construction de la mémoire nationale. Rares sont donc aujourd’hui les nations qui ne disposent d’un « roman national », dont les postulats remontent souvent à des temps très anciens, puisque leur premier noyau est inséparable du processus d’ethnogenèse qui a permis la mise en place des premières constructions nationales.
Historiquement, les nations se sont pensées comme des constructions charnelles. Le vocabulaire en témoigne dans la mesure où des termes comme génos ou gens, qui en grec et en latin constituent les équivalents les plus proches de ce que nous appellerions aujourd’hui la nation, dérivent d’une racine indoeuropéenne qui renvoie à la naissance. Cette même étymologie caractérise tous les termes qui définissent la nation. Le français « nation » n’est ainsi que la transcription française du latin natio, qui signifie « naissance ». Les langues slaves utilisent pour désigner la nation le terme de národ ou l’un de ses dérivés qui lui aussi renvoie à la naissance, comme en témoigne encore aujourd’hui l’existence en tchèque du verbe národit (= naître). Hors du domaine indo-européen, il n’en va pas différemment, puisque le terme umma, qui constitue dans l’arabe coranique l’équivalent le plus proche de notre terme de nation, est par exemple forgé sur la racine umm (= mère).
Comme en témoignent ces étymologies, la nation s’est donc originellement pensée comme un regroupement de gens issus d’une même naissance, autrement dit comme un groupe issu d’un ancêtre commun. Un peu comme le concept de « patrie », qui renvoie quant à lui étymologiquement à la terre des pères, la nation porte par ses origines un caractère charnel, ce qui explique qu’elle puisse si facilement se charger d’émotion. Il devient en effet beaucoup plus facile d’exiger d’un homme de mourir pour la défense nationale, s’il pense se sacrifier pour ce qu’il perçoit peu ou prou comme sa parenté de sang.
L’histoire comme idéologie nationale
Dans les faits, aucune nation ne constitue toutefois une communauté charnelle. Les ethnogénéticiens ont ainsi démontré que, bien que l’isolement d’une nation peut, en favorisant l’endogamie, lui permettre d’acquérir avec le temps des caractères génétiques communs, aucune des nations existantes ne descend d’un groupe ethniquement homogène. Les historiens ont, quant à eux, montré que les nations ne sont pas issues de la longue expansion des vieux liens tribaux, mais d’un processus politique rapide au cours duquel un chef soumet des populations disparates.
Ainsi, les proto-nations germaniques, comme les Wisigoths, les Burgondes ou les Francs, étaient originellement constituées par des groupes ethniquement hétérogènes, dont les contours pouvaient évoluer très rapidement en fonction des succès ou des défaites de leurs chefs. Les Francs ne constituaient par exemple qu’un ensemble de tribus diverses dont l’unité nationale ne reposa guère que sur le fait que Clovis les contraignit à se soumettre à son autorité. En d’autres termes, l’unité nationale n’est pas originellement fondée sur un lien de sang, mais sur le partage d’un même rapport de domination.
Entre le concept de nation et sa réalité concrète, il existe donc un profond hiatus que l’histoire a précisément pour fonction de combler. Comme l’avait montré l’historien Jenö Szücs à partir du cas de la Hongrie, les proto-nations se sont très vite dotées d’une histoire, parce qu’elles avaient besoin de s’inventer, par un « récit national », une ascendance commune.
Ainsi, les Hongrois n’ont originellement aucune unité ethnique, puisqu’ils trouvent leur origine dans le regroupement au 10e siècle, sous l’autorité de la famille des árpád, d’un patchwork de tribus, puisant à des groupes linguistiques très différents (finno-ougrien, turc, indo-européen, etc.). La montée en puissance de la royauté hongroise l’amena toutefois à affirmer son autorité en se posant comme garante de l’unité nationale, ce qui l’amena à faire écrire au 13e siècle une première histoire officielle qui expliquait que les Hongrois descendaient des Huns. Les Hongrois constituaient dès lors une nation au sens premier du terme, puisqu’en se définissant comme des fils de Huns, ils pouvaient désormais se percevoir comme un vaste cousinage.
La quasi-totalité des nations européennes s’est construite en se dotant d’une historiographie semblable. Au 7e siècle et peut-être même dès la fin du 6e siècle, les historiens de la monarchie mérovingienne expliquèrent ainsi que le peuple franc était issu de l’ancienne Troie, reprenant à leur compte l’origine mythique dont se prévalaient les Romains. Il en alla de même en Angleterre où la création au 10e siècle d’une royauté unique aboutit au 12e siècle à ce que les historiens affirment que les Britanniques étaient issus d’un certain Brutus qui, pour faire bonne mesure, était aussi censé descendre du roi Priam de Troie.
Le même processus se retrouve aussi en Bohème, où la création au 10e siècle de la monarchie ducale des Přemsylides entraîna la naissance de la nation tchèque et l’écriture au début du 12e siècle d’une première histoire nationale qui affirma que les habitants de la Bohème descendaient tous d’un certain Boemus. Partout s’écrivirent ainsi des histoires nationales dont la fonction était de permettre idéologiquement à la nation de se percevoir comme une communauté de sang.
L’histoire nationale comme idéologie sociale
Pour les dominants, ces premières histoires nationales avaient le défaut de porter une dimension par trop égalitaire, puisque l’ensemble de la nation était censé avoir le même sang. Aussi les histoires nationales s’attachèrent-elle à introduire l’inégalité sociale dans l’histoire nationale, comme le fit la première histoire des Hongrois en expliquant que l’égalité originelle qui existait entre tous les Huns avait été abandonnée, après que les plus lâches d’entre eux avaient été réduits en servage pour avoir refusé de combattre à l’heure d’un grand péril. Un tel mythe permettait de légitimer la domination de la noblesse, censée descendre des Huns les plus courageux, et la réduction en servage perpétuel de la paysannerie qui avait l’infortune de descendre des Huns les plus lâches.
La même logique put permettre de légitimer la domination masculine, comme cela est le cas dans la plus ancienne histoire nationale des Tchèques lorsqu’elle explique que l’égalité originelle entre les sexes fut brisée par les premiers descendants de Boemus qui capturèrent et asservirent les femmes, fondant ainsi un nouvel ordre sexuel dans lequel elles se trouvaient placées sous la puissance de leurs maris.
Dans le cas français, la légitimation nationale de l’ordre social se traduisit sous l’Ancien Régime par une importante reconsidération, qui amena les historiographes à refuser au Tiers-Etat une ascendance franque. Dans cette logique, les Francs n’auraient en effet été que les ancêtres des seuls nobles qui, en conquérant les Gaules, auraient réduit en servitude les Gaulois qui devenaient ainsi les ancêtres des serfs et donc du Tiers-Etat. Cette conception, assez courante aux 17e et 18e siècles, permettait de transformer la lutte des classes en une lutte des races et de mieux garantir la domination nobiliaire en en faisant une partie intégrante de l’ordre national.
La Révolution et l’histoire nationale
On sait que la Révolution française apporta une nouvelle conception de la nation. Celle-ci se traduisit tout d’abord par la constitution, le 17 juin 1789, de l’assemblée du Tiers-Etat en « Assemblée nationale », ce qui impliquait une conception désormais démocratique de la nation.
Elle s’exprima aussi par une conception contractuelle de l’unité nationale, qui se traduisit par la fête de la Fédération qui vit, le 14 juillet 1790, les délégués de chaque province de France jurer au Champ-de-mars de « demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité ». Ces éléments servent encore aujourd’hui de point d’appui à la gauche républicaine pour affirmer qu’il y aurait en France une double conception de la nation. La première serait celle de l’ancienne France, historiquement portée par l’extrême droite, qui conçoit la nation comme une communauté charnelle. La seconde serait celle de la France révolutionnaire qui définirait la nation comme une communauté politique, fondée selon le philosophe et militant du PG, Henri Peña-Ruiz, sur le triptyque « Liberté, Egalité, Fraternité », seule source de ce nouveau contrat social.
Cette conception a une évidente part de vérité, dans la mesure où la gauche républicaine est effectivement porteuse d’une conception de la nation qui diffère profondément des perceptions ethniques ou religieuses qui sont à la source du nationalisme d’extrême droite. Pour autant, elle a aussi d’évidentes limites, dans la mesure où elle surestime la coupure entre l’Ancien Régime et la Révolution.
Sur la question de l’histoire nationale, comme d’ailleurs sur beaucoup d’autres, la Révolution apporta de profondes transformations plus qu’une véritable rupture. En conservant la référence à la nation, en la concevant toujours dans le cadre de la vieille France et non dans celui d’une communauté politique de type nouveau, la Révolution n’a en réalité jamais vraiment tourné le dos à la vieille conception charnelle qui fondait l’histoire nationale. Particulièrement révélateur est le manifeste que l’abbé Sieyès publia sous le titre Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?, à la veille de l’ouverture des Etats généraux. Ce texte, qui posait les fondements idéologiques de la constitution du Tiers-Etat en nation, abordait la question de l’histoire nationale en expliquant :
« Pourquoi [le Tiers-Etat] ne renverrait-il pas dans les forêts de la Franconie toutes ces familles qui conservent la folle prétention d’être issues de la race des conquérants et d’avoir succédé à des droits de conquête ? La nation, alors épurée, pourra se consoler, je pense, d’être réduite à ne se plus croire composée que des descendants des Gaulois et des Romains. En vérité, si l’on tient à vouloir distinguer naissance et naissance, ne pourrait-on pas révéler à nos pauvres concitoyens que celle qu’on tire des Gaulois et des Romains vaut au moins autant que celle qui viendrait des Sicambres, des Welches et autres sauvages sortis des bois et des marais de l’ancienne Germanie ? »
Dans ce texte emblématique, Sieyès proposait donc une transformation radicale du sens social de l’histoire nationale, en suggérant d’en exclure les Francs et donc leurs descendants nobles, pour ne plus retenir que les Gaulois, autrement dit les ancêtres du Tiers-Etat. Une telle conception revenait à introduire une démocratisation de l’histoire nationale, dans la mesure où elle plaçait le cœur de la nation dans le Tiers-Etat, même si celui-ci tendait en réalité à se confondre, dans l’esprit des révolutionnaires, avec la seule bourgeoisie.
Quelle que soit l’importance de cette révolution sociale, elle s’inscrivait néanmoins pleinement dans la vieille conception charnelle de la nation, puisqu’elle ne proposait finalement que de changer d’ancêtres de référence, en substituant les Gaulois aux Francs. Cette transformation dans la continuité eut un grand avenir, puisqu’elle fut à la source de l’histoire républicaine du 19e siècle, qui remplaça les Francs par les Gaulois, afin de déplacer le cœur de la nation de la noblesse à la bourgeoisie, sans pour autant rompre avec l’idée que la nation française se définissait par ses ancêtres communs.
Histoire et nationalisme
La démocratisation de la nation, qui trouvait son expression symbolique dans le choix des ancêtres gaulois, portait aussi en elle une dimension très agressive. La Révolution française en donna un premier exemple, puisqu’en se pensant comme « la Grande Nation », elle donna naissance à un premier impérialisme français, porté par une armée de masse, qui trouva son aboutissement dans l’Empire napoléonien. En diffusant toutefois sa nouvelle idée de la nation, la Révolution devint son propre fossoyeur, dans la mesure où elle donna partout naissance à de nouveaux nationalismes qui se retournèrent contre l’impérialisme français. Ces nouveaux nationalismes s’emparèrent dès lors des vieilles histoires nationales pour les diffuser à une échelle jusque-là inconnue.
Si l’histoire n’avait jusque-là pas constitué une matière académique, puisqu’elle n’était guère pratiquée que par quelques historiographes royaux ou érudits ecclésiastiques, les besoins historiques des nouveaux nationalismes modifièrent radicalement son statut. Au cours du 19e siècle, l’histoire devint une matière universitaire, tandis que les Etats mirent partout en place des institutions pour le développement de leur histoire nationale, à l’exemple de la « Société de l’histoire de France » fondée en 1833 par Guizot, ou encore de la « Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde » créée en 1819 par le ministre d’Etat prussien Heinrich von Stein.
Conçues dans une perspective étroitement nationale, ces histoires officielles se diffusèrent à une échelle de masse, en se voyant attribuer une place de choix dans l’enseignement primaire et secondaire qui se développa au cours du 19e siècle. Alors que sous l’Ancien Régime français, les vieux mythes francs de l’histoire monarchique n’étaient guère diffusés qu’au sein des élites, la nouvelle histoire nationale prit une tout autre dimension, puisque nul ne pouvait plus ignorer dans la France de la fin du 19e siècle le récit officiel qui, de Vercingétorix à Napoléon, construisait le fondement de l’unité nationale.
L’histoire nationale acquit aussi une nouvelle importance politique, dont témoigne le fait que les dirigeants du 19e siècle se firent souvent les historiens de leur nation, à l’exemple de François Guizot, qui fut l’un des plus célèbres historiens de la France avant de devenir le plus important des présidents du Conseil de Louis-Philippe.
L’histoire occupa une place encore plus importante au sein des nations qui avaient perdu leurs Etats, comme ce fut le cas en Bohème, où l’historien František Palacký reprit les vieux manuscrits du 12e siècle pour écrire une Histoire du peuple tchèque en Bohème et Moravie qui reprenait et rénovait la vieille histoire nationale du Moyen-âge, en cultivant la nostalgie de l’ancienne indépendance du royaume de Bohème. L’ouvrage eut un succès de masse, qui permit à Palacký d’acquérir une audience considérable : président du congrès panslave réuni à Prague en 1848 pendant le printemps des peuples, il devint le père du nationalisme tchèque et le leader du parti vieux-tchèque et de sa fraction parlementaire à Vienne.
Loin d’avoir rompu avec la conception charnelle de la nation, l’idéologie nationale issue de la Révolution française développa à une échelle de masse de nouvelles revendications historiques, chaque nation mettant en place, au nom de ses droits historiques, des revendications territoriales et institutionnelles concurrentielles. Cette logique devait aboutir à la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, qui fut en grande partie préparée par l’histoire nationale, comme ce fut le cas en France où les écoles de la IIIe République avaient soigneusement préparé la population à combattre l’Allemagne, en leur offrant le modèle de leurs ancêtres Gaulois affrontant les Teutons.
Ce dramatique bilan de l’histoire nationale amena à de nouvelles interrogations sur sa pertinence, comme en témoigne le philosophe Paul Valéry qui, bien que peu porté sur la critique sociale, doutait ouvertement des vertus de l’histoire de France en écrivant :
« L’Histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. »
Le retour au récit national
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Etats s’attachèrent à rompre avec le cycle infernal des guerres nationales en mettant au rencart les vieux récits nationaux. Un peu partout, les histoires nationales furent abandonnées dans le troisième quart du 20e siècle pour être remplacées par des programmes plus universels et plus en adéquation avec l’évolution de la recherche scientifique.
En faisant souffler un nouveau vent réactionnaire, la contre-révolution libérale réussit dans le dernier quart du 20e à inverser cette tendance. En France, où l’histoire nationale avait été abandonnée dans les années 1970, le ministre socialiste de l’éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, fit réviser en 1985 les programmes d’histoire de l’école primaire pour imposer un retour à la vieille histoire de France. Les objectifs fixés par Chevènement pour l’enseignement de l’histoire avaient un caractère réactionnaire manifeste, puisqu’ils se donnaient pour but de permettre « l’apparition chez l’élève de la conscience nationale » et le développement de sa fierté d’appartenir à un pays qui aurait été au 19e siècle une « grande puissance colonisatrice et mondiale », avant de devenir au 20e siècle une « grande puissance technologique et culturelle ».
Dans les années 2000, la droite sarkozyste s’attacha à récupérer la thématique, en proposant de substituer le terme de « roman national » à la notion chevènementiste de « récit national », sans toutefois que cette modification de la terminologie ne changeât quoi que ce soit sur le fond. La droite n’avait en réalité rien à redire aux conceptions de Chevènement, qui justifiait de son action en écrivant en 2014 :
« Le gouvernement qui, en République, est responsable des programmes, peut demander que le "récit national" ne valorise pas systématiquement des ombres de notre Histoire […], les traites négrières, les lois antisémites de Vichy, mais nous parle de ses lumières et nous rappelle qu’en particulier la Révolution française, la première en Europe, a fait des juifs des citoyens français comme les autres, et qu’elle a aboli une première fois l’esclavage en 1794. On aimerait que les programmes d’Histoire communiquent aux jeunes Français une raisonnable fierté de la France : un pays qui s’est construit sur un millénaire et qui ayant affirmé par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (1789) la souveraineté de la Nation a, trois ans après, proclamé la première République (1792). J’ajoute que pour que naissent la Révolution et la République française, il a bien fallu que la France ait existé auparavant, que Philippe Auguste ait repoussé l’Empereur germanique à Bouvines (1214), que Saint-Louis ait fait tenir ensemble la France d’oïl et la France d’oc, que Jeanne d’Arc ait bouté l’Anglais hors de France, qu’Henri IV, par l’Edit de Tolérance, ait mis fin aux guerres de religions. Certes les choses auraient pu être tout autres, mais c’est comme cela qu’elles se sont passées. Et le pays qui a fait la Révolution française, matrice du monde contemporain, n’est peut-être pas tout à fait un pays comme les autres. »
Ce texte montre à quel point le « récit national » n’est rien d’autre que la vieille histoire des dominants. Chevènement n’y considère l’antisémitisme que sous l’angle des notables républicains octroyant aux juifs l’égalité des droits, tandis qu’il se refuse à percevoir l’esclavage du point de vue des Africains, pour ne le penser que par le seul biais de la bourgeoisie française qui avait généreusement assuré son abolition. Bien évidemment, on notera aussi que le renvoi à la nation républicaine ne constitue pour Chevènement que le relais d’une référence plus générale à l’histoire de la monarchie française, qui ne constitue rien d’autre qu’une exaltation de la construction de l’Etat par et pour la classe dominante. Ajoutons enfin que cette histoire des dominants est aussi une histoire sans femmes, si ce n’est par le seul biais de Jeanne d’Arc qui, grâce à son statut de Vierge, se voit accorder par Chevènement le douteux privilège d’entrer dans le panthéon des « grands hommes » qui ont fait la France.
Pour une histoire matérialiste
Pour un matérialiste, ce retour au « récit national » est d’abord et avant tout un retour à l’idéalisme. Une histoire nationale peut certes s’ancrer dans des faits sociaux, lorsqu’elle analyse la naissance d’une conscience nationale à travers le combat d’un groupe pour ses droits : on peut par exemple écrire une histoire concrète de la formation de la nation palestinienne, en étudiant sa formation au travers des luttes contre la colonisation anglaise et sioniste. On peut aussi écrire une histoire concrète de la construction de l’Etat français, en analysant le processus de constitution de la royauté qui permit à un lignage d’asseoir sa supériorité sur les pouvoirs concurrents, avant de construire les instruments lui permettant d’assurer sa domination sur les populations environnantes.
On peut enfin écrire une histoire de la construction idéologique de la nation française, en montrant comment les pouvoirs ont instrumentalisé le passé, en élaborant une mémoire sociale susceptible de légitimer leur domination. En revanche, on ne peut dresser un « récit national » de la France, dans la mesure où l’objet même de « France » ne constitue en dernière instance qu’une idée abstraite, sans réalité concrète.
Notre histoire n’est pas donc celle de cette nation abstraite dont la droite sarkozyste ou la gauche républicaine dressent un portrait mythifié, qui n’est en réalité autre que l’idéologie que les dominants ont construit pour imposer leur pouvoir. Elle est une histoire matérialiste, fondée sur la connaissance scientifique du passé historique, capable d’appréhender les sociétés passées dans leur réalité concrète, autrement dit comme des formations sociales fondées sur l’exploitation et la domination.
Elle est une histoire de chair et de sang, qui est celle d’un ordre profondément inégalitaire, dans lequel les palais et œuvres d’art des dominants ont été payés par la sueur des exploités. Elle se situe aussi à la seule échelle qui compte, autrement dit celle d’un monde dans lequel la croissance des uns s’est alimentée du pillage et de la réduction en esclavage des autres. Elle est enfin celle d’un ordre patriarcal, où les dominants ont fondé leur reproduction sur la domination masculine et l’homophobie.
Laurent Ripart