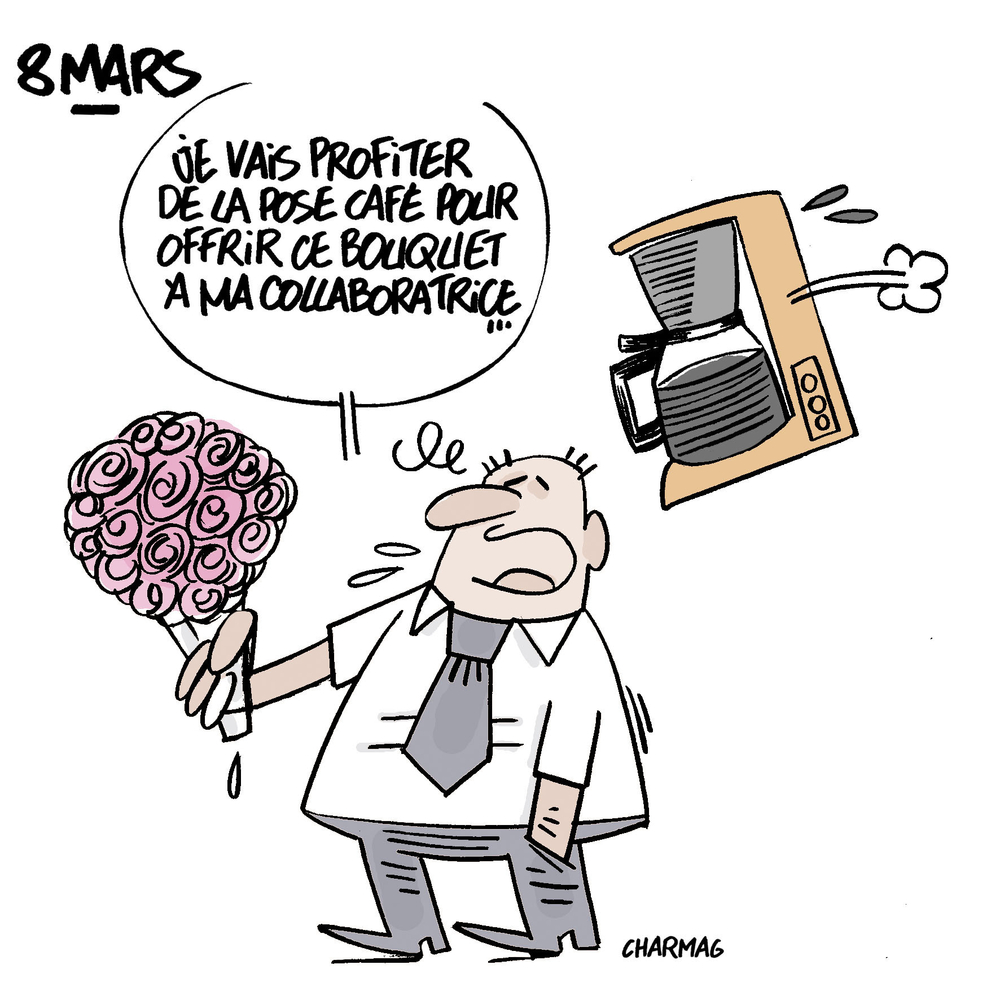À l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femme, un mouvement féministe jeune, divers, bien vivant, en pleine reconstruction, a occupé les rues et les places.
Ce n’était pas gagné. On pourrait même dire que les obstacles se cumulaient. Sur fond de crise sanitaire qui plombe les mobilisations sociales depuis des mois, un 8 mars qui tombe un lundi sous couvre-feu à 18h, jour de rentrée scolaire pour un tiers des académies et, pour le moins que l’on puisse dire, une absence de cadre reconnu comme direction commune. Et pourtant ce sont des dizaines de milliers de femmes qui se sont mobilisées pour affirmer l’actualité combative de cette date symbolique, dominée par la volonté de mettre un stop à toutes les violences contre les femmes. Finalement la crise sanitaire et sa gestion autoritaire par le pouvoir n’a fait que démultiplier les raisons de la colère féministe et cela s’est entendu.
Une dynamique riche de sa diversité
Pour être sûres de faire exister cette échéance, des cadres divers ont multiplié les initiatives. Dès le samedi 6 mars, des milliers de femmes sont descendues dans la rue : à Nice pourtant confinées des centaines de femmes ont manifesté à l’appel d’un collectif Nous Toutes. À Strasbourg ce sont plusieurs collectifs qui ont appelé à une marche « en mixité choisie », fermée aux « hommes cisgenres » avec la présence remarquée de nombreuses femmes kurdes. À Lille un collectif 8 mars a réuni plus de 1000 personnes pour « la fin de l’impunité pour les violences sexistes et sexuelles et l’inceste » et la « PMA pour tou·te·s ». À Annecy, plus de 600 manifestantes, des dizaines à Alençon ou Orléans, des centaines à Saint-Denis à l’appel des Dionysiennes ou à Montreuil (93). Dimanche des dizaines de personnes à Tulle à l’appel d’un Collectif 8 mars, des milliers place de la République à Paris pour un rassemblement « festif et politique » organisé par On arrête toutes, mais dont la préfecture avait interdit le caractère festif au nom de l’état d’urgence sanitaire !
Grève féministe
« Le 8 mars, nous serons en grève avec les femmes du monde entier pour refuser toutes et tous ensemble de payer le prix de la crise avec notre travail, notre salaire, notre corps » : c’était l’appel lancé par 37 organisations syndicales (CGT, FSU, Union syndicale Solidaires), associatives (On arrête toutes, Planning familial, Osez le féminisme…), soutenues par des partis politiques et relayé par exemple par un appel de 100 syndicalistes à Toulouse. Si ces appels n’ont pas déclenché une grève générale, ce que personne ne pensait, ils ont permis à des dizaines de milliers de femmes et à leurs alliés de se retrouver dans les rues ce lundi 8 mars, en même temps que les femmes du monde entier. 6000 à Toulouse, 2000 à Rennes ou à Bordeaux, Nantes, plus de 10 000 à Paris, 500 à Rouen pour les chiffres dont nous disposons. Des salariées premières de corvée et de précarité, dans la santé (dont des sage-femmes en grève ces derniers jours), le commerce, l’éducation, dans les quartiers populaires, des femmes kurdes, ouïghoures, sud-américaines, des personnes LGBTI mobilisées contre les violences sexistes et pour la PMA, et surtout des jeunes femmes étudiantes ou lycéennes, en première ligne contre les violences psychologiques, conséquences de la crise sanitaire qui aiguise encore davantage les insupportables violences de cette société patriarcale. Toute la diversité des revendications a construit la richesse et la dynamique de cette journée, tout en collages, en chorales et en slogans.
Pour faire un pas en avant et permettre d’envisager des victoires, il y a urgence à ce que cette dynamique, tout en conservant la richesse de sa diversité, se structure dans la construction d’un mouvement féministe autonome qui élabore ses revendications communes, fixe son agenda, et en appelle à des alliés pour construire le rapport de forces.