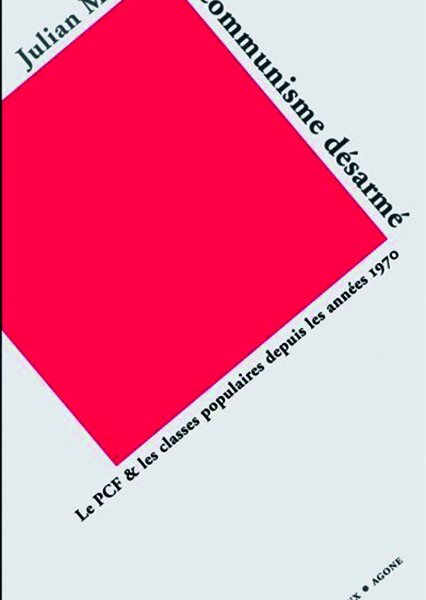Julian Mischi, « Le communisme désarmé. Le PCF et les classes populaires depuis les années 1970 », Marseille, Agone, 2014, 332 pages, 20 euros. Acheter sur le site de la librairie La Brèche.
Le PCF a longtemps constitué, sinon « le parti de la classe ouvrière » (comme il se présentait lui-même), du moins une organisation de masse, largement implantée dans les grandes concentrations ouvrières, dirigeant la principale confédération syndicale (la CGT), dominant nombre de communes populaires et y assurant un encadrement de la vie quotidienne via un tissu associatif très dense.
Ainsi a-t-il été capable, des années 1930 aux années 1970, de faire émerger plusieurs générations de porte-parole et de cadres politiques et syndicaux, du niveau local au niveau national, majoritairement issus du monde ouvrier et prétendant représenter prioritairement la classe ouvrière. Le sentiment de compter collectivement et de pouvoir transformer la société s’enracinait dans un ensemble de solidarités concrètes que faisaient vivre les équipes militantes du PCF, façonnant une conscience de classe malgré les divisions et inégalités réelles au sein même des classes populaires.
Saisir le déclin du PCF par en bas
A partir de la fin des années 1970 s’est engagé un processus de déclin, brutal entre 1978 et 1984 puis plus progressif, qui a transformé le PCF quantitativement et qualitativement. Le nombre d’adhérents s’est ainsi écroulé (des 580 000 annoncés lors de l’apogée de 1978 aux 64 000 adhérents à jour de cotisations du congrès de 20121), et encore davantage le nombre de militants actifs appartenant aux classes populaires et intervenant, au nom du PCF, dans les lieux de travail et les quartiers.
D’un point de vue qualitatif, le PCF est devenu un parti dominé par des élus de plus en plus rarement issus du monde ouvrier, focalisé sur les échéances électorales et suiviste à l’égard du PS (tant il dépend, pour la sauvegarde de ses 7 000 élus et d’un appareil disproportionné par rapport à son influence réelle, des alliances électorales passées avec les socialistes). S’il demeure le parti comptant le plus d’ouvriers et d’employés dans ses rangs, ces derniers ne donnent plus le ton depuis bien longtemps, face aux élus et aux cadres de la fonction publique.
La longue nuit stalinienne est évidemment pour beaucoup dans ce déclin, et il faudrait restituer les processus conflictuels qui ont abouti, à partir de la fin des années 1920, à l’étouffement bureaucratique des débats internes, à une attitude suiviste à l’égard des dictatures du bloc de l’Est, ainsi qu’à un ouvriérisme rendant le PCF peu ouvert, et souvent hostile, au développement de revendications et mouvements anticolonialiste, antiraciste, féministe et écologiste.
Toutefois, les trajectoires des partis stalinisés sont suffisamment diverses, ne serait-ce qu’en Europe, pour qu’on ne se contente pas d’une explication aussi globalisante2. Comment expliquer ainsi les trajectoires divergentes du PCI (devenu en vingt ans un Parti démocrate sans référence au mouvement ouvrier, et a fortiori communiste, alors même qu’il constituait de loin le parti communiste le plus puissant d’Europe), du KKE ou du PCP (profondément sclérosés, défaitistes et sectaires, mais bien implantés dans les classes ouvrières grecque et portugaise, contrôlant notamment des pans importants des mouvements syndicaux) et du PCF ?
Là où, généralement, on se borne à évoquer les décisions prises, en telle ou telle occasion, par le comité central ou le bureau politique du PCF, décisions qui ont évidemment eu leur importance dans son déclin, l’auteur nous introduit dans les cellules et les sections du parti, afin de saisir les incompréhensions, les frustrations et les colères de ceux et celles qui firent vivre quotidiennement l’organisation mais qui finirent par la quitter, rompant souvent avec toute activité politique tout en maintenant un engagement syndical ou associatif.
Les logiques diverses du désengagement communiste sont décrites de manière très fine par Julian Mischi (pages 95-158), qui nous permet ainsi de comprendre par en bas le déclin du PCF, sur la base d’une enquête menée surtout dans quatre départements (Allier, Isère, Loire-Atlantique et Meurthe-et-Moselle) et fondée sur des matériaux riches et variés : entretiens avec d’anciens militants, correspondances entre responsables locaux et direction nationale, procès-verbaux de réunions de cellules, lettres envoyés par des militants aux responsables locaux ou nationaux, rapports des conférences de préparation aux congrès nationaux.
Transformations de la classe ouvrière et désouvriérisation du PCF
La force de l’analyse de Julian Mischi consiste dans une prise au sérieux conjointe des transformations qui ont affecté la classe ouvrière, affaiblissant sa capacité de résistance collective et diminuant l’influence du PCF dans la société française, et de ce qui s’est joué en son sein au cours de cette période. L’auteur évite ainsi de tomber dans le piège du réductionnisme sociologique, qui dédouanerait les directions successives du parti de leurs responsabilités en faisant de la désindustrialisation la cause unique et suffisante du déclin du PCF3. Certes, la montée du chômage (touchant très fortement les ouvriers d’industrie), mais aussi les logiques de précarisation et de sous-traitance, ou encore les transformations de l’habitat ouvrier, ont produit une « déconcentration » de la classe ouvrière et une fragilisation des solidarités et repères collectifs, patiemment construits des années 1930 aux années 19704. L’auteur analyse ainsi en détail la manière dont ces transformations conjointes s’incarnent dans un contexte local spécifique, à savoir le bassin sidérurgique autour de Longwy, et leurs effets concrets sur le PCF (pages 38-55).
Mais comme l’écrit l’auteur en conclusion : « les choix organisationnels et stratégiques comptent ! » (page 293) : l’orientation du PCF, et une série de décisions prises par le groupe dirigeant des années 1970 à aujourd’hui, n’ont pas enrayé son déclin mais l’ont sans doute accéléré. C’est peut-être d’ailleurs davantage le zigzag organisationnel et stratégique, plutôt que telle ou telle décision, qui a dans un premier temps affaibli le PCF. Dans la foulée de la signature du programme commun avec le PS et le PRG en 1972, le groupe dirigeant s’est en effet engagé dans une politique de désouvriérisation de son discours et de son recrutement, se tournant notamment vers les enseignants et les ITC (ingénieurs-techniciens-cadres). Or, après avoir recruté dans ces secteurs et désorienté une partie des militants et cadres ouvriers, le PCF a opéré un revirement idéologique et organisationnel au moment de la rupture de septembre 1977 avec le programme commun. Ce tournant ouvriériste a engendré de nouvelles tensions mais, surtout, masqué paradoxalement selon Mischi une double désouvriérisation du PCF : du personnel et du discours communistes.
Du côté du discours, c’est à partir de la fin des années 1970 que le PCF a peu à peu abandonné toute référence – jugé progressivement archaïque – à l’exploitation, aux luttes de classe, à la classe ouvrière ou au prolétariat, au profit de catégories non-classistes (« cohésion sociale », « vivre-ensemble », « citoyenneté », etc.) et ayant une claire tonalité misérabiliste : « pauvres », « exclus », « défavorisés », « gens », etc. Du côté du personnel, on a vu émerger une nouvelle génération de permanents dits « ouvriers » mais qui, souvent issus de familles communistes5, ont passé un temps très court dans le monde du travail après leur formation professionnelle : ils sont ainsi davantage des produits du PCF, extrêmement dépendants de l’appareil, que des militants ouvriers gagnés aux idées communistes.
Progressivement, c’est la préoccupation de former et de promouvoir des militants issus du prolétariat qui s’est effacée voire a disparu : jusqu’aux années 1970, les ouvriers tendaient à être de plus en plus présents à mesure que l’on montait dans la hiérarchie du parti (en raison de la primauté accordée à la promotion de militants appartenant aux classes populaires) ; à partir des années 1990, c’est l’inverse qui est devenu vrai, comme dans les autres partis institutionnels.
Ce processus s’est trouvé renforcé par le pouvoir accru d’élus qui se sont de plus en plus imposés au parti en opposant une légitimité acquise localement – souvent grâce à l’aura du parti – à la légitimité de l’appareil, ce dernier étant affaibli par des résultats en berne aux élections nationales (pages 177-236). Cette notabilisation des élites communistes locales, et leur autonomisation à l’égard du parti, ont constitué une réponse à l’effritement de l’influence politique du PCF au niveau national, lui permettant de « limiter la casse » à court terme en conservant des élus (députés, maires, conseillers généraux, etc.) et les moyens associés.
Mais cette réponse ne pouvait à terme qu’approfondir ses difficultés politiques et organisationnelles, en éloignant toujours davantage les militants appartenant aux classes populaires d’un parti dominé, d’un côté par des édiles locaux et des cadres de la fonction publique territoriale, de l’autre par des permanents éloignés du monde du travail bien qu’issus du monde ouvrier. Il faudrait encore ajouter à cela le rôle qu’a joué le PCF, notamment au début des années 1980, dans la distance qui s’est creusée entre les jeunes prolétaires « issus de la colonisation » (comme disait Sayad) et la gauche, entre les luttes de l’immigration et les combats contre l’exploitation.
On ne peut pas ici entrer dans le détail des descriptions, particulièrement fouillées, proposées dans ce livre mais, pour ceux et celles qui aspirent et travaillent à (re)construire un parti de classe, il est utile de lire les travaux de Julian Mischi, car ils posent la redoutable question des conditions de possibilité d’une organisation politique largement implantée dans un prolétariat en mutation(s).
Au cours du siècle passé, le PCF est en effet le seul parti à être parvenu – en France – à conquérir une telle implantation et, malgré ses énormes limites (bureaucratisation, dépendance à l’égard de Moscou, électoralisme, ouvriérisme, défaitisme, etc.), il a contribué à la construction d’une conscience de classe et au maintien d’un horizon communiste (même déformé jusqu’à la caricature par le stalinisme). Comprendre les facteurs de son déclin est donc décisif pour nous aujourd’hui, et le livre de Julian Mischi constitue de ce point de vue un outil précieux.
Par Ugo Palheta
- 1. On doit noter le caractère fantaisiste du chiffre annoncé par la direction du PCF de 130 000 « cartes placées ». Notons en outre que l’insertion du PCF dans le Front de gauche n’a pas permis d’enrayer l’hémorragie militante, contrairement à ce qui est régulièrement écrit dans « L’Humanité » ou annoncé par ses dirigeants, puisqu’on comptait, au congrès de 2012, environ 64 000 adhérents et 35 000 votants, contre respectivement 92 500 et 45 500 lors du congrès de 2005.
- 2. Michel Dreyfus et al., « Le siècle des communismes », Paris, Editions de l’Atelier, 2000.
- 3. Le terme même de « désindustrialisation » masque d’ailleurs des évolutions contradictoires, à la fois la quasi disparition des grandes forteresses ouvrières (où le PCF était généralement très puissant), mais aussi l’introduction de logiques industrielles voire tayloriennes dans des secteurs auparavant épargnés ou nouveaux – commerce, télémarketing, etc. –, où le mouvement ouvrier est souvent beaucoup plus faible.
- 4. C’est d’ailleurs le mouvement ouvrier dans son ensemble qui a pâti de ces transformations structurelles et de la guerre sociale menée par les classes dominantes, la CGT passant par exemple – entre 1975 et 1990 – de deux millions d’adhérents revendiqués à 700 000.
- 5. Comme le montre Julian Mischi, le PCF se caractérise par de véritables dynasties familiales. Pierre Laurent, fils de Paul Laurent (membre durant 34 ans du comité central du PCF), n’en est qu’un exemple particulièrement éclatant.