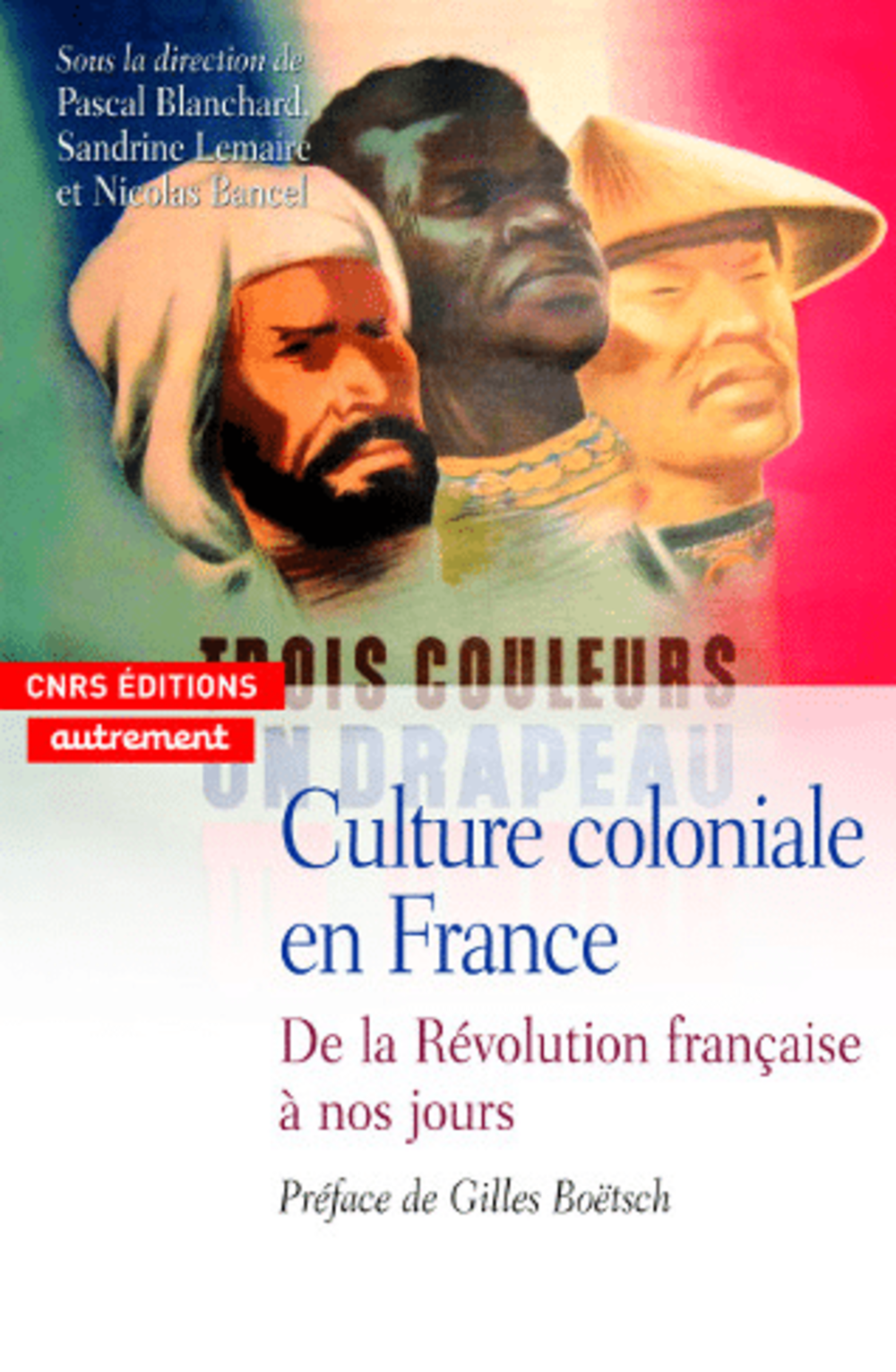Extrait de « Un racisme post-colonial. Un passé qui ne passe pas », publié dans « Culture coloniale en France. De la Révolution française à nos jours », dirigé par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, Éditions Autrement et Éditions du CNRS, 2008.
À la question « Peut-on parler d’un racisme post-colonial ? », nous répondons par une autre question : Comment peut-on ne pas en parler ? Comment peut-on parler des formes contemporaines du racisme sans évoquer deux de ses principales généalogies : les systèmes esclavagiste et colonial ? Comment peut-on nier qu’existe aujourd’hui un profond racisme qui trouve son fondement dans des institutions, des pratiques, des discours et des représentations qui se sont élaborées dans le cadre de l’empire colonial français ?
Stigmate xénophobe et stigmate raciste
Comment peut-on le nier, par exemple, alors que les enquêtes d’opinion mettent en évidence une forme de mépris ou de rejet spécifique, plus fort et plus durable, à l’encontre des immigrés originaires de pays colonisés ? De ces enquêtes, il ressort en effet que, depuis plusieurs décennies, deux phénomènes sont observables : d’une part, les vagues d’immigration les plus récentes sont toujours les plus dépréciées, les plus craintes ou les plus méprisées, tandis que le temps dissipe peu à peu cette crainte et ce mépris ; d’autre part, les immigrés issus de pays anciennement colonisés, notamment d’Afrique, font exception à cette première règle.
En d’autres termes, il convient de distinguer le stigmate xénophobe, qui n’existe sous une forme exacerbée que pour les nouveaux arrivants, et le stigmate raciste, qui cristallise des représentations beaucoup plus profondément enracinées, et qui par conséquent ne perd pas – ou très peu – de sa force avec le renouvellement des générations et leur enracinement en France. Si les immigrants italiens, polonais, arméniens ou portugais ont pu être, à leur arrivée en France, l’objet de discours infâmants et de mesures discriminatoires d’une grande brutalité, souvent comparables par leur forme et par leur violence à ce que subissent aujourd’hui les immigrants post-coloniaux, il n’en est pas allé de même pour leurs enfants, et moins encore pour leurs petits-enfants. On ne peut pas en dire autant des enfants d’immigrés maghrébins ou noirs-Africains, seuls condamnés à l’appellation absurde – mais éloquente politiquement – d’« immigrés de la deuxième ou troisième génération », et aux discriminations qui l’accompagnent.
Essentialisation et naturalisation
Si le racisme est, selon la formule d’Albert Memmi, « une valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de légitimer une agression ou des privilèges », il y a bien un racisme spécifique qui s’est construit comme une légitimation de l’agression et du privilège coloniaux : il y a bien eu essentialisation et naturalisation de « différences culturelles » (notamment la référence musulmane), disqualification « morale » de ces différences, théorisation et production de « l’indigène » comme « corps d’exception » encadré par des dispositifs spécifiques (formalisés notamment, en Algérie, par le Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865). Et ce racisme culturaliste s’est bel et bien transmis de génération en génération, y compris après les indépendances – et cela sans grande déperdition, comme tout système de représentations non-soumis à la critique et à la déconstruction : on peut difficilement nier que dans la société française contemporaine continuent de circuler – et d’agir – de manière massive des représentations du « Noir », de « l’immigré », du « musulman », du « beur » ou de la « beurette » survalorisant une différence « culturelle » (« ils » sont différents de « nous ») en même temps que sont niées les autres différences, notamment de classe ou de « personnalité » (« ils » sont tous les mêmes, et « nous » partageons tous une même « identité nationale »).
Le rôle de l’imaginaire social hérité
Il n’est pas contestable non plus que cette double opération de clivage et d’amalgame produit des représentations clairement infériorisantes (« ils » sont marqués au mieux par la carence ou le retard, au pire par la dangerosité, tandis que « nous » incarnons « la Raison », « l’Universel » et « la modernité »). Il n’est pas contestable enfin que ce discours dévalorisant assure au présent la légitimation d’une situation de domination, de relégation et d’exclusion sociale systémiques.
Le racisme post-colonial n’est donc pas une simple survivance du passé. Il s’agit au contraire d’une production permanente et systémique de notre société, les représentations héritées du passé étant reformulées et réinvesties au service d’intérêts contemporains. C’est bien notre société qui, au présent, continue de produire des indigènes au sens politique du terme : des « sous-citoyens », des « sujets » qui ne sont pas étrangers au sens juridique mais ne sont pas pour autant traités comme des Français à part entière. […]
Marx a bien étudié cette interaction entre passé et présent, et le rôle que joue l’imaginaire social hérité. C’est à travers cet imaginaire que les hommes déchiffrent leur réalité vécue, déterminent les frontières entre un « nous » et un « eux », et fondent leur action présente. C’est en l’occurrence au travers de l’imaginaire colonial qu’ont été appréhendés les immigrés postcoloniaux des années 60 et 70, et qu’a été légitimée leur relégation économique, sociale et politique : insertion par le bas dans les secteurs les plus pénibles du monde économique, négation des besoins sociaux non liés directement aux besoins productifs, réduction de l’homme à une simple force de travail (et en conséquence non-prise en compte de la vie familiale et de l’inévitable enracinement), injonction à la discrétion et à l’apolitisme. La massification du chômage et de la précarité depuis la décennie 1980 s’est réalisée sur la base de cet ordre des dominations dans lequel les immigrés apparaissent comme dominés parmi les dominés, et les Français issus de la colonisation ont hérité de la place de leurs parents. […]
Réponses à deux objections
Deux précisions s’imposent, pour finir, en réponse à des objections récurrentes. Tout d’abord, dire qu’il existe un racisme post-colonial ne revient pas à dire que ce racisme est le seul à l’œuvre dans la société française […], que la colonisation est la seule source du racisme, et que les pays qui n’ont pas eu d’empires coloniaux n’ont pas leurs propres racismes, avec leurs propres fondements historiques. Il est évident qu’il existe en France d’autres racismes, c’est-à-dire d’autres formes de stigmatisation irréductible à la xénophobie : les racismes anti-juifs et anti-tziganes notamment – ou même des formes radicales de mépris social à l’égard de « blancs pauvres » qui s’apparentent à un « racisme de classe ». S’il est parfois utile de le rappeler, il est en revanche absurde, malhonnête et irresponsable de suspecter ou d’accuser a priori – comme beaucoup l’ont fait – de « colonialo-centrisme », de « concurrence des victimes » voire de « banalisation de la Shoah » ou d’antisémitisme toute personne qui se consacre à l’analyse ou au combat contre les racismes spécifiques visant les colonisés ou les postcolonisés. […]
Parler de racisme post-colonial, ce n’est pas non plus prétendre que les descendants de colonisés vivent une situation identique en tous points à celle de leurs ancêtres. Le préfixe « post » est à cet égard suffisamment clair : il marque à la fois un changement d’ère et une filiation, un héritage, un « air de famille ». Là encore, la précision est parfois utile, mais elle est le plus souvent hors de propos, notamment lorsqu’elle sert à « faire la leçon » à des mouvements militants qui sont parfaitement conscients des différences entre les situations coloniale et postcoloniale – et qui le disent de manière claire et répétée. […]