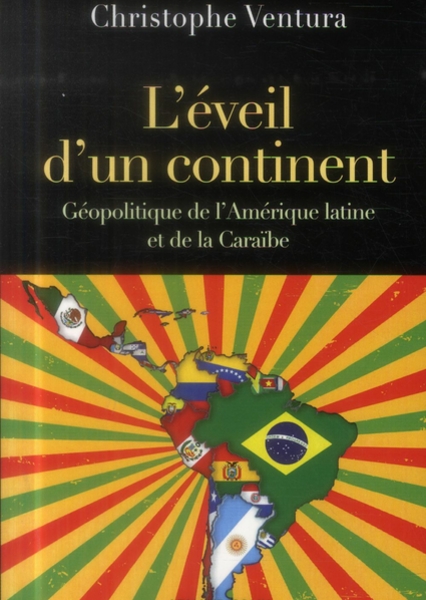En avril 2015 disparaissait Eduardo Galeano, auteur du livre Les veines ouvertes de l'Amérique latine, paru en 1971 et diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires. Cette synthèse sur l'Amérique Latine, ses luttes contre l’exploitation et pour l’émancipation, a marqué plusieurs générations de militants et popularisé la thématique de l'unité du sous-continent, dans une chronique plutôt historique et littéraire, mais aux objectifs politiques clairs.
45 ans après Galeano, Ventura nous propose une autre synthèse. Bon connaisseur de l'Amérique latine, l'auteur est un responsable du Parti de gauche. A la différence de Galeano, qui titrait sur « les veines ouvertes » et commençait par traiter la question de la pauvreté, Ventura part de « l'éveil d'un continent » et de l'essor des « régions dites émergentes » ; au lieu de « la structure contemporaine du pillage » (Galeano), il est ici question de « géopolitique », du « cycle des gouvernements progressistes » et d'intégration régionale. Dans les années 1960, Cuba était isolée dans son combat contre l'impérialisme US. Aujourd'hui, c'est Obama qui serait isolé dans son affrontement avec Chavez. Changement d'époque ? De diagnostic ? Ou bien d'orientation politique ?
L'Amérique latine, une unité ?
Il est utile de repenser la notion d'unité appliquée à l'Amérique latine. Pour Ventura, puisque ce dont il s'agit est d'étudier la géopolitique, cette unité découle naturellement du fait que ce soit une région. Mais si l'on considère quelques moments clés de l'histoire du sous-continent et des ses mouvements d'émancipation, une autre approche peut se dégager. Voyons brièvement les années 1920-30 puis 1960-70.
Les années 1920-30 ont vu se développer le premier débat général au sein des mouvements ouvrier (avec l'Internationale communiste, IC) et anti-impérialiste (au Pérou à travers l'APRA, Alliance populaire révolutionnaire américaine) latino-américains. Dans une IC bureaucratisée, les conclusions furent : caractère féodal du sous-continent et de ses pays ; révolution par étapes, commençant par une révolution démocratique ; rôle dirigeant des partis communistes. Dans ce cadre, on passa alors de la politique de la troisième période (dans laquelle les mouvements nationalistes et petit-bourgeois devaient être détruits) à celle des front populaires, d'alliance avec la bourgeoisie nationale. Cela resta le principe de base des partis communistes pour le reste du siècle.
Même dans un mouvement communiste déjà dominé par l'appareil stalinien, il y eut des débats réels, marqués par la voix dissidente de José Carlos Mariátegui, le dirigeant péruvien qui venait de mener une dure bataille politique avec l'APRA. A partir d'une analyse historique et précise du développement capitaliste de son pays, de la tradition indigène et de la question de la terre, Mariátegui parvint à la conclusion que « l'émancipation de l'économie du pays n'est possible qu'à travers l'action des masses prolétariennes, solidaires du combat anti-impérialiste mondial. »
Les noyaux de l'opposition de gauche en Amérique latine participèrent peu à ce débat, mais commencèrent à élaborer sur la situation de la région sur la base de la critique faite de l'intervention de l'IC stalinisée en Chine. Trotsky lui même écrivit et intervint à propos de l'Amérique latine à partir de son exil au Mexique, et fut en mesure de formuler en 1938 une synthèse.1
On assista dans les années 1960-70 à une nouvelle montée des luttes et des mouvements révolutionnaires, cette fois dans le prolongement de la révolution cubaine. Le castrisme proclama une stratégie continentale contre les Etats-Unis, avec la méthode de la guérilla, tout en affirmant que la révolution serait socialiste. Le stalinisme s'y opposa et continua à défendre l'alliance avec la bourgeoisie. Entre-temps, le continent avait connu un début d'industrialisation. Le soi-disant « développementisme » bourgeois soutenait qu'une alliance avec le capital étranger était possible et nécessaire afin d'impulser un développement national, dans le cadre d'une intervention forte de l'Etat.
Le concept de l'unité de l'Amérique latine résulte dès lors d'une élaboration portant sur la structure de classe des pays de la région, le caractère de la révolution à y mener et le fait que la poutre-maîtresse de la domination capitaliste y soit l'impérialisme américain. Le contenu précis de cette unité est l'objet d'un débat politique et doit déboucher sur un programme d'intervention de la classe ouvrière et de l'ensemble des opprimés. C'est une exigence de la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme.
Une approche géopolitique
L'approche de Christophe Ventura est différente, et pas seulement parce qu'elle est dépourvue de références et de fil conducteur historiques et théoriques. Son schéma est le suivant : l'Amérique latine est une région géopolitique émergente, on y vit maintenant le cycle des gouvernements progressistes et l'on s'y achemine vers une intégration régionale. Bien sûr, ce mouvement n'est pas linéaire, mais c'est lui qui domine.
L'ordre des chapitres du livre est significatif, passant d'un état des lieux de la production et des échanges au cycle politique. La crise de l’économie mondiale capitaliste, la nature de classe des sociétés latino-américaines sont laissées de coté. On ne peut pas reprocher à Ventura de faire ce type d'analyse, mais on peut se demander si cette méthode permet de parvenir à une compréhension de la réalité et, surtout, à des conclusions en termes d'intervention politique qui soient utiles au mouvement d’émancipation et aux luttes populaires.
La thèse du livre est que l'Amérique latine s'est mondialisée, avec de nouveaux modèles productifs aux coûts sociaux et environnementaux élevés, sans rompre avec les mécanismes de la dépendance ; la région reste certes exposée à de multiples vulnérabilités, mais les conditions géopolitiques de l'insertion évoluent dans un sens favorable, alors que dans le même temps les bases d'un marché intérieur régional de consommation se renforcent (p. 48). Le Brésil en est le centre et les gouvernements progressistes sont les agents de ces pas en avant.
Il est pourtant nécessaire de se rappeler que l'« économie mondiale [doit être] considérée non comme la simple addition de ses unités nationales mais comme une puissante réalité indépendante créée par la division internationale du travail et par le marché mondial qui, à notre époque, domine tous les marchés nationaux. »2
Jusqu'à quel point la mondialisation change-t-elle en effet la nature des relations entre l'Amérique latine et l'économie mondiale capitaliste ? La réponse de Ventura est ambiguë, mais les faits sont têtus, et le concept d'« économies émergentes », douteux3. Les rapports d’exploitation (l'impérialisme), la crise, l’arriération et la barbarie restent en effet à l'ordre du jour ; les formes se sont certes renouvelées, mais non les contenus.
La crise de 2007-2008 est passée par là et le bilan actuel des économies de la région s'avère très différent de celui présenté par l'auteur. En réalité, les difficultés s'accumulent.4 Les pronostics divergent. Dans son livre, publié en 2014, l'auteur estime que l'Amérique latine « connaîtra un ralentissement mais ne sera pas menacée au cours des prochains années, en dépit des conséquences durables de la crise de 2008 » ; la croissance à venir en 2015 y est estimée à 3,5 % (p.20). Dans son bilan de l'année 2014, la CEPAL (Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe) estime cependant que la croissance latino-américaine va être de 2,2 % en 2015 et signale qu'il sera difficile d'« inverser le ralentissement ». Quelques mois plus tard, en avril 2015, le même organisme fixe le taux de croissance 2015 à 1 % pour l'ensemble de l'Amérique latine et de la Caraïbe, et à 0 % pour l'Amérique du Sud.
Le Brésil s'avère être un géant aux pieds d'argile. Entre 2007 et 2014, il a accueilli des IDE (investissements directs étrangers) pour près de 500 milliards de dollars, ce qui l'a situé au quatrième rang des IDE dans le monde. Ce sont les entrées de capitaux spéculatifs qui ont généré la « prospérité » du pays, avec le développement du soja OGM comme outil de réassurance. Maintenant apparaît le revers de la médaille. Selon le FMI, dans son rapport 2015 sur l'économie mondiale, le Brésil, qui est confronté à de sérieux problèmes de compétitivité, de corruption, de confiance des entrepreneurs et de déficit fiscal, entrera cette année en récession et sera une source de problèmes pour toute la région.
Voilà en tout cas un nouvel exemple du fait que les lois de l'économie et du développement capitalistes sont toujours plus fortes que les prospectives géopolitiques. En réalité, les pronostics optimistes de Ventura embellissaient la réalité – tout en servant à présenter les « gouvernements progressistes » comme l'horizon politique historique de la région.
Les gouvernements progressistes
En octobre 2014, notre revue publiait un dossier titré « Amérique Latine : les gouvernements ''progressistes'' à bout de souffle ». Y étaient présentées des analyses de la situation au Venezuela, en Equateur, au Brésil, en Argentine et en Bolivie. Huit mois plus tard, le cours des événements a confirmé ces analyses.
Dans son ouvrage, Christophe Ventura dresse une liste de onze gouvernements progressistes, sans y inclure Cuba ni le Pérou (p. 52). Cela peut paraître impressionnant mais, en y regardant de près, on constate que la liste est hétérogène, établie sans définition ni délimitations un peu précises.
Quels sont les traits de ces gouvernements « progressistes » ? Dans l'histoire de l'Amérique latine, on a connu des gouvernements qui se sont affrontés à l'impérialisme et aux vieilles classes dominantes, qui ont mobilisé la population et encouragé un certain développement national : Cardenas au Mexique, la révolution bolivienne de 1952, Velazco Alvarado au Pérou, Cuba en 1959-1962. D'autres ont été renversés par des interventions militaires US : Arbenz au Guatemala en 1954, Camaño en République dominicaine en 1965. Ces gouvernements tentaient de s'affronter à l’arriération et à l'impérialisme en s'appuyant sur une mobilisation des masses.
Ventura insiste sur le fait que les nouveaux gouvernements progressistes surgissent des élections, sont porteurs de changements dans l'insertion de leurs pays au sein de l'économie mondiale et se sont donné une politique d'intégration régionale. Mais les élections sont une chose et la démocratie en est une autre. Et il serait par ailleurs étonnant que le chavisme reconnaisse les élections comme une ligne de démarcation absolue.
Le fil commun de l'« utopie chaviste » et du « réalisme du PT » est à rechercher ailleurs. De manière sommaire, tous ces gouvernements :
• ont suivi une politique renforçant l'insertion de leurs pays dans l'économie mondiale capitaliste ;
• n'ont eu aucune politique d’expropriation du capital, y compris étranger, des banques et de la finance, et ont au contraire recherché des accords avec eux notamment à travers les IDE ;
• se sont adaptés à l'appareil d'Etat existant et l'ont utilisé à leurs fins ;
• ont mis en place, ou tenté de mettre en place, un contrôle étatique du mouvement de masse et des organisations ouvrières et populaires, conduisant aussi à leur répression ;
• ont mené une politique d'aide sociale et de subventions aux secteurs les plus pauvres et aux quartiers et populations marginalisés.
Si l’intégration régionale est un leitmotiv de ces gouvernements, la réalité dans ce domaine est que cela relève plus du discours que des actes. Le Mercosur (Marché commun sud-américain) est en crise. Le Brésil et l'Uruguay souhaitent discuter avec l'UE en dehors du cadre du Mercosur, tandis que le président équatorien, Correa, est déjà en train de négocier son propre traité de libre échange. Quant aux accords passés avec la Chine, ils sont du même type que tous les autres. La construction d'un « Grand Sud » est un mirage.5
Il est vrai que ces gouvernement ont une certaine autonomie politique vis-à-vis des Etats-Unis, qu'ils s'éloignent peu ou prou des canons du néolibéralisme et que leurs régimes politiques diffèrent de ceux de la droite réactionnaire. Mais cela suffit-il pour en faire une nouvelle catégorie, un nouveau palier dans la lutte pour l’émancipation ? L'expérience du début de ce siècle montre que non. On n'est pas dans le socialisme du XXIe siècle, mais dans les turbulences de la crise capitaliste et les difficultés du mouvement ouvrier et de la population opprimée à se donner les moyens politiques et pratiques d'une intervention indépendante.
Marcelo Neuestern
- 1. « Dans les pays industriellement arriérés, le capital étranger joue un rôle décisif. D’où la faiblesse relative de la bourgeoisie nationale par rapport au prolétariat national. Ceci crée des conditions particulières du pouvoir d’Etat. Le gouvernement louvoie entre le capital étranger et le capital indigène, entre la faible bourgeoisie nationale et le prolétariat relativement puissant. Cela confère au gouvernement un caractère bonapartiste sui generis particulier. » (« L’industrie nationalisée et la gestion ouvrière », juin 1938).
- 2. Léon Trotsky, « La Révolution permanente », 1928-31.
- 3. Voir par exemple la critique de Pierre Salama, « Des pays toujours émergents ? », La Documentation française, Paris, 2014.
- 4. Dans le bilan que fait Pierre Salama : « Les principales économies latino-américaines connaissent de nouvelles vulnérabilités : financiarisation, sensibilité exacerbé aux mouvements de capitaux, tissu industriel détérioré, reprimarisation, dépendance vis-à-vis des ‘’remesas’’. A partir de 2012, les difficultés apparaissent. Le miracle économique devient mirage, le nouvel eldorado, fantasme de journalistes et d’hommes d’affaires, n’en est pas un. La convergence avec les économies avancées cesse. Elle est fragile, sa durabilité est problématique car de nouvelles vulnérabilités apparaissent » (« Argentine, Brésil, Mexique entrent dans la tourmente ». Quo Vadis Amérique Latine ? », Paris, 2015).
- 5. Un défenseur du chavisme tel que Claudio Katz l’admet et le dénonce. Sur l’intégration régionale, il écrit : « Le sommet [des chefs d’Etat des Amériques au Panama] a confirmé le degré significatif d’autonomie politique qu’a obtenu l’Amérique latine. Mais cette plus grande indépendance coexiste avec l’enlisement de tous les projets d’intégration économique. » Quant aux accords avec la Chine, les gouvernements « passent de façon individuelle des accords avec la Chine qui aggravent la primarisation » (la dépendance des économies vis-à-vis de l’extraction des matières premières). En conclusion, il s’agit d’une « adaptation à l’ordre néolibéral global » (« Retrato de las Américas en la Cumbre », http://www.rebelion.org/…, 16 avril 2015).