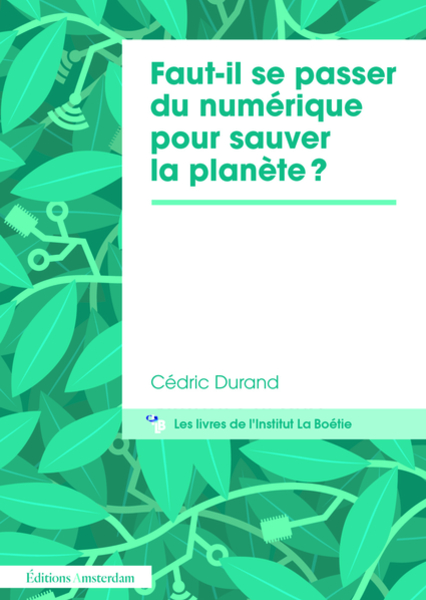Sous un titre qui ne correspond guère au contenu de l’ouvrage, ont été rassemblés trois « cours » donnés par Cédric Durand devant l’Institut La Boétie (lié à LFI). Un post-scriptum postérieur à l’élection de Donald Trump y a été adjoint.
Pouvoir politique et économique du cyberspace
Le premier chapitre reprend le concept de « techno-féodalisme » auquel Cédric Durand a déjà consacré un livre. Même si on peut douter de la validité du concept, l’auteur souligne à juste titre l’emprise des firmes géantes qui ont émergé dans le monde du numérique et ont acquis un pouvoir à la fois économique et politique. Au détour d’une phrase, on sursaute cependant quand on lit que ces entreprises « ont un rôle politique de protection vis-à-vis de leurs salariés, de leurs sous-traitants » : c’est pousser un peu loin l’analogie avec les féodaux du Moyen Âge au détriment de la réalité de la situation des salariéEs de la Silicon Valley (autrefois privilégiée mais qui se dégrade) et surtout de la myriade de forçats du net à travers le monde. De façon plus argumentée, Cédric Durand rappelle que la révolution technologique n’a pas redynamisé le capitalisme dans la durée. En 1994, avait été élaborée une « Charte pour le cyberspace » qui prédisait qu’elle serait salvatrice pour le capitalisme pourvu que soient supprimés tous les obstacles à la liberté entrepreneuriale. En fait, aucune des annonces ne s’est vraiment concrétisée : les taux de croissance ralentissent, la monopolisation se renforce (mais la hiérarchie des firmes a été modifiée) et le travail n’est pas émancipé mais davantage contrôlé.
Privatisation des savoirs
Le deuxième chapitre porte sur la « monopolisation intellectuelle », c’est-à-dire l’appropriation de la connaissance. Il y a toujours eu une volonté du capital de séparer conception, contrôle et exécution pour assujettir les travailleurEs. Mais à l’époque contemporaine, il s’agit d’abord de généraliser la privatisation des savoirs : se développe donc tout un édifice juridique visant à sanctuariser et à mondialiser les droits sur la propriété intellectuelle. Par ailleurs, au-delà de la logique des brevets, les géants du net centralisent des données sur l’ensemble des activités des individus et des entreprises. Et enfin, s’est développée une fragmentation des processus productifs où une part essentielle de la valeur est captée par les entreprises qui maitrisent et organisent ces processus. En fait, la circulation des informations est devenue une infrastructure de l’économie et de la société : les géants du Net sont devenus indispensables à tous les autres agents économiques. Les services que proposent les monopoles numériques ne sont pas des produits comme les autres mais des infrastructures critiques.
La voie du cyber écosocialisme
Le troisième chapitre « La voie étroite d’un cyber écosocialisme » reprend essentiellement des idées d’un ouvrage précédent de Cédric Durand et Razmig Keucheyan sur la « bifurcation » et la planification écologique. Des pistes (qu’il serait trop long de discuter) sont avancées. L’idée essentielle est que le cyber écosocialisme mobilise les systèmes informatiques et les technologies de l’information pour atteindre ses objectifs et remettre en cause le marché comme moyen de mise en adéquation des besoins et des capacités productives. Tout en étant conscient que les technologies existantes ne sont pas neutres et par ailleurs sont de grosses consommatrices d’énergie.
Le post-scriptum écrit après la prise de fonction de Trump montre la convergence entre celui-ci et la « Big Tech » dans le mépris des procédures démocratiques et de l’égalité. Avec Trump, les géants du numérique espèrent se soustraire à toute forme de supervision publique et même se subordonner l’appareil administratif de l’État. Que faire dans ce contexte ? Il n’y a pas de réponse simple, souligne à juste titre Cédric Durand. Mais celle qu’il esquisse, le « front anti-techno-féodal étatsunien », inspiré de la problématique maoïste contradiction principale / contradiction secondaire, n’emporte pas du tout la conviction.
Henri Wilno