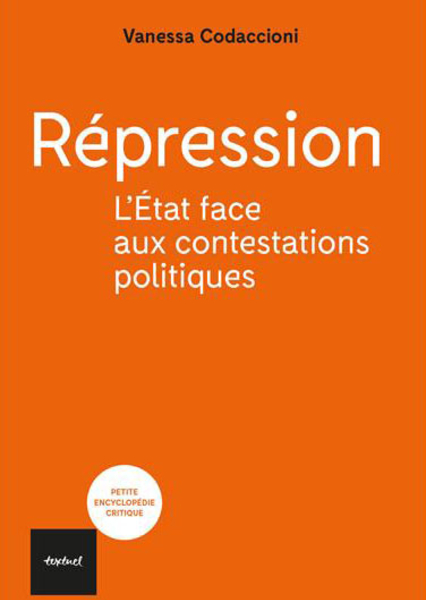Éditions Textuel, 90 pages, 12,90 euros.
Ce petit ouvrage facile d’accès et agréable à lire propose une analyse globale de la répression des contestations politiques en France ces dernières décennies et aujourd’hui. Son auteure sait de quoi elle parle : elle est sociologue à l’université Paris 8, spécialiste de l’étude des actions, légales ou illégales, de l’État français face aux diverses actions politiques, légales ou illégales. Vanessa Codaccioni ne met pas d’emblée l’accent sur les violences policières physiques, sans bien sûr les passer sous silence. Elle montre plutôt qu’il s’agit là d’un des éléments d’un dispositif beaucoup plus global, profond et organisé : une stratégie d’empêchement de toute contestation politique en disqualifiant ces contestations. Il s’agit de faire croire qu’il ne s’agit pas d’actions politiques (en tant que telles elles seraient légitimes dans un régime présenté comme « démocratique ») mais d’actions délinquantes ou criminelles, potentielles ou avérées, « donc » condamnables à la fois sur le plan de légitimité et de la légalité. L’auteure parle à ce propos de « double criminalisation ».
Dépolitisation de la contestation
Elle indique également un changement relativement récent. Jusque dans les années 1960, on traitait les « ennemis politiques » de façon politique, en les traduisant, pour s’en débarrasser, devant des tribunaux d’exception aux mains du pouvoir. Depuis les mesures de 1981-1982, le rôle de ces tribunaux d’exception à finalité politique a été réduit. Le pouvoir passe par d’autres voies, principalement par la dépolitisation. Les dominants utilisent tous les moyens, y compris par les discours (dans lesquels les médias qui leur appartiennent jouent un rôle majeur), pour faire penser que les actions de contestation n’ont pas ou que très peu de contenu politique. Ils réduisent ainsi les révoltes au statut de « violence urbaine » ou de « casse » réalisées par des « émeutiers » ou des « casseurs » imbéciles qui ne feraient que « casser pour casser ». Un syndicat, une association ou un groupe de protestataires devient une « association de malfaiteurs », une « bande organisée » qui commettent des « délits en réunion »... Les accusations de « diffamation » sont désormais fréquentes, même contre la presse ou les universitaires, dont les statuts protègent pourtant encore plus la liberté d’expression que l’article 11 du préambule de la Constitution. Des modalités autrefois banales d’actions syndicales sont maintenant appréhendées exclusivement sur leur forme comme des délits : pseudo-séquestrations de patrons, barrages, et évidemment manifestations « non autorisées » qu’il est facile de multiplier… en ne les autorisant pas. Des manifestantEs sont accusés de « violences » ou de « rébellion » par des agents des « forces de l’ordre » (dominant) assermentés, dont on parvient difficilement à démontrer les mensonges (même si cela peut arriver grâce aux vidéos, comme pour le chef de la BAC de Rennes en 2017). On voit même des internements psychiatriques au motif des prétendus « troubles mentaux » de militantEs présentés comme des « agitéEs ».
« Répression préventive »
Vanessa Codaccioni examine aussi les mesures récentes de « répression préventive » par assimilation de contestations politiques à du « terrorisme », grâce aux mesures d’ « état d’urgence » désormais en grande partie intégrées dans le droit commun, bien qu’illégitimes et illégales au regard des textes internationaux de protection des libertés fondamentales. On accuse les gens à l’avance de projets délictueux, comme des militantEs écologistes avant la COP 21 à Paris en 2015, et même de projets inventés de toute pièce par les services de l’État, comme pour l’affaire de Tarnac. On les assigne à résidence, on les interdit de manifestation ou de séjour dans leur ville, on les place en détention préventive et/ou sous contrôle judiciaire, etc. Ce dispositif de répression est complété par le développement exponentiel d’une justice expéditive, sans instruction ni défense réelle, appelée « comparution immédiate », dont les condamnations sont statistiquement beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus lourdes qu’en procédure normale. Même des avocats sont désormais aspirés dans cette machine à empêcher la contestation, comme celui des zadistes de Bure, en 2018, alors que leur statut et leur rôle dans les procédures judiciaires les en protègent légalement.
Un combat pour protéger le droit de combattre
Enfin, l’auteure donne à voir un aspect majeur de cette tactique de répression avec l’ensemble des mesures d’intimidation, de dissuasion, de terreur : différentes formes de violences policières lors des manifestations (gazages, coups, flash-balls, grenades, y compris mortelles), gardes à vue abusives et massives, insultes, menaces, coups, perquisitions, fouilles, y compris au corps et à nu, traitements inhumains et dégradants, saisies, fichages à long terme... La liste est longue et bien attestée. Il s’agit de rendre invisible l’opposition hors des manières strictement policées des représentants dans les institutions (même le port d’un maillot de foot à l’Assemblée nationale par François Ruffin, député, est condamné).
L’ouvrage se termine sur une réflexion pour mener un combat anti-répression. L’auteure plaide pour une réforme profonde du Code pénal, qu’elle déclare aussitôt impossible pour l’instant. Elle soutient par conséquent un axe majeur, qui consiste à faire connaitre et reconnaitre le caractère politique d’une action, caractère nié par les acteurs de la répression. Le problème central est celui de la grille de lecture des actions. La notion de « lanceur d’alerte » et la protection qu’elle procure pourrait être creusée et élargie. En attendant, Vanessa Codaccioni montre qu’il arrive qu’on parvienne à faire reconnaitre le caractère politique d’une action par la justice (arrêt en 2017 de la cour de cassation en faveur d’un militant toulousain du NPA contre le barrage de Sivens). Quand le gouvernement parle d’ « insurrection » à propos des Gilets jaunes, il admet presque explicitement le caractère politique du mouvement. C’est un combat pour faire reconnaitre la légitimité d’autres combats, parce qu’ils sont politiques, qui est à mener. Un combat pour protéger le droit de combattre, de plus en plus mis à mal par les dérives autoritaires actuelles en France.
Philippe Blanchet