Entretien. Historien spécialiste de la révolution russe, Jean-Jacques Marie sera l’invité de notre université d’été fin août à Port-Leucate, où une large place sera consacrée à cette question.
En tant qu’historien, pourquoi travailler sur la révolution russe cent ans plus tard ? Quelle(s) actualité(s) ?
La révolution russe a ouvert l’ère des révolutions ouvrières engendrées par la décomposition du système capitaliste, exprimée par la domination croissante du capital financier sur le capital industriel. Ce phénomène à la suite de l’échec de la révolution mondiale dans les années 1920, a connu un développement exponentiel qui se manifeste par la croissance vertigineuse de la spéculation financière, la destruction des forces productives qu’elle engendre au profit des pseudo-productions parasitaires (la publicité par exemple qui représente 97 % des recettes du monstre Facebook évalué à 95 milliards de dollars alors qu’il ne produit que du vent, ou les 1 000 milliards de dollars que pèse le marché du jeu vidéo !) et son revers : la permanence des guerres impérialistes évoquée par G.W. Bush lorsqu’il annonçait au moment de la guerre en Irak l’entrée dans l’ère de « la guerre sans fin ».
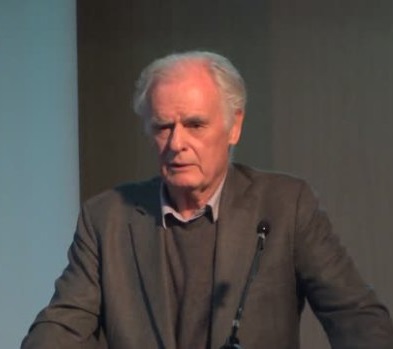
Peux-tu nous dire quelques mots sur le travail historiographique autour de 1917 aujourd’hui en France ? Quelles évolutions, en particulier depuis le Livre noir du communisme publié en 1997 ?
Éric Aunoble répondrait à cette question beaucoup mieux que moi… parce qu’il a tout lu et pas moi ! Deux mots quand même. On trouve souvent – par exemple, chez Alexandre Sumpf – la définition d’Octobre 1917 comme « un coup d’État ». C’est absurde. Un coup d’État remplace une clique gouvernementale par une autre ou, au mieux, un parlementarisme frelaté par la dictature ouverte du Capital sans toucher aux formes de propriété ni à la structure même de l’État, sauf de façon très marginale. Or, Octobre 1917 a débouché sur un bouleversement politique, économique et social radical, qui a concerné aussi bien les rapports de propriété que la structure de l’État.
En revanche, les « Courtoiseries » sur les horreurs et les « crimes du communisme » semblent quelque peu passées de mode. Ainsi l’Histoire de la révolution russe d’Orlando Figes se situe sur un autre plan et tente de la présenter à travers les destinées de groupes humains divers, ce qui atténue la réalité de la lutte des classes.
En gros, la révolution russe est le plus souvent présentée comme un moment particulier d’une histoire proprement, voire uniquement, russe, séparée du mouvement vers la révolution qui secoue alors une grande partie de l’Europe et ébranle la moitié du globe, de la Chine au Brésil. La révolution mondiale ne serait qu’une utopie, un rêve... ou un prétexte. Cela permet d’affirmer rituellement la continuité, toujours affirmée, entre Lénine, partisan de la révolution mondiale, et Staline... qui y est hostile, ou entre le bolchevisme et le stalinisme. Cette prétendue continuité permet de nier l’existence d’une couche sociale spécifique bureaucratique parasitaire, au profit d’une « idéologie » utopique (c’est l’idée centrale de la biographie de Trotski par l’historien ukrainien Tcherniavsky) ou mensongère.
Alors qu’aujourd’hui, y compris à gauche, on s’interroge sur la forme et la nécessité des « partis », que nous apprend la révolution russe sur cette question ?
La mise en cause des partis, conséquence logique du système présidentialiste de la Ve République, est une entreprise réactionnaire, même « à gauche ». La substitution des « mouvements » aux partis est une forme dérivée de cette présidentialisation. Un parti fonctionne avec des congrès qui, au moins théoriquement, définissent des choix politiques et élisent des dirigeants là encore théoriquement responsables devant les délégués élus au congrès, qui peuvent alors ne pas les reconduire. Rien de tel dans un mouvement : le chef parle, vocifère, parade, et « les gens », comme dirait l’autre, sont invités à applaudir, à revenir et à recommencer.
La révolution russe souligne un aspect central : toute révolution monte des profondeurs de la société, d’en bas, mais son mouvement malgré toute sa puissance est aveugle. Les soldats n’ont pas besoin du parti bolchevik pour exiger la paix et quitter les tranchées, les paysans n’ont pas besoin du parti bolchevik pour mettre la main sur les terres, les ouvriers n’ont pas besoin du parti bolchevik pour se mettre en grève contre les fermetures d’usines et les licenciements ou pour exiger des augmentations de salaires. C’est leur « mouvement » naturel. Mais pour que ce mouvement aboutisse, il faut un parti qui traduise sa puissance inconsciente sur le plan de la conscience. Le parti bolchevik lui a donné sa forme politique organisée la plus élevée : la prise du pouvoir, seul moyen pour tenter de réaliser les fins de ce mouvement, qui, sinon s’éparpille, s’épuise, se démoralise. C’est ce qui s’est passé en Allemagne, en Autriche et aussi en Italie, où vociféraient des socialistes dits « maximalistes », imbattables dans la phrase révolutionnaire mais passifs devant l’État monarchique. La révolution dans ces trois pays a commencé alors qu’il n’existait pas l’embryon même d’un parti bolchevik, et le prix à payer pour ces défaites a été dans ces trois pays la victoire du fascisme. Tout cela est archi-connu. Je ne fais là que proférer ce qui était hier une banalité mais qui ne l’est apparemment plus !
Les partis, si dégénérés soient-ils, sont un héritage de l’époque où les forces sociales s’organisaient à travers eux. La dénonciation des partis est une entreprise politique de la bourgeoisie qui préfère aujourd’hui avoir à faire à un petit Bonaparte et même à un sous-Bonaparte – quitte à le fabriquer de toutes pièces comme on vient de le voir – qu’à des forces organisées en partis distincts et plus ou moins concurrents. Il est vrai que l’ère de la bonne vieille « démocratie parlementaire » bourgeoise appartient, pour le Capital, à un passé révolu. Le modèle, ce sont les institutions européennes ou le parlement-croupion français, cautionné par ceux qui prétendent pouvoir y jouer un rôle d’opposant, purement décoratif. Il lui faut donc liquider ou réduire à une apparence fantomatique les partis, déclarés « déconsidérés », alors que ce qui est déconsidéré, c’est la subordination totale de leurs dirigeants aux exigences du Capital. L’objectif premier n’est pas bien sûr de liquider les partis en général, mais d’interdire la formation de partis regroupant les exploités contre le Capital, ses institutions, ses hommes de main et leur politique, c’est-à-dire des partis ouvriers, liquidés dans la plupart des pays – comme en Italie – suite à la décomposition du stalinisme et de la social-démocratie.
1917 ouvre le « court 20e siècle » selon les mots de l’historien Hobsbawm, en particulier le « siècle soviétique ». Le stalinisme qui a emporté la révolution est aujourd’hui disparu. A-t-il aussi emporté « l’idéal communiste » ?
Pour Hobsbawm, le 20e siècle s’achève en 1991 parce que l’URSS alors s’effondre. Pour lui, l’ère ouverte en 1917 se clôt avec cet effondrement. En un mot, le fait que la bureaucratie a fini par liquider l’Union soviétique, comme Trotski l’avait prévu dans la Révolution trahie dans le cas où la classe ouvrière soviétique ne parviendrait pas à la renverser, marque l’échec de la révolution elle-même. Certes, ce recul, ce reflux, permet au Capital de s’attaquer à tous les acquis sociaux historiques, mais n’ouvre pas pour autant une nouvelle période d’essor du capitalisme : il ne clôt donc pas l’ère ouverte par la révolution russe.
Si l’ère ouverte en 1917 s’était achevée en 1991, cela signifierait que le Capital aurait surmonté sa crise mortelle, qui avait engendré à la fois une vague révolutionnaire contenue et deux guerres mondiales, et aurait donc trouvé une nouvelle vie. Or la domination totale du capital financier sur le capital industriel produit du vent et des bulles spéculatives de plus en plus énormes, au détriment de la production de biens… L’an dernier, le très capitaliste Economist, énumérant les principales grandes entreprises de la Silicon Valley dont la capitalisation boursière dépasse 1 000 milliards de dollars, notait : « Ces géants excellent dans des activités peu productives et ne créent plus d’emplois. » Et encore, « peu productives » est un délicat euphémisme... En même temps, le Capital, pour extorquer la plus-value nécessaire à sa reproduction, a déclenché une offensive mondiale pour écraser le coût du travail, développer le travail précaire et démanteler les systèmes de protection sociale arrachés au cours du temps.
La question, plus urgente que jamais, n’est donc pas à mon sens celle d’un « idéal (ou d’une « idée ») communiste » qui relèverait du rêve, mais l’exigence très concrète d’une réorganisation de la société fondée sur l’expropriation du Capital, seul moyen même de sauver les conquêtes menacées.
Propos recueillis par la rédaction

