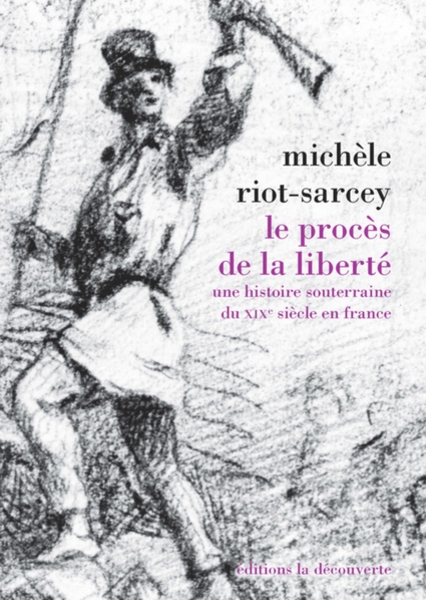«Imperceptiblement, le citoyen actif a fait place au citoyen passif, lequel fut davantage attaché à obtenir des droits qu’à exercer un pouvoir souverain qui lui échappait de toute façon. Ainsi, la pratique de la souveraineté, dont l’idée est ancrée dans l’acte révolutionnaire, s’est-elle transformée au cours des deux derniers siècles en s’adaptant aux nécessités du pouvoir, au dépens de ses bénéficiaires supposés : les déshérités de la part du peuple oublié ».
Nous vivons une époque où existent des résistances, des actions, des collectifs contre la mondialisation, loin de l’Etat ou défiant les systèmes totalitaires, mais dans laquelle l’horizon de l’alternative au libéralisme est un futur obscur. Pour élaborer, travailler à construire cette alternative du XXIe siècle, nous cherchons dans l’histoire les devenirs possibles des bouleversements présents, car nous ne partons pas de rien, mais il y a pourtant presque tout à faire...
La contribution à cette réflexion de Michèle Riot-Sarcey « se rapporte à la redécouverte du mouvement de l’histoire du XIXe siècle, plus précisemment à la recherche de l’historicité des moments singuliers dont on a négligé l’apport novateur ». Pour cela elle refuse la norme de l’histoire selon laquelle le vaincu a mérité de l’être, le vainqueur sert la civilisation et gagne parce qu’il est meilleur. Elle propose de changer notre regard sur le passé en ne suivant pas le cours continu de l’histoire, les certitudes affichées à la lumière des faits tels qu’ils sont advenus, mais « de s’arrêter sur son devenir, car son inachèvement peut être considéré comme le matériau de l’oeuvre de ses innombrables libertés latentes », de travailler davantage sur « l’incertitude du passé ».
Celles et ceux d’en bas ne sont que très rarement maîtres de l’écriture et de la parole, l’opinion des ouvriers n’a pas souvent laissé de trace. Chercher dans les expériences pratiques nous conduit vers l’idée qui fait agir, initie à la révolte, ou tout simplement permet de vivre. Avec ce travail, l’auteure aide à retrouver le sens des mots à l’origine du mouvement émancipateur, car le « contenu des idées les plus libératrices a été à ce point édulcoré qu’il n’en reste qu’un concept devenu instrument de contraintes et d’aliénation. Tel a été le destin, par exemple, des mots liberté, modernité, démocratie ou encore communisme. Le mot réforme lui-même a perdu son sens au cours du XIXe siècle en désignant le contraire d’une avancée vers la justice sociale ».
Pour elle, l’insurrection de février 1848, qui s’achève par la sanglante répression de juin, est une rupture décisive du XIXe siècle, qui se continue dans un mouvement associatif sans précédent. Cette révolution politique et sociale est pour les insurgés l’achèvement de 1789, en s’écartant de la voie destructrice de la terreur, sans oublier l’expérience des journées de 1830. La souveraineté populaire prend forme « pendant l’élection de la garde nationale, dans l’organisation du travail dans les ateliers nationaux, dans la rue au coeur des petits groupes désignant leurs représentants à la commission du Luxembourg, dans les clubs, devenus aussitôt des espaces publics où la parole populaire se fait entendre sans retenue. Et bien sûr au cours des manifestations symboliques, comme à Paris ou Lyon, lorsque la foule marque sa préférence pour le drapeau rouge », avec l’assurance d’une victoire ouvrière, l’abolition des inégalités, de la fin de l’exploitation de l’homme par l’homme. Pour nombre d’entre eux, vivre libre, c’est être maître de son propre travail, ne dépendre d’aucun arbitraire. L’élection au suffrage universel n’est « qu’un complément aux autres formes d’expression de la souveraineté ». La république est le moyen d’aller au socialisme, d’acquérir l’égalité réelle.
En 1848, reprennent vie les collectifs constitués à l’issue des journées de 1830, des révoltes des canuts et des grandes grèves de 1840 pour la diminution des heures de travail et le refus du marchandage (quand le travail était donné au moins-disant, tirant ainsi vers le bas les salaires). Les associations s’appuient sur l’expérience des sociétés d’entraide, de secours mutuel, sur la place qu’elles ont eue dans les luttes, et qu’on retrouvera plus tard dans les grèves des années 1860.
L’autonomie ouvrière s’exprime par les associations, terme qui recouvre des réalités très différentes, de la société de secours mutuel et des associations de défense des intérêts de la profession jusqu’aux coopératives de production. Pour les plus radicales, il s’agit pour les travailleurs associés de démontrer « ce que pourrait être l’organisation sociale à venir ; en d’autres termes, le socialisme vu comme l’auto-organisation des travailleurs. Toute idée d’une avant-garde extérieure aux ateliers ne peut alors se concevoir ».
Le délitement de la liberté
Le chapitre « Qu’est-ce qu’être libre » traite du délitement de cette idée. Dans la poussée révolutionnaire de 1848, la liberté est une conquête à la fois individuelle et collective, car « sans égalité entre les hommes, il n’y a pas de liberté possible (...) Il s’agit de la liberté individuelle acquise à l’issue d’un mouvement d’émancipation politique et sociale (...) le droit naturel, réapproprié, réinventé, suppose une société où le pouvoir de dominer aurait été banni de la civilisation ». Il est indiscutable que le libéralisme, le capitalisme, l’individualisme et la liberté individuelle ont fait perdre au cours des deux derniers siècles le sens du mot liberté « en tant que pouvoir d’agir, intellectuellement, politiquement et socialement (...) [qui] fut un temps, pendant la première moitié du XIXe siècle précisemment, le véritable moteur de l’histoire ».
Michèle Riot-Sarcey revient en détail sur l’influence de Saint-Simon, un des fondateurs de la philosophie du progrès. Nombre de ses disciples vont jouer un rôle important en ce début de XIXe siècle. Saint-Simon trace une histoire de la liberté par le progrès continu des Lumières et de l’éducation, le travail étant au centre du devenir de la civilisation. La liberté ne prend sens qu’au sein des collectifs : la souveraineté populaire n’est pas affaire de droits de l’homme, mais de bonne gestion du monde du travail. Dans cette vision du monde, « devenir propriétaire et accéder à la liberté collective selon la loi du progrès », toute idée d’émancipation est déplacée.
Qu’est-ce que la modernité ? Le progrès et son développement infini ou la quête de liberté de chaque individu ? On revient par là à la question de l’émancipation, abordée par Marx dans le manifeste de la Première Internationale de 1864. « Ni le perfectionnement des machines, ni l’application de la science à la production, ni la découverte de nouvelles voies de communication, ni les nouvelles colonies, ni l’émigration, ni la création de nouveaux débouchés, ni le libre échange, ni toutes ces choses ensemble ne supprimeront la misère des classes laborieuses : au contraire, tant qu’existera la base défectueuse d’à présent, chaque nouveau progrès des forces pruductives du travail aggravera de toute nécessité les contrastes sociaux et fera davantage ressortir l’antagonisme social ». Et il met en avant l’importance des « grandes expériences sociales » des associations.
Comment mettre en oeuvre l’émancipation des travailleurs par eux-mêmes et pour eux-mêmes ? La conviction qu’elle est conditionnée avant tout par l’essor des forces productives et une vision substitutiste du rôle du parti d’avant-garde dans le processus de prise de pouvoir politique comme condition suffisante et nécessaire à l’émancipation des travailleurs, est à l’origine de l’impasse dans laquelle a été englouti le mouvement ouvrier. Dans cette vision, la démarche de libération échappe aux intéressés qui délèguent leur pouvoir d’agir. Car se pose aussi la question du pouvoir politique, tant dans les débats de l’Internationale que dans le Manifeste des soixante1, avec un risque de plus en plus fort : que le combat politique se déplace du côté de la politique détachée de la « question sociale ».
L’esprit de liberté au sein des classes populaire ressurgit lors de la Commune de Paris. Les communards imposent « leur vision réaliste d’un processus républicain où la liberté fut et est aujourd’hui totalement incorporée aux inégalités sociales ». Les expériences de 1848 sont réappropriées, la république retrouve son sens démocratique et social : « un socialisme républicain particulier, dont on ne peut attribuer la paternité aux figures ordinaires de l’histoire : ni socialisme utopique, au sens classique du terme, ni socialisme proudhonnien, ni bien sûr socialisme étatique, mais un socialisme qui a gardé les traces de l’auto-organisation dont les associations de 1848 étaient porteuses. »
L’oubli du principe d’émancipation autonome
Un nouvel ordre se construit sur l’échec et le rejet de la Commune. La république perd son sens originel , échappe aux couches populaires. « La république parlementaire se conçoit, en cette fin de siècle, dans une stricte séparation du politique et du social. Le travail, sous la IIIe République, est en quelque sorte détaché des prérogatives citoyennes. C’est ainsi que “la question sociale” sera traitée hors du domaine politique, au même titre que la question coloniale. » Le développement social dépend ainsi entièrement du progrès, tandis que la politique s’autonomise pour ne se préocuper que du gouvernement des hommes.
Dans les débats du mouvement ouvrier en construction à la fin des années 1870 se « joue l’oubli du principe d’une émancipation autonome des travailleurs concrètement entendue par les ouvriers eux-mêmes ». Marx, dans le débat avec le courant lassallien dont est proche Jules Guesde, conteste que le travail soit la source de toute richesse : « ce sont les conditions d’appropriation de la nature et de la force de travail qu’il importe de ne pas passer sous silence afin de comprendre comment, dans toute société, ces conditions conduisent à l’aliénation des non-propriétaires : la force de travail de ceux-ci, transformée en travail abstrait, devient alors une simple marchandise que l’on échange »2. Ce qui se joue dans ce débat, c’est le fait que l’appropriation centrale des moyens de production supplante l’organisation des travailleurs : seul le parti peut délivrer le travailleur de l’exploitation. Où est la place de l’auto-organisation collective dans cette perspective ? D’autant que les socialistes vont rapidemment adhérer à la vision de la république civilisatrice avec l’illusion qu’étant le nombre, le sugffrage universel pourra modifier le gouvernement sans recourir à l’action révolutionnaire. L’esprit de parti, la délégation de pouvoir vont l’emporter, se substituant aux initiatives et à l’autonomie ouvrières.
Enfin, l’auteure revient sur la question du progrès : « la continuité historique, apparemment réduite à la dimension politique de l’évolution des sociétés, acquiert ses lettre de noblesse historiographiques en édifiant son devenir sur la philosophie du progrès. Un progrès fondé, sur l’essentiel, sur la science, au sens large du terme (...) le développement du social dépend ainsi entièrement des progrès industriels et agricoles, matériels et techniques. Tandis que la politique s’autonomise pour ne se préoccuper que du gouvernement des hommes (...) or on le sait désormais, le progrès de la science n’est pas, loin s’en faut, l’équivalent du progrès de l’humanité. »
Ce foisonnant ouvrage apporte de multiples éléments très utiles à nos réflexions, car il redonne vie à de nombreuses approches oubliées de l’expérience ouvrière du XIXe siècle, autour d’une idée centrale qui doit être au coeur de nos réflexions : la liberté ne se transmet pas de l’extérieur, mais se conquiert par soi-même.
Patrick Le Moal
- 1. Le Manifeste des soixante, rédigé en 1864 par Henri Tolain et signé par soixante ouvriers, défendait une série de revendications propres aux travailleurs et dénonçait les limites de la Révolution de 1789 : « on a répété à satiété : il n’y a plus de classes depuis 1789 ; tous les Français sont égaux devant la loi, mais nous n’avons d’autre propriété que nos bras, nous qui subissons tous les jours les conditions illégitimes et arbitraires du capital, nous qui vivons sous des lois exceptionnelles... »
- 2. Critique du programme de Gotha (1875).