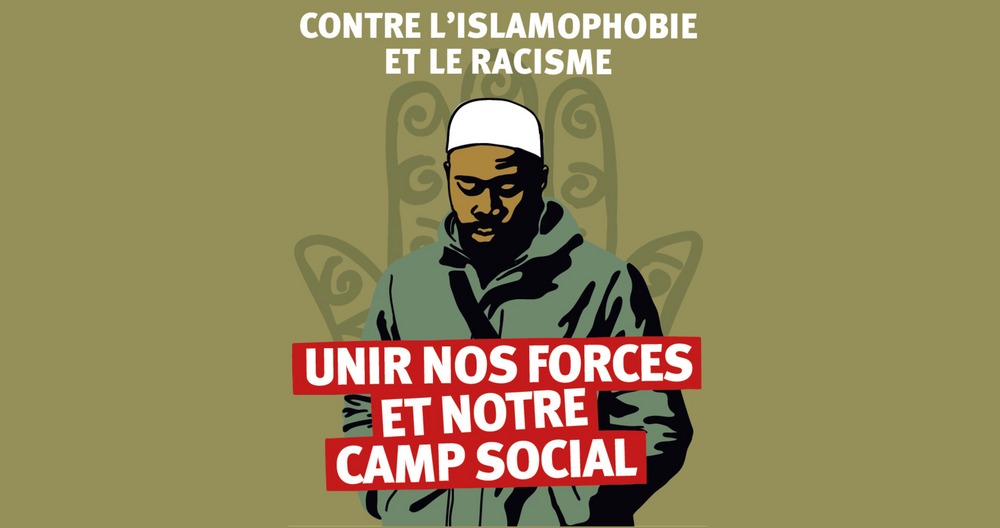Derrière la « guerre au terrorisme » lancée après le 13 novembre 2015, la France a poursuivi une stratégie impérialiste alignée sur celle des États-Unis. Loin de combattre les causes du terrorisme, cet interventionnisme militariste et islamophobe a contribué à le nourrir, tout en consolidant un ordre sécuritaire et raciste à l’intérieur. Refuser le campisme reste essentiel pour analyser ces dynamiques sans renoncer à l’internationalisme.
Après le 13 novembre 2015, l’État français s’est engagé dans une nouvelle « guerre au terrorisme », mimant les justifications idéologiques de l’impérialisme étatsunien dans l’espace européen en vue de concurrencer la recherche d’hégémonie de l’allié atlantique. Devenue, après les attentats, la deuxième puissance militaire engagée en Syrie, elle s’est ensuite efforcée — jusqu’à l’échec des opérations Barkhane en 2019 — de maintenir un rôle de premier plan dans la « lutte contre le terrorisme ». Depuis, son déclin dans les rivalités inter-impérialistes du Nord n’a cessé de se confirmer.
Un interventionnisme impérialiste et islamophobe
Les interventions impérialistes menées par le gouvernement Hollande ont joué un rôle dans l’essort du terrorisme qui a frappé la France, notamment depuis l’intervention militaire au Mali en 2013. Il ne s’agit évidemment pas de reprendre à notre compte le discours de ces organisations terroristes, aujourd’hui largement défaites. Il s’agit de chercher à expliquer leur développement, ce qui suppose de de comprendre que l’interventionnisme au nom de « l’anti-terrorisme » promu par la France s’inscrit dans une logique impérialiste et islamophobe.
Comme l’explique David Harvey dans Le Nouvel impérialisme, s’appuyant sur les travaux d’Ernest Mandel, l’islamophobie et les guerres menées « contre le terrorisme » constituent un moyen de reconstruire un consensus politique et de restaurer le soutien à l’État, malgré l’intensification de l’exploitation capitaliste. Dans un contexte de crise de suraccumulation du capital, l’État ne peut plus jouer le rôle d’arbitre cherchant à stabiliser la lutte des classes par des compromis sociaux. Il se légitime alors par des opérations sécuritaires et militaires : c’est là l’une des bases économico-politiques de la fascisation et du renforcement des politiques racistes exercées sur une partie de la population désignée comme son ennemi intérieur.
Contre tous les campismes
C’est l’une des forces de notre courant politique que de refuser le campisme. Ce rejet est essentiel : il nous permet d’affirmer partout notre solidarité avec les peuples et les résistances — avec les PalestinienNEs, les UkrainienNEs, les Kanak — sans céder à une logique de blocs. Mais ce refus du campisme implique aussi d’adopter une lecture rigoureuse et nuancée de traditions politiques qui ne sont pas les nôtres. Il faut donc pouvoir affirmer que les organisations terroristes se réclamant de l’islam sont les ennemies de nos ennemis que sont les États impérialistes occidentaux, sans être nos alliées dans la lutte contre notre propre impérialisme. Elles sont mêmes nos ennemies, non abstraitement parce qu’elles se réclameraient de l’islam, mais parce qu’elles sont opposées à nos organisations sœurs dans les pays où elles mènent l’essentiel de leur activité politique, et ennemies de notre classe ici, puisqu’elles frappent indistinctement la société civile et renforcent la pression raciste qui s’abat sur les communautés musulmanes.
Leurs attentats en France constituent, pour partie, une réponse — moralement inacceptable et politiquement désastreuse — à l’impérialisme occidental que nous combattons. Ces organisations terroristes se réclament d’un discours anti-impérialiste. Faire comme s’il ne comptait pour rien dans leur pouvoir de séduction, c’est se condamner à ne pas comprendre le phénomène.