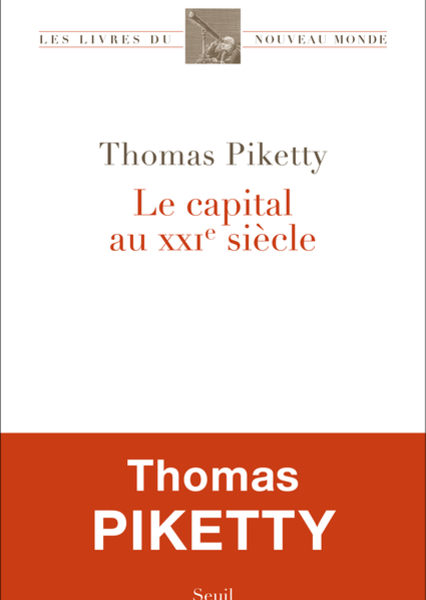Jean-Paul Petit *
Thomas Piketty n’est pas un révolutionnaire ni un anticapitaliste. Sa préoccupation est d’éviter la crise de la société capitaliste démocratique actuelle. Il n’est pas non plus égalitariste, mais attaché à ce que les inégalités, si elles existent, puissent être légitimes. Son livre le plus récent (1) vise donc à conseiller des réformes permettant, à son avis, la continuité de la société démocratique actuelle et le dépassement de sa crise. Pourtant, l’analyse du capitalisme actuel qu’il présente ne va pas aider à légitimer ce dernier.
Pour préciser le cadre théorique et conceptuel de son étude, Thomas Piketty écrit « je fais partie de cette génération qui a eu 18 ans en 1989, bicentenaire de la révolution française, mais aussi et surtout année de la chute du mur de Berlin. Je fais partie de cette génération qui est devenue adulte en écoutant l’effondrement des dictatures communistes et qui n’a jamais ressenti la moindre tendresse ou nostalgie pour ces régimes et pour le soviétisme. Je suis vacciné à vie contre les discours anticapitalistes convenus et paresseux (…). Cela ne m’intéresse pas de dénoncer les inégalités ou le capitalisme en tant que tel, (…) les inégalités sociales ne posent pas de problème en soi, pour peu qu’elles soient justifiées, c’est-à-dire fondées sur l’utilité commune (…). Ce qui m’intéresse c’est de tenter de contribuer (…) à déterminer les modes d’organisation sociale (…) les plus appropriées permettant de mettre en place réellement et efficacement une société juste, dans le cadre d’un État de droit, dont les règles sont connues d’avance et peuvent être démocratiquement débattues. » (p. 62)
En introduction de son livre, Thomas Piketty déclare « La croissance moderne et la diffusion des connaissances ont permis d’éviter l’apocalypse marxiste, mais n’ont pas modifié les structures profondes du capital et des inégalités (…). Dès lors que le taux de rendement du capital dépasse durablement le taux de croissance de la production et du revenu, ce qui était le cas jusqu’au XIXe siècle et risque fort de redevenir la norme au XXIe, le capitalisme produit mécaniquement des inégalités insoutenables, arbitraires, remettant radicalement en cause les valeurs méritocratiques sur lesquelles se fondent nos sociétés démocratiques. » (p. 16).
Dans les pages qui suivent, il présente les théories successives de Malthus à Kuznets en passant par Ricardo et « son principe de rareté », Marx et « le principe d’accumulation infinie ». Il s’attarde quelque peu sur ce dernier en écrivant « le principe d’accumulation, la tendance inévitable du capital à s’accumuler et à se concentrer dans des proportions infinies, sans limite naturelle – d’où l’issue apocalyptique prévue par Marx : soit l’on assiste à une baisse tendancielle du taux de rendement du capital (…) qui peut conduire les capitalistes à s’entredéchirer, soit la part du capital dans le revenu national s’accroît indéfiniment (ce qui conduit les travailleurs à s’unir et se révolter). Dans tous les cas aucun équilibre socio-économique ou politique stable n’est possible ». Il poursuit « nous verrons cependant que, (…) l’analyse marxiste conserve sur plusieurs points une certaine pertinence. Tout d’abord Marx part d’une vraie question (une invraisemblable accumulation de richesse pendant la révolution industrielle) et tente d’y répondre, avec les moyens dont il dispose (…). Le principe d’accumulation infinie défendu par Marx contient une intuition fondamentale pour l’analyse du XXIe siècle comme du XIXe, et plus inquiétante encore que le principe de rareté de Ricardo. Dès lors que le taux de croissance de la population et de la productivité est relativement faible, les patrimoines accumulés dans le passé prennent une importance (…) démesurée et déstabilisatrice pour les sociétés » (pp. 28-29).
Il présente ensuite la théorie de Kuznets de « la courbe en cloche » selon laquelle les inégalités d’abord croissantes en régime capitaliste deviendraient au cours du processus d’industrialisation, décroissantes. Piketty intitule le paragraphe où il présente cette théorie « une bonne nouvelle au temps de la guerre froide ». Il rapporte d’ailleurs que Kuznets lui-même « prit soin de préciser que l’enjeu de ses prédictions optimistes étaient tout simplement le maintien des pays sous-développés dans l’orbite du monde libre ». Il poursuit : « la forte réduction des inégalités de revenus qui se produit un peu partout dans les pays riches entre 1914 et 1945 est avant tout le produit des guerres mondiales et des violents chocs économiques et politiques qu’elles ont entraînés et n’a pas grand-chose à voir avec le paisible processus de mobilité intersectorielle décrit par Kuznezts ». (pp. 36-37) La lutte des classes en quelque sorte !
Pour terminer son introduction, Thomas Piketty présente les principaux résultats de son étude.
► « L’histoire de la répartition des richesses est toujours une histoire profondément politique », comme la réduction des inégalités observée dans les pays développés de 1910 à 1960, puis de la remontée des ces inégalités depuis les années 1970.
► « La dynamique de la répartition des richesses met en jeu de puissants mécanismes poussant alternativement dans le sens de la convergence et de la divergence ».
Pour la convergence, l’auteur parle de la diffusion des connaissances par l’investissement dans la formation, « mécanisme central qui permet à la fois la croissance générale de la productivité et la réduction des inégalités, à l’intérieur des pays comme au niveau international » entre les pays (cas des dits BRICS — Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). De même il souligne le développement de l’instruction, des jeunes filles en particulier, pour assurer la transition démographique.
Pour les forces de divergence, l’auteur note le processus de décrochage des plus hautes rémunérations.
La force divergente fondamentale pour l’auteur est que le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance des revenus et de la production, avec une forte concentration du patrimoine. Pour illustrer ce phénomène, un graphique indique entre 1870 et 2010 la valeur du capital privé C, en pourcentage du revenu national R, pour les trois puissances européennes Allemagne, Angleterre, France : de 1870 à 1910, C/R est de 6 à 7 ; chute brutale de 1910 à 1920, C/R varie de 2,5 à 4,5 ; baisse plus lente jusqu’en 1950 puis stabilisation entre 2 et 3,5 jusqu’en 1970 pour enfin remonter entre 4 (Allemagne) et 5,5 (France) en 2010.« Lorsque le taux de rendement du capital dépasse significativement le taux de croissance (…) cela implique mécaniquement que les patrimoines issus du passé se recapitalisent plus vite que le rythme de progression de la production et des revenus. Il suffit aux héritiers d’épargner une part limitée des revenus de leur capital pour que ce dernier s’accroisse plus vite que l’ensemble de l’économie, (…) et [soit] potentiellement incompatible avec les valeurs méritocratiques et les principes de justice sociale (…) de nos sociétés démocratiques modernes ». (p. 55)
Pour expliquer ces changements dans la variation du stock de capital par rapport au revenu, l’auteur avance plusieurs explications. La baisse de 1910 à 1950 est, selon Piketty, liée aux destructions de la guerre mais surtout à l’inflation après la première guerre mondiale avec abandon de l’étalon or et à une bagatelle comme la révolution russe qui entame la confiance de la bourgeoisie dans sa bonne étoile (annulation des emprunts russes), instauration de l’impôt sur le revenu, puis des mouvements sociaux comme 1936, la deuxième guerre mondiale et les nationalisations de 1945. La stabilisation correspond aux « 30 glorieuses » avec un taux de croissance important qui maintient le rapport s/g (taux d’épargne/taux de croissance ; voir infra) entre 2 et 3, avec enfin un retour à la situation du début de siècle à partir des années 1980 en concordance avec la restauration capitaliste dans les pays de l’ex-bloc soviétique, la fin du rattrapage technologique des BRICS, les privatisations en France, Angleterre et Allemagne et une baisse de la croissance en liaison avec la transition démographique.
Par ailleurs, l’auteur semble renvoyer d’un revers d’ironie la prétendue substitution de la « guerre des classes » par « la guerre des âges » car cette« forme de conflit est somme toute moins clivante pour une société, puisque chacun est tour à tour jeune et vieux » (p. 49). Cette substitution des « guerres » est, pour les libéraux pur jus, une cause centrale.
La « formule fondamentale du capitalisme »
L’auteur consacre, dans un souci pédagogique qu’il faut saluer, un chapitre à ce sujet, en définissant les termes employés. Cependant eu égard à ce souci, l’éclairage n’est pas complet.
Plaçons-nous dans l’hypothèse d’une économie monde où le revenu net est égal à la production nette de valeur (d’échange). Il n’y a pas de commerce extraterrestre pour l’instant !
Cette formule s’exprime par :
α = r. C / R ou α = r . β ou R . α = r . C
Où r représente le taux de rendement du capital (ce que rapporte le capital en moyenne sur une année sous forme de loyers, dividendes, etc.. en pourcentage) ; C le capital, qui semble correspondre au « capital constant C » de Marx (capital immobilier, machines, capital financier, brevets… tout ce qui peut être possédé et vendu sur un marché, capital fixe et capital circulant) ; R les revenus = revenus du capital (PL : plus-value en terme marxiste) + revenus du travail (V : capital variable en terme marxiste)
Le terme α représente la fraction en % de la production nette annuelle, égale aux revenus nets annuels, consacrée à la rémunération du capital. En d’autres termes, en substituant les symboles « marxistes » il est possible d’écrire : α = PL/ (V + PL) ; Soit par substitution PL / (V + PL) = r . C / (V + PL) soit PL = r . C ; Le terme α représente le rapport C/R (J’ai assimilé C au capital constant de Marx, et R à la somme V + PL, salaires et plus-value distribuée entre les différents secteurs des possesseurs du capital).
La formule abstraite α = r . β masque la prétention du capital à être la seule source de la richesse, le seul créateur de la richesse nouvelle, comme le met en évidence la seconde formule. Au moins depuis Marx, nous savons qu’il ne faut pas s’arrêter à ce que la capital dit sur lui-même, et que la plus-value n’est pas le résultat miraculeux d’un accroissement spontané du capital, que cette métamorphose de C en C’ nécessite l’intervention humaine sous forme de producteur (intellectuel et/ou manuel, pour dissiper tout malentendu), que cette plus-value PL n’est que la différence entre la valeur d’échange d’une marchandise particulière, la force de travail humaine (intellectuelle et/ou manuelle) et la valeur d’échange que produit cette même force de travail, bien matériel ou immatériel, vendu sur les « marchés ». Que la force de travail produise plus que ce que nécessite sa reproduction n’est pas caractéristique du capitalisme, l’appropriation du surproduit par une couche particulière de la société (la classe possédant le capital, la bourgeoisie), à son seul bénéfice, seule caractérise le capitalisme.
Il faut noter enfin que α = PL / (V + PL) est différent du taux de plus-value PL / V et que r = PL / C est différent du taux de profit égal à PL / (C + V). Ce taux de profit de fait seul intéresse le capitaliste, car pour assurer une production, il faut non seulement avancer le capital constant C mais aussi le capital variable V, les vitesses de circulation de ces capitaux peuvent être différentes, cependant les cycles de production peuvent être longs avant que l’équivalent du capital variable (et la fraction du capital constant) ne soit récupéré par la vente de la marchandise produite. Du point de vue capitaliste, il faut faire tendre le taux de profit du capital vers le taux de rendement du capital en diminuant (voir annulant) le capital variable V : c’est le rêve de « l’usine sans ouvriers », mais sans travailleurs pas de plus-value, contradiction insurmontable du capitalisme.
Dans le cadre d’un capitalisme mondialisé comme actuellement, la plus-value mondiale produite par l’ensemble des travailleurs et travailleuses de la planète, les bas salaires des pays « en développement » associés à des régimes politiques peu regardants en ce qui concerne les droits du travail et des libertés démocratiques, permet d’augmenter le taux de rendement r du capital. Le patrimoine mondial, de la bourgeoisie mondiale, n’est pas « harmonieusement » réparti. Des « nations » ayant un fort patrimoine (du fait de l’histoire coloniale entre autres ou d’une situation monopolistique) peuvent ainsi détourner à leur profit une fraction plus que proportionnelle à leur population de la richesse nouvelle produite. Cela ne veut pas dire que les personnes sans patrimoine seront pour autant bénéficiaires de ce rapt, contrairement à la vulgate qui énonce que « les pays riches exploitent les pays pauvres ». Il ne faut pas confondre la classe des propriétaires du capital d’un État avec l’ensemble de sa population. La loi de péréquation du taux de profit au niveau mondial explique que le capital ne se préoccupe que marginalement de la composition organique du capital, donc du secteur de production dans lequel il s’investit, sauf à la marge dans le cadre de la concurrence.
Cette même formule = r . permet de maintenir l’illusion du spéculateur qu’il « crée de la valeur, de la richesse » par ses simples actions d’achat et de vente sur un marché de biens réels comme les matières premières, ou de pures fictions comme les titres subprimes pourvu qu’en fin de journée son patrimoine soit supérieur à celui du matin, alors qu’il n’a, en réalité, que détourné une fraction de la plus-value mondiale à son bénéfice. D’où l’illusion de la création ex nihilo de richesses nouvelles.
Ainsi va le capitalisme.
La seconde loi du capitalisme
Elle s’exprime par α = C/R = s/g = Te/Tc de manière asymptotique (en s’en rapprochant de plus en plus sans jamais l’atteindre).
Où s = Te = taux d’épargne en % (s comme save )
Et g = Tc = taux de croissance en % (g comme growth)
Cette loi n’est que l’expression de la limite du rapport capital / revenu (patrimoine / revenu).
Selon la première loi : α = r . C/R il résulte l’égalité suivante : α/r = C/R = s/g
Si r = g alors α = s = PL / (V+ PL) la part du capital est égale au taux d’épargne s. Dans ce cas l’épargne correspond à la totalité du revenu du capital. Le capitaliste ne consomme plus rien. Il va sans dire que cette situation est peu probable.
Si r > g alors α = r . s / g > s la part du capital est supérieure au taux d’épargne, la plus-value PL doit augmenter et/ou le capital variable V (salaire) diminuer. C’est le cas, le rendement du capital est supérieur au taux de croissance du PIB mondial net. Plus le rendement du capital est grand relativement au taux de croissance, plus il y a pression sur les salaires, plus la productivité doit augmenter pour accroître la plus-value.
Ces lois ne nous disent rien de la répartition du patrimoine (du capital). L’auteur écrit (p. 698) : « Si l’on adopte la même démarche globale que ces rapports (classement Forbes et autres publications de banques spécialisées dans la gestion de patrimoine) et si l’on confronte les différentes estimations disponibles, on peut aboutir approximativement à la conclusion suivante. L’inégalité de la répartition des patrimoines au niveau mondial au début de l’année 2010 apparaît comparable à celle observée au sein des sociétés européennes vers 1900-1910. La part du millime [1/1000, soit 0,1 % de la population] supérieur semble être de près de 20 % du patrimoine total, celle du centile [1/100, soit 1 % de la population] supérieur d’environ 50 %, et celle du décile [1/10, soit 10 % de la population] comprise entre 80 % et 90 % : la moitié inférieure de la population mondiale possède sans aucun doute moins de 5 % du patrimoine total. »
Il poursuit (p. 701) : « Il est important de réaliser que l’inégalité r > g, doublée de l’inégalité du rendement du capital en fonction du niveau initial de la fortune, peut potentiellement conduire la dynamique mondiale de l’accumulation et de la répartition des patrimoines vers des trajectoires explosives et des spirales inégalitaires hors de tout contrôle. » Dans un paragraphe (p. 714), par l’étude des rendements des dotations des 850 universités américaines, qui seules publient des informations substantielles, l’auteur montre que le rendement varie entre 10,2 % pour les mieux dotées et 6,2 % pour les moins dotées pour les années 1980-2010. Ce phénomène est généralisable : plus le patrimoine est important, moins il est coûteux relativement de se payer les meilleurs experts de la finance. Le taux de croissance est à la même période en moyenne inférieur à 2,5 %.
Face à ces constats et analyses, Piketty, dans un souci de préserver les sociétés démocratiques, propose d’instaurer un impôt général sur le capital au niveau mondial, afin de résorber la dette d’une part et de contrecarrer la « dissidence des classes possédantes, riches et hyper riches ». Citons l’auteur : « L’impôt mondial sur le capital est une utopie : on imagine mal à brève échéance l’ensemble des nations du monde s’accorder sur la mise en place, établir un barème d’imposition s’appliquant à toutes les fortunes de la planète, puis répartir harmonieusement les recettes entre les pays. Mais c’est une utopie utile (…). Nous verrons qu’à défaut d’une solution de cette nature, qui dans sa forme complète exige un niveau élevé et sans doute peu réaliste à moyen terme de coopération internationale, (…) il est probable que prévaudront diverses formes de repli national. (…) Ces politiques mèneront à des frustrations (…) et à des tensions croissantes entre les pays. » En effet l’auteur écrit (p. 833) « l’histoire de l’impôt progressif au cours du siècle écoulé suggère que le risque de dérive oligarchique est réel, et n’incite guère à l’optimisme (…). Ce sont les guerres qui ont conduit à l’émergence de l’impôt progressif et non le jeu naturel du suffrage universel. L’expérience de la France de la Belle Époque démontre si besoin est le degré de mauvaise foi atteint par les élites économiques et financières pour défendre leurs intérêts (…) ».
Que dire de plus. L’impôt mondial sur le capital est sans doute plus utopique que l’hypothèse de la révolution socialiste mondiale, utopie utile également !
En ce qui concerne la dette, l’auteur examine les 4 solutions :
► L’inflation, ce fut la méthode utilisée par la France et l’Angleterre suite à la deuxième guerre mondiale, simple, mais qui selon l’auteur ne touche que les petits patrimoines, les autres se mettant à l’abri par l’immobilier, et cette inflation a plongé les vieux salariés dans la misère.
► Révoquer, annuler la dette. Cette solution comme la précédente ne pénalisera que ceux qui ne peuvent pas s’échapper, selon Piketty. Il y voit un étrange assentiment de quelques institutions comme le FMI, la BCE (les haircuts — ou réduction de la dette — à la grecque).
► Un impôt sur le capital, qui est pour l’auteur la seule véritable solution, mais…
► Une politique d’austérité prolongée qui pénalise le peuple et aggrave la situation générale (solution adoptée par l’Angleterre suite aux guerres napoléoniennes et par l’Europe actuellement).
L’auteur semble suggérer que l’économie mondiale est entrée dans une phase longue de faible croissance, pour deux causes principales :
1) La croissance démographique est entrée dans sa phase de ralentissement, la transition démographique étant quasi généralisée, à l’exception de l’Afrique
2) et d’autre part en raison de l’épuisement de la révolution industrielle et technologique (le rattrapage technologique est réalisé). Le nucléaire et l’ère de l’informatique n’ont que marginalement amélioré la véritable révolution énergétique permise par le moteur à combustion externe ou interne et la force motrice électrique, de la fin XVIIIe et du XIXe siècle. En quelque sorte les XIXe et XXe siècles seraient une parenthèse de forte croissance démographique et productive, entre une longue période (de l’origine au XVIIIe) et le XXIe siècle de faible croissance, en l’absence d’une révolution scientifique et technologique de même ampleur. La baisse du taux de croissance, en absence de la diminution du taux d’épargne, engage un accroissement quasi automatique, dans l’économie capitaliste, des inégalités avec les risques potentiels d’explosion sociale. D’où le cri d’angoisse de l’auteur en appelant à la sagesse des riches pour préserver une société libérale démocratique. La question écologique n’est évoquée qu’en fin d’ouvrage dans un court paragraphe.
En conclusion de cette présentation, le livre de Piketty est d’une lecture profitable pour tous les anticapitalistes. Les nombreux graphiques illustrent les principales évolutions, l’auteur examine les différentes zones économiques sur la longue période, dans la mesure des informations disponibles et ses références à la littérature sont nombreuses. L’auteur est pédagogue, les 900 pages ne sont pas celles d’un roman balzacien mais la lecture en est fort utile. ■
* Jean-Paul Petit, enseignant retraité, est militant du Nouveau parti anticapitaliste (NPA, France) et de la IVe Internationale.
Notes
1. Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Le Seuil, Paris 2013, 25 €