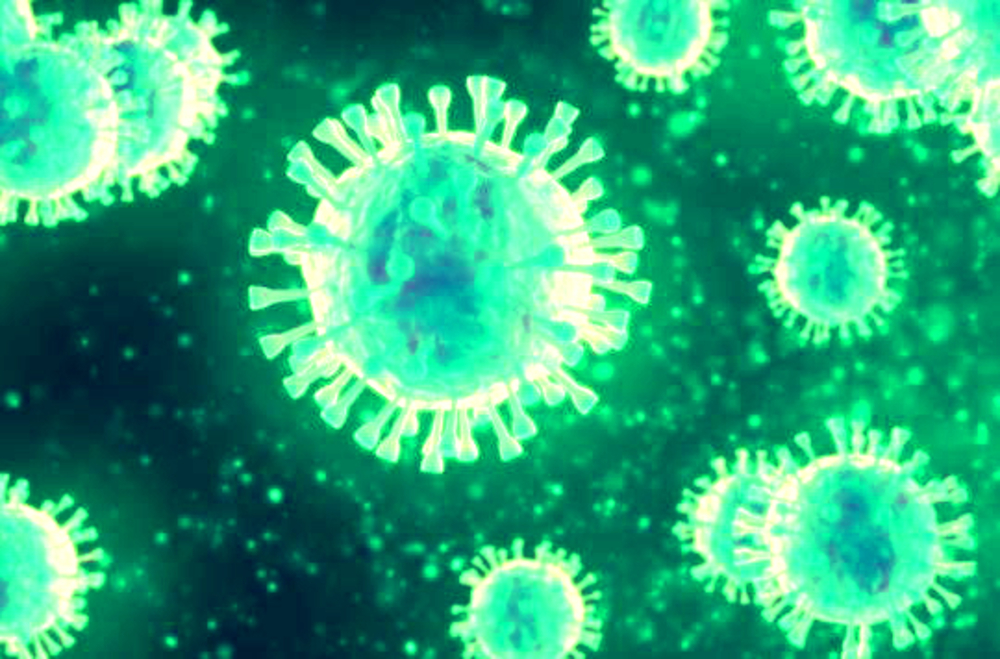Suite à l’article de Sonia Shah1 dans le Monde diplomatique de mars, un début de débat dans la Commission écologie du NPA a posé la question de la pertinence ou pas du lien entre les questions d’environnement et les pandémies.
La question me paraît légitimement posée. En effet, on peut se demander si le lien entre la déforestation qui induirait une augmentation des contacts entre Homo sapiens et d’autres espèces (en particulier les chauves-souris) est réel à l’heure où on indique bien que les humains ont « perdu » le contact avec la nature. Il paraît en effet intuitif de penser que les populations d’avant le capitalisme et plus encore d’avant le néolithique devaient être plus en contact avec la faune sauvage, donc du coup plus exposées auxdites pandémies.
Les virus
Avant d’entrer dans le débat, il me semble indispensable de faire le point sur les pathogènes (en particulier les virus) et leur place dans les écosystèmes.
Il y a en fait deux types d’écosystèmes sur la planète : ceux que tout le monde connaît bien, constitués en résumant d’unités paysagères associant un environnement physico-chimique dénommé biotope et une communauté vivante, caractéristique de ce dernier, la biocénose2 et ceux que l’on a tendance à oublier qui ne sont pas des unités paysagères, mais les individus de chaque espèce. En effet, chaque individu humain par exemple abrite en lui une biocénose propre à l’espèce et en même temps individuelle. Nous hébergeons en nous plus de bactéries ou virus que de nos propres cellules constitutives.
Ainsi, le génome humain rassemble 100 000 fragments d’ADN rétroviral, soit 8% du total3. Les virus ont évolué pour se disperser, les génomes de l’hôte pour en freiner l’expansion. C’est la coévolution, constitutive du vivant. Si ces micro-organismes existent au sein de chaque individu de chaque espèce, c’est que la sélection naturelle ne les a pas éliminés et donc qu’ils ont trouvé leur place. Cela concerne aussi les pathogènes.
Si un pathogène est trop pathogène (il élimine trop de ses hôtes ou trop vite), il va vite disparaître car pour exister il a non seulement besoin d’exister dans l’individu mais aussi de « sauter » dans d’autres individus, faute de quoi la mort du premier individu infecté constituerait… la fin du pathogène lui-même !
En arrivant dans le premier individu (par mutation par exemple), le virus s’insère dans le génome de l’hôte dont il va être dépendant pour assurer sa reproduction (il utilise la machinerie cellulaire de l’hôte pour assurer sa réplication et sa synthèse). Au passage, les virus ne seraient pas des « organismes vivants » puisqu’ils ne sont pas autonomes. Mais c’est un autre débat !4
Le virus créée un bouleversement (son caractère pathogène), la « victime » va se défendre et au bout d’un moment (quelques centaines de milliers ou millions d’années) les deux ont « intérêt » à un armistice ! Une espèce d’équilibre (instable certes) garantissant la survie des deux.
Le virus (ou autre pathogène) a intérêt à se faire quelque peu oublier et donc à payer un « loyer ». Il apporte trois avantages majeurs à l’hôte :
- Une variabilité génétique (il modifie le génome !) lui assurant des capacités hors normes de survie face à des changements brutaux dans les écosystèmes.
- Une participation à la défense immunitaire de l’hôte. C’est toujours dans le système immunitaire que l’on trouve le maximum de variabilité génétique chez un être vivant.
- Une participation aux codages génétiques des protéines, indispensables à la vie de l’hôte.
Dans certains cas, on peut même parler de « parasites domestiqués » : non seulement ils ne sont plus pathogènes mais défendent activement leur hôte ! Cela a été bien montré par exemple dans des relations entre certains virus et des poissons5.
De longues coévolutions conduisent à ce que certaines espèces soient des « réservoirs » à virus. Ceux-ci ne sont plus (ou à la marge) pathogènes pour l’hôte mais vivent avec lui en permanence. On suppose que lors de la 5e grande crise d’extinction (il y a 66 millions d’années) des virus ont littéralement « trouvé refuge » chez de nouveaux arrivants, les chauves-souris6. Il en serait de même pour les oiseaux qui sont en fait des dinosaures aviens, les seuls survivants dinosauriens de la grande crise.
C’est certainement pour cette raison que chauves-souris et oiseaux sont souvent impliqués dans les dernières maladies virales émergentes (SRAS, Ebola, Nipah, etc.). Je vais y revenir.
Cette place importante des pathogènes dans le vivant est bien mise en évidence dans un texte qui circule sur le net appelé : « Appel du covid-19 aux terrestres bipèdes »7. C’est ce qui justifie aussi le positionnement de la philosophe Claire Marin8 qui remet en cause l’expression présidentielle (discours d’Emmanuel Macron) de situation de guerre et écrit fort justement : « A mon sens, il ne s’agit pas d’une guerre, parce qu’il n’y a pas d’ennemi. Il n’y a pas d’ennemi quand il n’y a ni intelligence humaine, ni intention de nuire. Il s’agit d’un phénomène biologique qui nous menace et nous met à l’épreuve, mais ce n’est pas une guerre. Penser les maladies sur le modèle de la guerre, c’est se méprendre sur l’essence du vivant. Je ne suis pas sûre que cela aide ni à se représenter la maladie, ni à en comprendre le fonctionnement ». Et je rajouterai, ni surtout à s’y affronter !
Tout ceci pour dire que les pathogènes sont normalement parmi nous et en nous, que nous devons nous y adapter et agir pour éviter de leur offrir les meilleures conditions pour être dangereux, donc, comme le dit fort bien le philosophe Baptiste Morizot : « Il faut transformer en profondeur notre compréhension philosophique du vecteur évolutif, grâce à l’écologie scientifique pour passer de l’idée du plus apte pensée en termes de performance, à l’idée de survie du mieux relaté. Qui a la meilleure “fitness” ? C’est celui qui a le rapport le plus harmonieux à la pérennité de ses proies, la meilleure entente avec ses rivaux, le rapport le plus généreux avec ses mutualistes, le moins toxique avec ses parasites, le moins destructeur pour ses hôtes, le plus respectueux envers ses facilitateurs. Voilà qui survit, c’est-à-dire dispose à terme de la meilleure reproduction différentielle »9.
Les pandémies
Alors justement parlons des conditions qui ont permis ces maladies dîtes « émergentes » et plus globalement des pandémies.
Elles ne datent pas d’aujourd’hui. Tout le monde a en tête celle qui a marqué notre imaginaire, la « grande peste noire » du 14e siècle. On estime qu’elle a tué de 30 à 50% des EuropéenEs en cinq ans faisant environ 25 millions de victimes, puis s’est prolongée de manière plus sporadique jusqu’au début du 19e siècle. La maladie résulte d’un pathogène, une bactérie. On trouve alors deux paramètres ayant permis le déclenchement de la pandémie : la circulation accélérée des populations humaines (en l’occurrence invasions et guerre) et un vecteur intermédiaire (le rat noir) entre le porteur sain du pathogène (des puces) et Homo sapiens.
Ce qui est nouveau est que l’on a cru éliminer les pandémies grâce aux avancées scientifiques et sanitaires et que ce n’est pas le cas. On a cru que la « grippe espagnole » de 1918-1919 allait être la dernière des pandémies.
Non seulement elles font leur retour mais sous la forme de maladies « émergentes » car on ne connaissait pas précédemment les pathogènes en cause qui semblent (et sont très probablement) issus de spéciations récentes, mais aussi sous la forme de « zoonoses » (transmissions de l’animal à l’humain).
Globalement les maladies infectieuses, dont celles propres à Homo sapiens (et qui ne sont donc pas des zoonoses) font 18,3 millions de morts par an10.
Pour y voir plus clair, une petite revue de certaines des zoonoses récentes ou plus anciennes :
- Le VIH donnant la maladie appelée SIDA. Ce virus identifié en 1983 fait 3 millions de morts par an. Il existait chez les chimpanzés. Le passage à l’humain s’est fait en Afrique via la chasse massive (viande de brousse) et l’impact de la déforestation qui a permis cette chasse massive dans le contexte de populations concentrées et urbanisées. La mondialisation a fait le reste via les échanges exponentiels11.
- Le virus du SRAS identifié en 2003. C’est un coronavirus (comme le covid-19) et comme le banal rhume. Le berceau de l’épidémie est en Chine. L’origine vient d’un passage des chauves-souris forestières à l’humain via un petit mammifère, la civette, victime d’une chasse intensive. La population importante, les mauvaises conditions d’hygiène sur les marchés12.
- Le paludisme est une maladie causée par un plasmodium (eucaryote unicellulaire) transmis à l’humain par un moustique, découvert en 1880. Même si l’on suppose qu’il infecte Homo sapiens depuis 50 000 ans, il s’est surtout développé et donc devenu une importante cause de mortalité depuis les défrichements du néolithique (il y a 6000 ans) qui ont conduit à la formation d’eaux stagnantes sans les prédateurs des moustiques, au contact de populations humaines plus importantes et concentrées. Dans l’écosystème naturel, le moustique ne peut pas facilement prospérer et les infections sont insuffisantes pour faire passer le parasite chez l’humain. C’est une maladie du néolithique, qui est présente surtout en Afrique et est encore la première cause de mortalité infectieuse au monde (200 millions de malades, 400 000 décès par an)13.
- Le virus Nipah en 1998. Il est apparu en Malaisie et la déforestation pour des élevages de porcs est en cause. Les chauves-souris forestières ont été privées d’habitats et se sont tournées vers un milieu de substitution, les plantations d’huile de palme, puis leurs déjections ont infecté les élevages intensifs de porcs et le virus est passé de ce vecteur aux humains14.
- Le virus Ebola identifié en 1976 en Afrique. On retrouve ici la déforestation, conduisant au contact de populations fragiles (déplacées de guerre) avec des chauves-souris forestières15.
- La grippe aviaire, issu d’un virus dit H5N1 en 2004, d’origine du sud-est asiatique. Sont en cause le réservoir oiseaux, les élevages intensifs de volailles, la mondialisation du commerce de volailles. Il est remarquable de constater que le virus a circulé d’est en ouest en suivant les routes commerciales de l’élevage et non du sud au nord en suivant les routes des migrations des oiseaux porteurs naturels du virus…
- Le covid-19 est lui aussi un coronavirus. C’est celui en cours (et certainement pas le dernier). Ici on retrouve les mêmes « ingrédients » : chauves-souris, viande de brousse et trafic pour la « médecine » traditionnelle (pangolins), concentration de populations, manque d’hygiène sur les marchés16.
A noter que l’on retrouve très souvent l’Asie du sud-est et la Chine comme lieux de « naissance » de ces pandémies : c’est sans aucun doute dans cette zone que se concentrent les éléments favorisant les pathogènes : forte croissance urbaine rapide empiétant sur les espaces naturels, élevages intensifs dans de mauvaises conditions d’hygiène, zones tropicales où sont concentrées des espèces réservoirs de virus, fonctionnement du commerce international17.
On peut noter aussi que ces pandémies ne touchent évidemment pas que les humains. Pour donner un exemple, celui du champignon Bd (Batrachochytrium dendrobatides) introduit en Amérique du Sud via des batraciens exogènes (Xénope lisse africain ou grenouille taureau d’Amérique du Nord). Le champignon auquel les espèces d’origine se sont adaptées depuis longtemps a conduit à un effondrement spectaculaire des batraciens locaux d’Amérique centrale et du Sud18.
Le bilan
L’analyse de ces différentes pandémies fait apparaître un cocktail de causes, toujours les mêmes :
- Le réchauffement climatique, qui joue probablement un rôle mineur, mais participe au processus dans la mesure où il peut favoriser l’installation de nouvelles espèces (et donc aussi de ses parasites) de manière très rapide dans un écosystème (les autres espèces ne connaissent pas ces parasites et donc leur caractère pathogène peut devenir majeur) et dans la mesure où il déstabilise de manière brutale les écosystèmes, participant ainsi à la baisse de la biodiversité ;
- La baisse de biodiversité qui altère les écosystèmes et les coévolutions ancestrales (via entre autres la diminution ou disparition des régulateurs de pathogènes, mais aussi l’uniformisation paysagère et les modifications brutales d’habitats induisant l’altération de l’équitabilité (certaines espèces deviennent dominantes tandis que d’autres sont réduites aux marges), et de la richesse spécifique (10 espèces au lieu de 100 dans un écosystème), ce qui favorise la circulation des pathogènes ;
- La destruction brutale d’écosystèmes (par exemple déforestation) conduisant des espèces réservoirs de virus à se retrouver en contact direct et nouveau avec des populations humaines concentrées. A ce sujet, il faut bien sûr noter que les populations anciennes (d’avant le néolithique) et les populations dites « autochtones » vivant au contact et par la faune sauvage ne sont pas ou n’étaient pas sensibles à ces pathogènes car elles-mêmes fortement soumises à la sélection naturelle, peu ou pas concentrées, ayant longuement coévolué avec leurs espèces proies et donc leurs pathogènes, donc très protégées. Les pandémies sont un produit du néolithique et de son impact majeur sur les écosystèmes naturels via l’agriculture et la naissance de l’élevage19, démultiplié de manière majeure par le capitalisme ;
- L’agriculture mondialisée est aussi en cause. Le commerce international (c'est-à-dire en fait le transfert des richesses du « Sud » vers le « Nord ») conduit non seulement à des cultures intensives et uniformes mais aussi hors de leur aire écologique grâce à des procédés artificiels (amendements, produits chimiques) qui non seulement détruisent les écosystèmes locaux, mais bouleversent les coévolutions ancestrales, ce qui favorise les pathogènes. Dans le secteur de l’élevage, la disparition des espèces domestiques locales au bénéfice d’un tout petit nombre d’espèces conduit à une standardisation génétique favorisant les pathogènes ;
- L’utilisation de la « viande de brousse » et son commerce dans des conditions favorisant les pathogènes des espèces impactées ;
- L’élevage intensif dans de mauvaises conditions d’hygiène, créant des « ponts » génétiques vers Homo sapiens ;
- La concentration de populations humaines, dans de mauvaises conditions de vie dans ces zones de « ponts » ;
- La mondialisation des échanges humains et commerciaux, dans un contexte d’augmentation exponentielle et une rapidité de plus en plus grande ;
- Le cadre global de l’augmentation de la population humaine (on est passé de quelques centaines de milliers d’individus à 7 milliards).
Comme on le voit, c’est bien la façon dont l’espèce humaine habite son environnement qui est en cause et cela nous donne du coup aussi les clés pour agir. Non pour supprimer les maladies et les pathogènes, mais pour en réduire de manière importante les impacts.
Quoi faire ?
D’abord, il serait contre-productif et erroné (en plus d’être immoral) d’incriminer la démographie humaine et d’en déduire des logiques néo-malthusiennes consistant à penser que les pandémies « font le ménage ». Il n’est pas étonnant que ce soit dans les pays où est né le libéralisme économique que l’on développe l’idée de l’immunité collective, qui permettrait d’arrêter une pandémie… au prix de la perte des « faibles ». Contre-productif car c’est justement le développement des instincts sociaux et la capacité d’aide et de soutien aux plus « faibles » qui sont à l’origine du succès évolutif d’Homo sapiens. Erroné car il n’y a pas d’augmentation exponentielle de la population humaine. Tous les démographes sont formels, nous sommes en haut de la courbe, et les prévisions sont plutôt une augmentation vers 9 milliards d’individus, puis une décroissance. Je ne m’attarde pas là-dessus car ce n’est pas le sujet du texte, mais il convient de le rappeler.
Donc, il faut agir sur les autres causes, ce qui permet de ne pas se retrouver encore la prochaine fois à sauver les meubles en catastrophe en mettant en place des mesures de « confinement » des populations, destructrices des liens sociaux et favorisant la misère de populations entières, qui en retour est un élément favorisant… les pandémies !
Et ces causes sont justement celles sur lesquelles on peut agir !
- Limiter au maximum les risques par un système économique non destructeur pour les écosystèmes, en laissant de la place à des milieux naturels moins ou non anthropisés (en particulier en protégeant les forêts tropicales et équatoriales) ;
- Mettre fin aux élevages et à l’agriculture intensifs. L’alternative est un système agricole plus diversifié et complexe constitué d’une mosaïque de polycultures et élevages locaux ;
- Diminuer de manière drastique les « échanges » inutiles en termes d’intérêt collectif (la mondialisation) ;
- Décarboner l’économie pour stopper le réchauffement climatique.
Si l’on ajoute à cela l’investissement massif dans les systèmes de santé (matériels, personnels, capacités locales de production, capacités de recherche scientifique) conçus comme un service public et non comme le terrain de jeu d’intérêts privés qui se nourrissent sur la misère et les souffrances des populations, on a la réponse nous permettant de vivre le mieux possible avec nos pathogènes.
En conclusion
Pour appliquer ce plan, le système capitaliste n’est pas adapté. Il est le pire de tous. Les causes des pandémies sont au cœur de ce mode de rapport avec notre environnement. Il faut en changer. Nous avons besoin d’une société écosocialiste.
- 1. Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », le Monde diplomatique, mars 2020.
- 2. François Ramade, Dictionnaire encyclopédique des sciences et de l’environnement, Dunod, 2002.
- 3. Carl Zimmer, Introduction à l’évolution, chap. 7 p. 142, chap. 11 p. 264 et chap. 13 p. 302, De Boeck, 2011.
- 4. Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, Belin, 2001.
- 5. Carl Zimmer, Introduction à l’évolution, chap. 7 p. 142, chap. 11 p. 264 et chap. 13 p. 302, De Boeck, 2011.
- 6. Gérard Larcher, « Chauves-souris et virus ou comment vivre ensemble », Espèces n°15, 2015.
- 7. « Appel du covid-19 aux bipèdes terrestres », revue Terrestres, paru initialement dans la revue Lundimatin
- 8. Claire Marin, « Penser les maladies sur le modèle de la guerre, c’est se méprendre sur l’essence du vivant », le Monde, 25 mars 2020.
- 9. Baptiste Morizot, Les diplomates, Wildproject, 2016.
- 10. Carl Zimmer, Introduction à l’évolution, chap. 7 p. 142, chap. 11 p. 264 et chap. 13 p. 302, De Boeck, 2011.
- 11. Carl Zimmer, Introduction à l’évolution, chap. 7 p. 142, chap. 11 p. 264 et chap. 13 p. 302, De Boeck, 2011.
- 12. Carl Zimmer, Introduction à l’évolution, chap. 7 p. 142, chap. 11 p. 264 et chap. 13 p. 302, De Boeck, 2011.
- 13. Carl Zimmer, Introduction à l’évolution, chap. 7 p. 142, chap. 11 p. 264 et chap. 13 p. 302, De Boeck, 2011.
- 14. Gérard Larcher, « Chauves-souris et virus ou comment vivre ensemble », Espèces n°15, 2015.
- 15. Jean-François Guégan, émission Le virus au carré, Mathieu Vidard, France Inter, mars 2020 et interview Actu-Environnement, 2020.
- 16. Jade Lindgaard et Amélie Poinssot, « Le coronavirus, un boomerang qui nous revient dans la figure », interview de chercheurs, Mediapart 2020.
- 17. Camille Lebarbenchon, interview dans Actu-Environnement, 2020.
- 18. Elizabeth Kolbert, La 6ème extinction, chap. 1, La librairie Vuibert, 2015.
- 19. Frédéric Keck , « Les chauves-souris et les pangolins se révoltent », Mediapart, 2020, et « Nous n’avons pas l’imaginaire pour comprendre ce qui nous arrive », le Monde, 21 mars 2020.