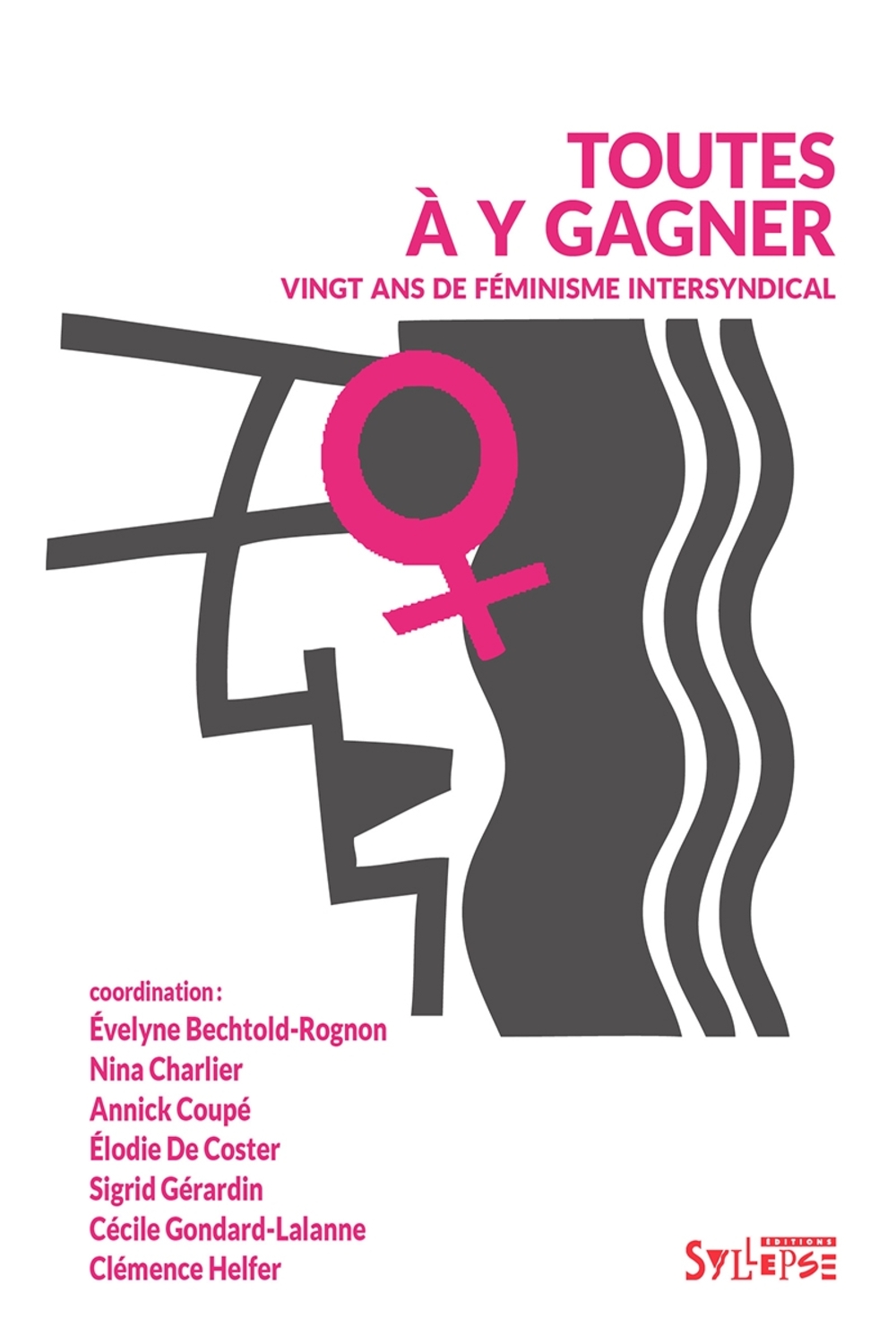Entretien. Nous avons rencontré Gaëlle du Planning familial à l’occasion des Journées intersyndicales femmes qui se sont tenues les 3 et 4 avril.
Pourrais-tu nous rappeler ce qu’est le cadre des « Journées intersyndicales femmes » et pourquoi à ton avis, elles connaissent un succès renouvelé chaque année ?
Ces journées existent depuis 1998, à l’initiative de la CGT, de la FSU et de Solidaires. Ce sont deux journées de formation et de réflexions, découpées en 4 tables rondes (une par demi-journée), sur les questions féministes dans lesquelles interviennent des chercheuses et des militantes associatives et syndicales. Chaque année, plus de 400 syndicalistes (en très grande majorité des femmes et minoriséEs de genre) s’y retrouvent.
L’idée de départ et qui perdure jusqu’à aujourd’hui était de traiter des inégalités femmes/hommes au travail en les liant avec les inégalités de genre existantes dans tous les domaines (sphères publique et privée).
Ces journées attirent de plus en plus de monde, à tel point que cette année, les organisations ont dû refuser du monde faute de places ! Selon moi, ce succès est lié au fait que les questions féministes ne sont plus affaires de spécialistes dans les organisations syndicales. C’est aussi très lié au renouveau des mouvements féministes, notamment autour de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, y compris dans les organisations militantes qui se dotent de plus en plus de structures et de procédures en interne (même si rien n’est parfait et qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir).
Cette année les thèmes abordés étaient à la fois très riches et particulièrement en phase avec des enjeux militants. Qu’est-ce que tu retiens particulièrement ?
Tout d’abord le plaisir de retrouver des camarades de divers horizons syndicaux et professionnels. Ensuite des moments très forts, et notamment la table ronde sur l’intersectionnalité qui a rassemblé des militantes et chercheuses d’Europe, des États-Unis et d’Amérique latine, avec cette conscience que nous sommes toutes dans le même bateau et que nous avons des combats communs à mener, en nous inspirant de toutes les luttes existantes. On a toutes senti à la fin de cette matinée un véritable moment de communion mais aussi l’urgence à mener les combats sur plusieurs fronts.
Tu as participé à l’animation de la table ronde « Éduquer pour combattre le patriarcat » au nom du Planning familial qui intervient dans divers cadres (scolaires, PMI, missions locales, points jeunesse...), qu’est-ce qui pour vous est particulièrement notable ?
Tout d’abord je voudrais faire un rappel : alors que depuis 2001 l’éducation à la sexualité (renommée Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle – EVARS) est obligatoire à hauteur de 3 séances annuelles tout au long de la scolarité, à peine 15 % des élèves en bénéficient.
Ces séances sont bien évidemment adaptées en fonction de l’âge des enfants et adolescentEs. Quel que soit le niveau de classe, nous constatons partout la même chose : parler du corps, savoir en nommer les différentes parties, parler de ce qu’on ressent, des changements du corps liés à la puberté, des relations amoureuses et amicales, tout cela reste extrêmement tabou, et ce, dans tous les milieux.
Pourtant les enfants ont énormément de questions auxquelles personne ne répond. Alors que l’on sait qu’il y a deux à trois enfants par classe victimes de violences sexuelles (le plus souvent dans le cadre de la famille), une majorité des élèves que nous rencontrons ignorent ce que dit la loi en ce qui concerne les agressions sexuelles, le viol et l’inceste.
La société (la famille, l’école, l’entourage, les adultes en général) passe son temps à dire aux mineurEs leurs devoirs mais iels sont rarement informéEs sur leurs droits, hormis parfois autour du 20 novembre (Journée internationale des droits de l’enfant).
Les violences conjugales sont également très peu évoquées, alors que l’on sait les impacts qu’elles peuvent avoir (et souvent à très long terme) sur leur développement, les apprentissages et leurs relations à soi et aux autres.
Il est important de dresser ce constat et d’en avoir conscience. À ce titre, le rapport du CESE (Conseil économique, social et environnemental) apporte des ressources et des préconisations en matière d’EVARS dans tous les lieux de socialisation dans lesquels les enfants évoluent (et pas seulement l’école mais aussi les clubs sportifs, les centres aérés, les colonies de vacances…), et ce, dès le plus jeune âge1.
Concrètement quel est le but de ces séances et quels sont les outils mobilisables ?
Ces séances, si elles peuvent prendre plusieurs formes, ont toutes les mêmes objectifs : tout d’abord donner des informations primordiales (si possible en partant des questions des enfants et des jeunes) sur l’égalité filles / garçons, l’anatomie, la prévention (contraception, IST), les émotions, le consentement, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les droits sexuels et reproductifs, les violences sexistes et sexuelles. Encore une fois, il est important de rappeler que les séances et supports sont adaptés à l’âge et à la maturité des enfants.
Le deuxième objectif est bien sûr le repérage des enfants victimes ou co-victimes.
Enfin ces séances sont aussi des moments où l’on va indiquer les lieux ressources (dans et hors de l’établissement ou structure) si iels ont besoin d’information, de voir un professionnel de santé ou de parler à quelqu’un de ce que iels vivent, ainsi que les numéros utiles, tels que le 119 (Allô enfance en danger).
Les outils utilisés sont très divers et dépendent des intervenantEs. Au Planning familial, nous sommes attachéEs aux outils de l’éducation populaire et préférons partir des questions et réflexions des enfants et des jeunes.
Les séances peuvent donc être introduites par un débat mouvant, l’ouverture de la boîte à questions (dans laquelle les élèves auront déposé en amont les questions sur les thématiques de l’EVARS), un brainstorming (association d’idées à partir du mot « Sexualités » par exemple). Ou bien par des supports vidéo tels que le programme « Mon corps, c’est mon corps », « Le loup », « La tasse de thé ».
Les débats autour de l’EVARS comme à un autre niveau les attaques contre le Planning familial rappellent que nous nous heurtons à de fortes résistances. Quels sont les enjeux des prochains mois ?
Je pense que l’un des enjeux des mois à venir est la communication envers les familles pour combattre les idées reçues et les mensonges véhiculés par les courants réactionnaires et relayés par certains médias et réseaux sociaux. Et faire entendre également aux familles que l’EVARS est tout aussi importante que les mathématiques, le français ou l’histoire-géo !
Un autre enjeu est la formation initiale et continue à l’EVARS de l’ensemble des professionnels qui travaillent auprès des enfants. Les associations ne peuvent intervenir partout et il est essentiel que chaque enfant bénéficie des trois séances annuelles obligatoires. Beaucoup d’enseignantEs sont souvent démuniEs face aux questions des enfants et ne se sentent pas suffisamment outilléEs pour y répondre.
Enfin, la question des moyens est au cœur de la problématique : certains départements et régions coupent partiellement ou totalement les subventions de structures intervenant dans les établissements scolaires. Des moyens suffisants et pérennes doivent être débloqués d’urgence pour former les personnels de l’Éducation nationale et pour permettre aux associations agréées EVARS de continuer de fonctionner et d’intervenir auprès des enfants et des jeunes.
Propos recueillis par Cathy Billard